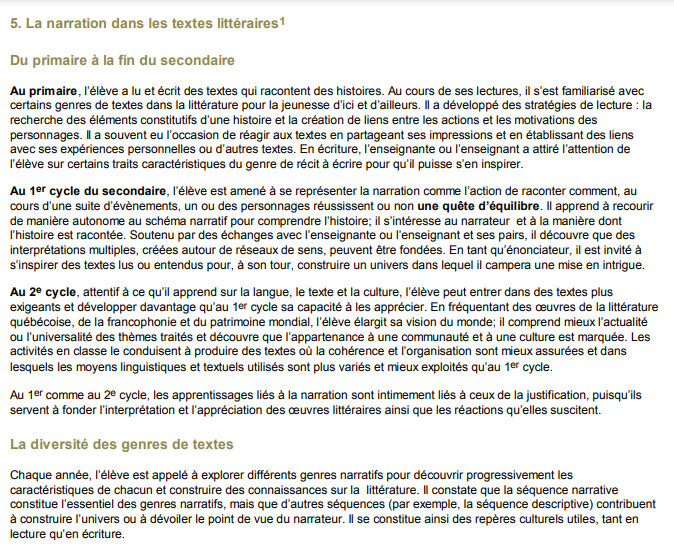Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré
- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
- Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider, Anouk Darme-Xu - Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Lire la littérature
à l’école élémentaire en France :
enjeux et débats au cours du XXe siècle
Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
Pour saisir ces variations, le croisement de deux approches est nécessaire. D’une part, une investigation didactique permet de saisir comment la lecture des textes littéraires se scolarise, par quelles démarches, avec quels supports, grâce à quels corpus. D’autre part, une approche diachronique rend compréhensibles les contextes sociaux et politiques, les choix effectués, les débats et les enjeux de cette scolarisation. Cette double démarche méthodologique que j’ai qualifiée de didactique historique en français (Bishop 2013), permet de percevoir les finalités attachées à la scolarisation des savoirs et de saisir les transformations liées à des redéfinitions plus ou moins explicites de ces finalités par l’école et la société. Grâce à cette approche, il est possible d’aborder la scolarisation des objets scolaires selon les différentes configurations de la discipline (Reuter & Lahanier-Reuter 2004), comme une organisation de modèles, c'est-à-dire comme des données historiques et disciplinaires qui dépendent des contextes sociaux, des théories disciplinaires sous-jacentes, des prescriptions officielles, des pratiques préconisées et réelles. Ces modèles ne peuvent être datés de manière précise car ils évoluent, changent et ne disparaissent que très progressivement. Le plus souvent, ils se juxtaposent et les plus anciens ne sont que lentement abandonnés dans les pratiques. Cette coexistence crée des effets de feuilletage et de sédimentation (Schneuwly & Dolz 2009). Trois modèles peuvent aider à décrire les différents moments de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire en France. Le premier est celui qui s’installe sous la IIIe République et qui persiste sous la IVe République, il s’agit du modèle fondateur de cet objet scolaire. Le second modèle est celui qui, au moment de la rénovation et de la massification de l’enseignement nait de la remise en question du précédent. Le dernier qui semble émerger à la fin du XXe siècle est le modèle actuel, modèle dominant, nourri des apports d’une didactique qui se constitue.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, ne seront évoquées que les classes de l’école élémentaire, relevant du secteur public, même si, parfois, il est fait référence de manière globale à l’ordre primaire, jusqu’en 1959.
Le modèle fondateur de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire
Introduire la littérature
Le 28 mars 1882 est publiée la Loi sur l’enseignement primaire obligatoire, signée du président Jules Grévy et du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry. Pour la première fois est défini un programme national qui comprend «La langue et les éléments de la littérature française». Accoler ces deux termes n’est pas un hasard, le rôle de la littérature est d’apporter une alternative à l’étude de la langue. Déjà en 1866, Victor Duruy alors ministre sous le Second Empire prend acte dans une circulaire de l’échec de l’enseignement de la langue apprise comme une langue morte par mémorisation et répétition de définitions. Influencé par les écrits du Père Girard (1844) et par les conceptions d’Octave Gréard, directeur de l’Instruction primaire de la Seine depuis 1865, il préconise de réduire l’enseignement grammatical à quelques définitions simples et courtes et à quelques règles fondamentales. Mais surtout, il propose pour la première fois de mettre les élèves «en présence des plus beaux morceaux de notre littérature» 1. Proposer la lecture des textes littéraires comme alternative à la grammaire constitue sans doute un événement majeur en ce milieu de siècle, qui se généralisera à la fin du XIXe siècle (Chervel 2006). C’est à partir de cette période que la lecture des textes va être peu à peu liée à l’étude de la langue et à sa maitrise. Se dessine ainsi ce qui va prendre forme sous la IIIe République, c'est-à-dire la jonction entre l’enseignement de la langue nationale et la littérature.
Toutefois, le projet républicain de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus ambitieux et ambivalent, puisqu’il s’agit d’émanciper le peuple par l’éducation, tout en maintenant un ordre social respectueux des différentes classes, c'est-à-dire en conservant les finalités pratiques de l’enseignement primaire. Le but est d’instaurer une démocratie durable en mettant en œuvre un enseignement capable de former à la fois des travailleurs, des citoyens et des électeurs. Pour cela, il est nécessaire de développer, grâce aux textes littéraires, un fonds commun d’idées, de représentations et de valeurs laïques.
Le but de l’enseignement est l’édification du citoyen avec pour principal outil l’enseignement laïc de la morale, mais toutes les disciplines contribuent à cette éducation et la littérature va occuper une place centrale dans l’édifice. C’est là certainement l’une des grandes innovations des pédagogues de la fin du XIXe siècle: pour eux, la lecture des textes littéraires qui existe depuis longtemps dans les lycées et collèges peut être adaptée à l’école élémentaire et contribuer au projet d’éducation populaire.
Les fonctions de la littérature
Pour connaitre les différentes fonctions dévolues à la littérature dans le projet des républicains, il est possible de s’appuyer sur les écrits et les discours de trois acteurs majeurs de cette période. Le premier est Félix Pécaut à qui Jules Ferry propose en 1879 la direction de l’école normale supérieure d’institutrices de Fontenay aux Roses, poste qu’il occupera jusqu’en 1896. Le second est Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879, puis détenteur de la chaire de pédagogie de la Sorbonne à partir de 1896 et surtout célèbre concepteur du Dictionnaire de pédagogie dont la première édition date de 1887. Notre troisième référence est naturellement Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, malgré quelques interruptions. Ces trois hommes vont défendre une certaine conception de l’école primaire, novatrice et laïque et introduire de manière durable la lecture des textes littéraires dans les classes de l’élémentaire. Leurs discours se croisent et se répondent, s’y dessine un projet politique et social d’édification par la littérature. Tous trois défendent comme principe que la littérature constitue l’un des piliers du projet éducatif des républicains, comme le rappelle F. Pécaut en 1872:
Il n'y a pas d'éducation sérieuse dont la littérature, c'est-à-dire la langue maternelle, l'étude des bons auteurs, les exercices écrits ou les morceaux de style, ne soit le fonds principal. (Pécaut 1881: 96)
Vont lui être dévolus différents rôles qui répondent aux finalités éducatives et politiques du projet d’éducation des classes populaires. Tout d’abord, la littérature occupe une place essentielle dans le processus de laïcisation de l’éducation et dans l’enseignement de la morale. Elle apparait comme un bien commun largement partagé (Chartier & Hébrard 2000) qui permet de conforter les valeurs morales autour d’une émotion esthétique séparée des principes religieux. Comme l’affirme Félix Pécaut:
Il reste à faire passer l’instruction de l’école dans les mœurs, de l’enfance dans toute la vie; il faut de bons livres et le gout de les lire; il faut que cette instruction serve à former des esprits droits et sensés, à aiguiser la curiosité et aussi à la discipliner. (Pécaut 1881: 25)
Ensuite, la littérature permet de développer et d’élever la culture des classes populaires. Jusqu’alors, l’école apportait le strict nécessaire pour entrer dans la vie active, mais pour les républicains, l’école doit éduquer l’individu tout entier et lui fournir un ensemble de connaissances qu’il pourra développer tout au long de sa vie, comme l’affirme F. Buisson dans une conférence de 1883:
[La République] emploiera ces jeunes années à donner aux futurs citoyens, non seulement une instruction rudimentaire, mais tout un trésor d’idées et de sentiments qui feront le bonheur et la dignité de leur vie. (Buisson 1818: 20)
Le livre de littérature et le gout de lire sont les instruments nécessaires au développement d’une culture populaire, comme l’affirme Jules Ferry dans un discours aux directeurs d’école:
Veillez surtout à la culture générale. […] le meilleur service que vous puissiez rendre aux maitres adjoints et aux maitresses adjointes, et puis à vos élèves […] est de leur inspirer le gout de la lecture. Qu’ils aient des livres et qu’ils les aiment; laissez-leur le temps de lire; faites mieux, provoquez-les à lire. (Ferry 1895: 522-523)
La troisième fonction de la littérature est scolaire, car elle permet d’envisager autrement l’étude de la langue. À partir du début du XXe siècle, l’appareil didactique évolue dans les manuels et à la suite de la lecture des textes d’auteurs, divers exercices de langue apparaissent dont des rédactions sur des sujets simples, empruntés à la littérature et à la vie des élèves (Bishop 2010b).
Enfin, la littérature est associée à une conception rénovée du savoir lire. Prenant le contrepied des lectures ânonnantes des décennies précédentes (Chartier 2007), les républicains redéfinissent les objectifs de la lecture scolaire. Il ne s’agit plus de lire pour déchiffrer, mais de lire pour apprendre dans toutes les disciplines, pour comprendre et pour découvrir la littérature française, comme le rappelleront plus tard les programmes de 1923 2:
À l'école primaire, l'enseignement de la lecture sert à deux fins. Il met entre les mains de l'enfant l'un des deux outils - l'autre étant l'écriture - indispensables à toute éducation scolaire. Il lui donne le moyen de s'initier à la connaissance de la langue et de la littérature françaises. (Chervel 1995: t.2, 321)
Quelle littérature pour l’école élémentaire?
Dans le nouveau plan d’études de 1882, les maitres sont invités à lire deux fois par semaine des morceaux empruntés aux auteurs classiques, et ce dès le cours moyen.
Mais que faire lire à l’école élémentaire? Peut-on proposer les mêmes auteurs que dans le secondaire? Les élèves sont-ils en mesure de comprendre la littérature? Comment constituer un fonds littéraire spécifique? Ces questions soulèvent parmi les pédagogues un débat passionné dans les dernières décennies du XIXe siècle (Jey 2003). L’incapacité des élèves des écoles primaires à lire et comprendre les textes classiques apparait comme un frein au projet d’acculturation. Certains, parmi les plus engagés, à l’instar de Buisson, soulignent les limites d’une lecture des œuvres littéraires dans la formation des maitres. Voici ce qu’il écrit dans l’article «Analyse» du Dictionnaire de 1888:
Il manque à la plupart, à la presque totalité de nos élèves maitres une culture esthétique, une initiation littéraire suffisante pour apprécier pleinement les beautés des œuvres qu’on leur demande d’analyser. C’est là l’écueil inévitable; plus qu’aucune autre en Europe, notre littérature nationale est imprégnée, pénétrée, inspirée des souvenirs classiques, elle perd beaucoup de son charme et de son sens pour qui n’a pu passer par l’école de la Grèce et de Rome; or nos instituteurs ne savent ni latin ni grec: il ne faut donc pas se flatter de pouvoir les mettre en état de saisir et de gouter le parfum classique de notre littérature. (Buisson 1888: t.1, 78)
Mais pour résoudre cette difficile contradiction entre nécessité d’une lecture des œuvres littéraires et manque de culture classique, Buisson évoque la qualité des grands écrivains français « qui se sont assez rapprochés de la nature pour être éternellement compris et aimés de tous. ». Il propose de s’appuyer sur les émotions suscitées par ces chefs-d’œuvre et de veiller à « ne faire analyser que des œuvres susceptibles d’entrer dans l’éducation populaire, les plus simples, les plus humaines, les plus naturelles de toutes » (Buisson 1888 : 78).
La solution va donc résider dans le choix d’œuvres accessibles à tous les élèves de l’école primaire, œuvres simples dont maitres et élèves pourront saisir la qualité. Ce que Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction primaire appelle quelques années plus tard, dans une circulaire de 1890, non pas des humanités classiques, mais des «humanités françaises» 3, adaptées au public des écoles primaires.
De quelles œuvres sont constituées ces humanités françaises? Dans une analyse antérieure, cinquante manuels parus entre 1923 et 1995 ont été analysés (Bishop 2010a). À la suite de cette étude, il apparait sans surprise que les deux grands auteurs de la IIIe République sont incontestablement Victor Hugo et La Fontaine, suivis de Molière, qui demeure le seul représentant du trio du théâtre classique à l’école élémentaire (Molière, Racine, Corneille). Mais c’est principalement Victor Hugo qui s’affirme comme le grand auteur de l’école élémentaire et ce jusqu’au milieu du XXe siècle. De veine plus populaire que la Fontaine ou Molière, c’est celui qui est de loin le plus présent dans les manuels. On récite ses poésies morales ou patriotiques mais peu à peu, ses romans prennent une place importante dans les manuels et trois personnages, Cosette, Jean Valjean et Gavroche, vont devenir emblématiques de la culture populaire. Dès le début du XXe siècle, un autre auteur occupe l’une des premières places, il s’agit d’Alphonse Daudet. Également lu en 5e et 6e, il devient une référence de la littérature scolaire et l’un des grands classiques de l’enfance, prenant place dans le panthéon littéraire. Ses œuvres les plus reprises dans les manuels sont sans surprise La Chèvre de M. Seguin parmi Les Lettres de mon moulin, Le Petit Chose et Tartarin de Tarascon.
En-dehors de ces quatre auteurs, les éditeurs scolaires sélectionnent des écrivains du XIXe siècle ou du tout début XXe qui vont constituer le répertoire de la littérature scolaire jusqu’en 1972. Ils sont souvent choisis pour leur écriture classique et reconnue. Parmi eux se trouvent de nombreux académiciens (comme Anatole France, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Duhamel, Henri Troyat ou Maurice Genevoix.) D’autres sont également appréciés pour leurs poèmes édifiants comme Jean Aicard. Certains de ces auteurs décrivent un monde quotidien, (George Sand, Colette, Marcel Pagnol). Nombreux sont les récits situés à la campagne avec ses différentes activités: la chasse, les vendanges, les semailles, etc. Il s’agit de descriptions d’une vie rurale, familiale et laborieuse. On peut y voir la glorification des valeurs traditionnelle de la société française que souligne la forte présence des auteurs régionalistes (Thiesse 1991, 1997) tels que Edmond About, Joseph Cressot, Henri Pérochon, Joseph de Pesquidoux, André Theuriet, pour ne citer que quelques noms. Cette veine importante sous la IIIe République est renforcée par les prescriptions de Vichy et se poursuit encore sous la IVe République.
Une pédagogie de la lecture des textes littéraires
Les leçons de lecture des textes littéraires sous la IIIe République se déroulent selon le schéma en trois temps défini par les instructions officielles de 1923 2:
L'instituteur commencera par lire lui-même à haute voix, en indiquant par les variations de l'intonation les nuances de la pensée et du sentiment, le morceau qu'il veut faire expliquer. Il en fera trouver rapidement les intentions principales. Par des questions alertes et des explications sobres, il fera comprendre le sens des détails et sentir la beauté des expressions. Alors seulement il fera lire le texte à haute voix par des élèves, afin de s'assurer qu'ils en comprennent la signification et en apprécient la valeur. Il va de soi que cette valeur doit être incontestable. (Chervel 1995: t.2, 322)
La démarche se veut toujours identique: d’abord une lecture du maitre, suivie de l’explication des mots, des phrases et l’élucidation du sens, pour finir par la lecture expressive des élèves. Cette lecture expressive, qui ne concerne que les textes littéraires, constitue une véritable pédagogie de la lecture à l’école élémentaire, différente de l’explication de textes des classes du secondaire. Le but de cette démarche est de conduire les élèves à percevoir la beauté des œuvres en suscitant l’émotion esthétique:
Très simplement, [le maitre] suscitera l’émotion esthétique, sans théories abstraites, sans expressions tirées du vieux jargon de la rhétorique, par un simple appel au gout d’enfants dont les impressions sont naïves et dont le jugement n’a pas été formé. (Chervel 1995: t.2, 322)
La lecture n’est pas un événement isolé car tout l’enseignement du français s’organise dans les manuels à partir des textes découverts collectivement, grâce à un appareil didactique assez récurrent d’un manuel à l’autre. Les textes d’auteurs offrent des répertoires d’idées, des réflexions morales et un vocabulaire réutilisés dans les rédactions.
Ce modèle de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire fait preuve d’une belle longévité puisqu’il persiste, malgré les remises en question et débats, jusqu’aux années 1970. Dans son ouvrage Le français tel qu’on l’enseigne, publié en 1971, Frank Marchand entreprend de décrire ce qu’il appelle «le modèle pédagogique standard que l’on retrouve dans la plupart des écoles françaises.» (Marchand 1971: 16). Il constate que les pratiques et les manuels qu’il présente et analyse n’ont guère changé depuis la IIIe République et son constat est sans appel: «Depuis bientôt un siècle, la pédagogie du français à l’école primaire n’a donc fait pour ainsi dire, aucun progrès» (Marchand 1971: 13).
La lecture au moment de la démocratisation
Redéfinir le savoir lire au tournant du XXe siècle
L’arrivée de De Gaulle au gouvernement en 1958 marque un changement de politique scolaire important (Prost 1992). Deux réformes successives, le décret Berthoin en 1959 (qui prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans) et le décret Fouchet-Capelle en 1963, institutionnalisent le principe d’un collège pour tous et modifient profondément le paysage scolaire français.
Cependant dans le domaine de l’enseignement de la lecture la question du modèle de lecteur à former commence à se poser beaucoup plus tôt. Comme le remarque A.-M. Chartier (2007), la lecture silencieuse apparait dès 1938 dans les instructions qui prescrivent pour le certificat d’études:
Au cours supérieur deuxième année, le programme prescrit explicitement la lecture silencieuse. Par ailleurs, le Conseil supérieur a voulu qu'à l'épreuve de lecture du certificat d'études, il fût accordé à l'enfant cinq minutes de préparation. Cette préparation ne peut consister qu'en une lecture silencieuse; il faut bien que les élèves y aient été d'avance exercés. Dès la classe du certificat d'études on se préoccupera donc de la lecture silencieuse. On ne peut lire intelligemment que si l'on embrasse rapidement des yeux le texte qu'on va lire. On ne peut lire à haute voix correctement les mots d'une phrase, couper cette phrase aux silences imposés par le sens, accentuer exactement les syllabes significatives, que si l'on a, par avance, saisi le sens de la phrase dans son ensemble. La voix est nécessairement devancée par les yeux. (Chervel 1995: t.2, 273)
Le problème que soulève ce texte est celui de la méthode de lecture: peut-on considérer que l’élève qui n’aborde jamais seul un texte, qui ne le découvre que par la lecture du maitre comprend ce qu’il lit? La lecture expressive permet-elle la compréhension?
Cette question prend une réelle importance au sortir de la Seconde Guerre, lorsque la reconstruction du pays nécessite de faire appel à une main d’œuvre plus qualifiée, capable de lire et de comprendre de manière autonome. Dès 1945, certainement sous l’influence des bibliothécaires selon Chartier et Hébrard (2000), les mentalités changent, la lecture personnelle n’apparait plus comme un risque pour les jeunes esprits et l’on voit naitre l’idée qu’elle peut avoir une valeur éducative. Mais ce principe ne pénètre pas immédiatement dans les discours officiels et il faut attendre la circulaire datée du 29 décembre 1956 sur la suppression des devoirs du soir pour que soit évoquée une lecture autonome, silencieuse, personnelle, distrayante et en même temps éducative.
La fin des années 1950 constitue un tournant dans la manière dont l’école définit le savoir-lire. Au cours de cette période se manifeste une évolution dans les attentes sociale vis-à-vis de la lecture et dans les finalités dévolues à la lecture des textes littéraires à l’école. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces changements.
Le premier est celui d’une demande sociale. La diffusion de plus en plus importante des livres et journaux dans les classes populaires en lien avec l’action militante de certains bibliothécaires (Butlen 2008) répand l’idée que la lecture est une pratique qui permet l’épanouissement et l’accès à la culture et qu’il est nécessaire de développer dès l’école primaire ce gout de la lecture.
Le second facteur de changement est lié à l’arrivée massive des écoliers dans les classes de 6e, dans le courant des années 1950. Le niveau de ces nouveaux élèves ne correspond pas aux attentes des professeurs qui déplorent régulièrement leur faible maitrise de la lecture. Les nouveaux collégiens, disent-ils, n’aiment pas lire et le plus souvent lisent mal ou ne savent pas lire. Et que leur reproche-t-on? D’avoir une lecture trop scolaire, c'est-à-dire d’être capables d’oraliser sans comprendre ce que dit le texte. La lecture expressive définie en 1923, ne répond plus aux exigences de la scolarité allongée. Pour savoir lire au-delà de l’école élémentaire, il faut être capable d’appréhender le contenu de n’importe quel écrit.
Ces reproches sont pris en compte par le ministère et en janvier 1958, des instructions 5 concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire sont publiées. Elles proposent une nouvelle définition du savoir lire scolaire en insistant sur la compréhension.
L’expression «savoir lire» a un sens au cours préparatoire; elle doit en avoir un autre au cours élémentaire, au cours moyen et dans la classe de fin d’études. Il convient de ne pas jouer sur les mots. Pour un élève de la grande classe, ce n’est pas «savoir lire» que de savoir déchiffrer péniblement un texte. Savoir lire, pour un candidat au certificat d’études primaires, c’est être capable de lire un texte – silencieusement ou à haute voix – à un rythme assez rapide pour que l’intelligence soit capable de saisir le sens, non d’un mot mais d’un groupe de mots. […] À une époque où évoluent si rapidement les techniques et les structures économiques et sociales, notre premier devoir est de donner à l’enfant le moyen, quand il aura quitté notre école, de se tenir au courant. Or ce moyen c’est de savoir lire – au sens où nous l’entendons. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ce texte remet en cause la pédagogie de la lecture expressive qui était le modèle dominant des IIIe et IVe Républiques. Le savoir lire, en 1958, nécessite de développer l’autonomie des élèves dans ce domaine et de s’assurer que le sens est saisi, comme le précise cette même circulaire:
L’exercice de lecture expressive n’a pas pour fin, on le sait, de dresser l’enfant à lire comme un acteur, mais seulement d’apporter la preuve qu’il comprend ce qu’il lit. Encore faut-il ne pas se laisser duper. Un enfant moyennement habile peut lire avec expression un texte qu’il ne comprend pas. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ces instructions instituent un changement important des pratiques de lecture. Celle-ci ne devrait plus être l’exercice collectif et oralisé des décennies précédentes, au contraire il est question de lectures personnelles et silencieuses, faites à la maison et restituées sous forme d’exposés et de discussions.
La lecture silencieuse et le plaisir de lire
Mais le grand changement va être la prescription de la lecture silencieuse qui advient quelques années plus tard, en décembre 1972, dans de nouvelles instructions. Ces textes s’inspirent de l’important travail de la Commission Rouchette qui a été mise en place en 1963 et reprennent une partie des propositions du Plan de Rénovation, rédigé en 1969. La conception de la lecture scolaire qui apparait à cette période se démarque totalement des prescriptions antérieures par trois aspects. Le premier est le constat de l’inefficacité des pratiques scolaires, ce que souligne le nombre important d’échecs scolaires et de redoublements. En effet, une enquête menée en 1967 6 chiffre à plus de 70% le nombre d’élèves 7 ayant redoublé au moins une fois au cours de la scolarité primaire, avec plus de 35% de redoublements au CP. Le second élément est que la compréhension des textes devient la finalité principale et qu’elle ne peut se réduire à l’oralisation. La nouvelle prescription insiste sur la nécessité de lire pour comprendre et ce dès le CP, car le principal problème des mauvais lecteurs en 6e est bien la difficulté à saisir le sens des textes. Dans les instructions de 1972, lire est défini comme la capacité à prélever les informations essentielles d’un texte au cours d’une lecture individuelle et silencieuse. La démarche de 1923 qui prônait la lecture à haute voix, expressive, et la répétition d’un même texte est définitivement abandonnée. Le dernier point est que les supports de lecture se diversifient, car il semble nécessaire de ne plus s’appuyer sur le seul corpus des textes littéraires reconnus. L’objectif, à partir de 1972, est d’être capable de tout lire. La lecture est présentée comme un acte de communication qui sert à s’informer, et à se distraire; sont donc privilégiés les textes issus de situations de communication concrètes et les ouvrages que les jeunes lecteurs pourront lire seuls.
Mais dans les faits, ces instructions de 1972 ne modifient que peu les pratiques de lecture à l’école élémentaire. C’est ce que révèle un rapport de 1985 8 demandé par le ministère sur l’enseignement du français: dans de nombreuses classes, c’est encore la lecture à haute voix qui tient fréquemment lieu d’unique pédagogie de la lecture.
Toutefois, ces instructions amorcent un grand changement dont les effets deviendront perceptibles quelques années plus tard. La lecture demeure une activité éducative mais ses finalités sont radicalement différentes. Il ne s’agit plus de partager dans une démarche collective l’admiration pour les œuvres, mais de satisfaire un plaisir qui ne peut se découvrir que dans des pratiques personnelles et silencieuses. Les deux objectifs de l’enseignement sont désormais de développer la motivation et le plaisir de la lecture.
Changement des corpus
Redéfinir le savoir lire et les finalités de la lecture entraine d’importantes modifications dans les corpus proposés par l’école. Entre 1970 et 1980 les listes d’auteurs mis à disposition dans les manuels changent. Plusieurs facteurs contribuent à ces modifications radicales.
Le premier est l’influence des mouvements pédagogiques qui considèrent la lecture comme un élément clé de l’éducation et de l’épanouissement des enfants, il s’agit du Groupe français d’Éducation nouvelle (GFEN), de l’Institut coopératif de l’école moderne fondé par Freinet (ICEM) et de l’Association française pour la lecture (AFL) pour n’en citer que trois. Ces mouvements n’accordent cependant pas tous la même importance à la lecture des œuvres de littérature en classe et c’est principalement l’AFL qui s’engage pour que les œuvres destinées à la jeunesse deviennent des supports de l’apprentissage de la lecture. La seconde cause de changement est la prise de conscience d’un rejet des œuvres littéraires classiques par les jeunes lecteurs et les risques de concurrence avec les nouveaux médias. Les gouts des élèves deviennent le critère de choix. Il ne s’agit plus d’imposer des lectures édifiantes choisies par le maitre, mais de proposer des ouvrages capables de susciter motivation et plaisir de lire. Le principe des lectures attractives, destinées au jeune public et d’accès facile apparait dans le Plan de Rénovation et sera repris dans les instructions de 1972.
Encore que le gout des enfants ne soit pas le seul critère, il est indispensable qu'ils se plaisent à lire les livres que nous choisissons pour eux. Des enquêtes diverses sur les gouts des enfants ont permis d'établir qu'ils préfèrent les livres captivants, amusants, les livres tonifiants où l'amitié, la sympathie, la solidarité jouent un grand rôle, les livres riches en aventure, qui leur donnent des informations vraies ou vraisemblables. Il serait inconcevable de n'en pas tenir compte, comme de ne pas attacher un prix particulier à la valeur humaine, à l'authenticité dans la réalité comme dans l'imaginaire, à la qualité de la langue comme de l'illustration.
L’étude déjà citée sur les corpus des manuels (Bishop 2010a) rend compte de ce changement et le palmarès des vingt auteurs les plus cités dans dix manuels édités entre 1972 à 1985 est significatif. On assiste d’abord à un déplacement des grandes figures littéraires de l’école laïque: Alphonse Daudet prend la tête du classement pour une dizaine d’années, Victor Hugo reste encore présent, mais Jean de La Fontaine est beaucoup moins cité.
Les thèmes qui organisent les lectures connaissent également de grands bouleversements, les saisons et les travaux sont remplacés par l’aventure et l’amitié. Saint-Exupéry qui aborde ces deux thèmes apparait en seconde position après Daudet, dans le palmarès de 1972-1985. On lit Le petit prince, et plus particulièrement le passage de la rencontre avec le renard. Les passages concernant les aventures aéronautiques de l’auteur sont nombreux, empruntés à Vol de nuit ou Terre des hommes. D’autres récits d’aventures vécues comme ceux du Commandant Cousteau, de Joseph Kessel, ou encore de Paul Émile Victor, de Frison-Roche, de Haroun Tazieff, de René Demaison et de Maurice Herzog figurent aussi dans plusieurs manuels. Leur point commun est le thème de l’aventure, du courage et du dépassement de soi. Les personnages et les auteurs sont considérés comme des héros modernes. Ces récits défendent certaines valeurs auxquelles l’école attache une importance morale, telles que le courage et la solidarité. En ce sens, l’édification par la littérature demeure une constante de la lecture à l’école même si elle adopte d’autres formes. Ces choix sont également à mettre en relation avec l’attrait pour la modernité, notion forte au cours de cette période. Il s’agit d’une modernité technologique et urbaine qui prend souvent l’avion comme symbole et qui explique la moindre présence des auteurs régionalistes. En effet, on ne retrouve plus que Joseph Cressot auteur du Pain au lièvre dont on continue à lire les souvenirs d’écolier campagnard. Cependant, de nombreux auteurs de la toute fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle demeurent dans le corpus scolaire. Il s’agit de Henri Bosco, Marcel Pagnol, Louis Pergaud, Jules Renard, qui tous mettent en scène des enfants, de même que des auteurs plus récents comme Joseph Joffo. Dans le même esprit, se rencontrent des romans qui décrivent l’amitié entre un enfant et un animal, c’est le cas des textes de René Guillot, auteur de Crin Blanc ou des textes de Joseph Kessel. C’est ainsi qu’une littérature qui s’adresse au jeune public s’installe véritablement, avec de plus en plus de contes et de récits écrits pour les enfants, comme les Histoires comme ça de Rudyard Kipling. La BD fait même une timide apparition avec des extraits d’Astérix ou de Tintin, malgré une certaine défiance vis-à-vis du genre.
La lecture des textes
Le changement de méthode institué par les textes officiels à partir de 1972 est radical, puisqu’il est préconisé une lecture individuelle et silencieuse. Dans les manuels ou fichiers, les textes sont accompagnés le plus souvent d’un questionnaire qui permet de vérifier la compréhension de l’élève. Les questions sollicitent un relevé d’informations portant sur les lieux, la temporalité, la chronologie, les agents et leurs principales actions. Les lectures sont souvent placées dans des ensembles thématiques qui permettent de croiser différents types de documents: récits, documentaires, publicités, etc. Les conceptions de la lecture comme traitement de l’information et l’ouvrage de Richaudeau sur la lecture rapide, daté de 1969, ont une influence certaine sur les conceptions de la lecture et on en trouve trace dans les préconisations officielles. Ainsi, les instructions de juillet 1980 9 pour les cours moyens présentent la lecture comme un prélèvement d’informations qui ne nécessite pas nécessairement une lecture exhaustive.
Savoir lire, c'est: - pratiquer naturellement et efficacement la lecture silencieuse, c'est-à-dire la vraie lecture, celle qui permet de comprendre le sens, sans s'attarder aux syllabations, en maitrisant assez les mécanismes et les techniques pour n'y recourir qu'à titre de contrôle ou de moyen d'élucidation. (Chervel 1995: t.3, 332)
La lecture doit être silencieuse pour permettre de comprendre et de prélever des informations. Les lectures privées d’œuvres complètes accessibles aux jeunes lecteurs sont encouragées, la littérature dépasse le cadre de la classe. Les instructions de 1985 vont renforcer le caractère culturel de la lecture en insistant sur le développement du désir de lire et sur la nécessaire fréquentation des livres, prônant que «lire c’est comprendre». Mais les limites de la lecture silencieuse apparaissent assez vite pour deux raisons, la première est la difficulté à contrôler les apprentissages des élèves, la seconde raison est sociale, il s’agit d’une remise en question de l’école lors de la prise de conscience du phénomène de l’illettrisme en 1984.
La didactique de la lecture des textes littéraires
La critique de la lecture silencieuse
Dès le milieu des années 1980, les résultats de l’école dans le domaine de la lecture sont dénoncés pour leur insuffisance. Deux rapports vont jouer un rôle important. Le premier, intitulé les Illettrés en France (Espérandieu et al. 1984), suscite une remise en question des méthodes scolaires. Ce rapport va déclencher un important courant de réflexion sur la lecture et provoquer une réflexion sur sa définition, son apprentissage et sur les dispositifs d’aide et de remédiation. Le second rapport, celui du recteur Migeon de 1989 (Ministère de l’Éducation nationale 1989), souligne les inadéquations entre «les attentes que suscite l’école et les résultats qu’elle obtient». Ce rapport dénonce les inégalités sociales et territoriales, les redoublements et les faibles acquis en lecture puisque, reprenant les résultats d’une enquête de l’AFL, il annonce que le nombre de lecteurs capables de comprendre ce qu’ils lisent est faible: 9% à l’entrée au collège et 19% en 3e.
Ces publications nourrissent et accompagnent de nombreux débats sur l’apprentissage de la lecture qui touchent principalement l’acquisition du lire-écrire et qui tentent de définir et de trouver un consensus sur ce qu’est la lecture et sur la meilleure manière de l’enseigner (Chartier & Hébard 2000). Le domaine est occupé par deux grandes familles de recherches. Les premières sont celles des innovateurs qui refusent les apprentissages trop mécanistes et restent méfiants face au décodage et à la lecture à haute voix. Les secondes sont celles des psychologues cognitivistes qui vont modifier profondément les conceptions du savoir lire en France. D’une manière générale, ces chercheurs remettent en question le modèle de la lecture silencieuse et plus particulièrement les approches idéovisuelles. Dès 1988, Liliane Sprenger-Charolles souligne dans sa thèse que les difficultés ne viennent pas de la compréhension mais d’un déficit de l’identification des mots, ce que les méthodes uniquement centrées sur la reconnaissance logographique ne peuvent améliorer. Au cours des Entretiens Nathan sur la lecture qui ont lieu les 10 et 11 novembre 1990 à Paris se côtoient les innovateurs et les cognitivistes. Les travaux de ces derniers apportent de nouveaux modèles qui mettent en lumière la complexité du processus de compréhension qui va être peu à peu envisagé comme un possible objet d’enseignement et d’apprentissage.
La didactique de la lecture des textes littéraires va naitre de ces débats car il apparait dans le courant des années 1990 que la seule fréquentation des livres ne suffit pas à mener les élèves vers le désir de lire et que la lecture silencieuse ne peut garantir des acquisitions définitives. De plus, les travaux anglo-saxons de psychologie cognitive conduisent à modifier les conceptions sur la compréhension en lecture et mettent en lumière les procédures mentales des lecteurs. Enfin, les théories littéraires sur la réception du texte et sur le rôle du lecteur dans l’activité interprétative vont entrer en collision avec les précédentes.
Le ministère rend compte de cette profusion de recherches et publie en 1992 une véritable mise au point théorique, il s’agit de La maitrise de la langue à l’école (Ministère de l’Éducation nationale 1992a) qui présente un état des lieux de la didactique du français, accompagné d’une bibliographie d’études portant sur la didactique du français entre 1980 et 1992. Mais sur les cent titres proposés treize seulement concernent la lecture des textes et l’activité du lecteur, parmi ceux-ci sept sont des ouvrages de sociologie et six seulement traitent de la littérature de jeunesse ou des activités de compréhension des textes dans une approche pédagogique ou littéraire. La didactique de la littérature est encore peu présente dans les travaux répertoriés. Les rédacteurs de l’ouvrage La maitrise de la langue à l’école envisagent la fréquentation des livres du patrimoine comme une nécessité et évoquent «l’initiation des jeunes lecteurs à la lecture littéraire» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) ainsi qu’une «pédagogie de la réception des textes» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) pour laquelle il n’existe pas encore, en 1992, de méthode clairement définie sinon le souci de se démarquer des pratiques du second degré.
À l'école élémentaire, l'approche des grands textes ne relève ni de l'histoire littéraire ni d'une technique particulière de lecture (lecture expliquée, lecture méthodique, etc.). Elle se construit dans le cadre d'une connivence culturelle et émotive qu'il appartient à l'enseignant d'installer avec soin. (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 107)
La naissance de la didactique de la lecture des textes littéraires
Les groupes de recherche créés dans le courant des années 1970 par l’INRP pour accompagner le mouvement de rénovation du français suscitent un développement rapide des études de didactique de la langue maternelle, qui portent surtout sur l’oral, l’étude de la langue et l’écriture. Mais il faut attendre le début des années 1990 pour que soit posée la question de l’enseignement de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire.
Cependant différentes approches existent déjà, elles vont servir de base aux travaux ultérieurs. Un premier domaine d’investigation est linguistique ou psycholinguistique. Il s’agit d’une réflexion sur l’utilisation des typologies textuelles comme outil de lecture. Ce sont, entre autres, les travaux des revues Pratiques et du Français aujourd'hui, à partir de 1984 avec des articles de Brigitte Duhamel, de Bernard Schneuwly, Jean-Paul Bronckart ou Jean-Louis Chiss, et d’autres encore. Un autre courant plus pédagogique est issu des mouvements qui promeuvent la littérature de jeunesse comme support éducatif. Ces recherches sont proches ou issues des mouvements pédagogiques comme l’AFL ou le GFEN, des associations de défense des livres de jeunesse, ou des groupes de bibliothécaires comme L’Heure Joyeuse. Les publications qui proposent des activités concrètes à partir de titre d’ouvrages paraissent à partir de 1985, signées de Jean-Claude Bourguignon, Rémy Stoecklé, Josette Jolibert, Bernard Devanne, Jean Perrot, pour ne citer que quelques noms. Un dernier courant s’intéresse davantage à l’histoire et aux relations entre école et littérature, on peut citer l’ouvrage de Francis Marcoin, À l’école de la littérature, paru en 1992.
Mais c’est réellement à partir de 1995 que des travaux vont tenter de définir des modèles didactiques de lecture des œuvres littéraires, en utilisant les amorces de recherches citées précédemment. Le n°13 de la revue Repères, publié en 1996 sous la direction de Catherine Tauveron et Yves Reuter témoigne de ce souci de formaliser ce qui commence à se dessiner dans le champ de la didactique, puisqu’il propose, en introduction, de «problématiser l’enseignement/apprentissage de la littérature à l’école élémentaire et de construire des propositions pour une didactique de la littérature à l’école» (Tauveron & Reuter 1996: 13).
Mais les auteurs reconnaissent que la tentative est précoce et «audacieuse», que le domaine est encore bien peu exploré et que les travaux gardent une dimension spéculative. Cependant, très rapidement l’espace va se remplir. L’institutionnalisation de la littérature dans les instructions de 2002 et la mise en place d’une épreuve orale spécifique au concours de professeur des écoles en 2005 développent un courant de recherches et de formation prolifiques. Certains travaux spécifiques comme ceux de Catherine Tauveron (Tauveron 2002) ont une forte influence sur l’ensemble de la communauté éducative et ont certainement irrigué les instructions de 2002.
Lire des textes littéraires
La lecture des textes littéraires à l’école élémentaire se développe en lien avec l’évolution des enjeux sociaux à l’aube du XXIe siècle. Il s’agit d’éviter les clivages culturels et d’utiliser la littérature comme ciment de la communauté nationale. L’introduction des instructions de 2002, signées du ministre Jack Lang, est significative de ce phénomène. Le thème de la culture commune, fondement d’une langue commune, est largement présenté et la relation entre inégalités sociales et inégalités culturelles institue la littérature comme l’un des principaux moyens que possède l’école pour dépasser ces inégalités:
L’inégalité sociale, nous le savons est d’abord une inégalité culturelle: c’est à l’école qu’il appartient de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture. (Ministère de l’Éducation nationale 2002b: 8)
Ce partage d’une culture commune se produit grâce à la connaissance d’œuvres patrimoniales contribuant à ressouder une communauté autour de la littérature.
Le but des instructions de 2002 est d’instituer une pédagogie de la lecture littéraire spécifique pour l’école primaire, libérée du modèle secondaire de type explicatif. Cette lecture est conçue comme une activité interprétative, et pour la première fois, l’objectif n’est plus seulement de s’assurer de la compréhension des textes. Les instructions de 2002 tentent d’instituer un lecteur spécifique, lecteur interprète, dans une approche inspirée des théories de la réception. La nouvelle didactique de la lecture littéraire s’appuie sur des pratiques pédagogiques qui vont connaitre un certain succès auprès des enseignants. Il s’agit des lectures en réseaux, fondées sur le principe de l’intertextualité et des débats interprétatifs qui font de la lecture une activité partagée et socialisante devant permettre de fonder une communauté de lecteurs. Les liens entre lecture et écriture sont renforcés par la tenue de carnets de lecture, recommandés par les instructions.
De plus, l’activité intertextuelle et interprétative suppose un corpus de textes « ouverts à interprétation ». Pour l’école élémentaire, ces textes sont systématiquement choisis dans la littérature de jeunesse, considérée à l’égal de la littérature adulte dont elle possèderait toutes les caractéristiques. Les ouvrages de jeunesse sont proposés dans trois listes publiées en 2002, 2004 et 2007 et servant de référence tant pour les enseignants que pour les éditeurs. Là encore il s’agit d’une première fois : le ministère n’avait jusqu’alors jamais publié de liste pour les niveaux élémentaire ou maternelle du primaire.
Les corpus proposés par les manuels se modifient dès 1985. Selon l’étude de 2010 déjà évoquée (Bishop 2010a), nous pouvons remarquer que les corpus scolaires évoluent rapidement entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, ils présentent quatre caractéristiques nouvelles. La première est l’entrée massive de la littérature de jeunesse dans les manuels, dès 1985, avec des auteurs dont une grande partie de l’œuvre est dédiée à la jeunesse tels que Michaël Morpurgot, Anthony Horowitz, Roald Dahl, Gianni Rodari, Evelyne Brisou Pellen, Bernard Friot, Pierre Gripari, Dick King-Smith, pour ne citer que quelques noms. Le second élément est la disparition des auteurs du XIXe siècle. Ils sont remplacés par des œuvres appartenant à un patrimoine national ou mondial, où les contes et les fables retrouvent une place de choix: Grimm, Perrault, Andersen, Mme Le Prince de Beaumont, La Fontaine, Ésope, etc. Un troisième élément est la présence importante de la poésie, considérée comme un objet littéraire en soi et non uniquement comme support de récitation. La poésie est proposée pour être dite, créée, écoutée, imitée. Les auteurs fréquemment mentionnés s’adressent à un jeune public. Il s’agit, entre autres de Claude Roy, Pierre Gamarra, Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Georges Jean, etc. Le quatrième et dernier point est l’ouverture des corpus: la littérature donnée à lire dépasse le cadre des frontières et s’internationalise. Les œuvres étrangères, traduites ou francophones, représentent près de 40 % de l’ensemble des titres proposés dans les listes ministérielles de 2002 et 2004 (Bishop & Ulma 2007). Mais ces textes sont lus avec des objectifs littéraires tels que la connaissance des personnages ou l’intertextualité. À la fin du XXe siècle, l’école institue un nouvel ensemble d’œuvres à lire dans les classes qui deviennent des classiques de la jeunesse. Ces corpus répondent aux finalités culturelles, sociales, éducatives, patrimoniales et littéraires que la société semble assigner à la lecture des œuvres littéraires à l’école élémentaire.
Pour conclure, il est possible de remarquer que, au cours des différentes périodes évoquées, la lecture des textes littéraires à l’école primaire a été fortement marquée par les contextes sociaux et politiques et par le projet éducatif attaché à l’école élémentaire. Cette activité a été maintes fois l’objet de débats et d’enjeux. L’une de ses caractéristiques est d’avoir toujours tenté de se dégager du modèle du secondaire, et il n’a jamais été envisagé de transmettre des savoirs sur la littérature ou sur son histoire, ni de pratiquer des explications littérales des textes. Au contraire, depuis la IIIe République, on s’efforce de mettre en place une pédagogie de la lecture des textes littéraires qui soit spécifique au public des écoles primaires. Mais surtout, avant 2002, la littérature ne constitue pas un objet d’enseignement, il n’y a pas d’éléments littéraires à enseigner. On enseigne la lecture des textes littéraires, mais jamais la littérature en soi. C’est à partir des instructions de 2002 que la lecture littéraire est instituée par les textes officiels avec des objets et des démarches particuliers. Cette didactique de la littérature à l’école élémentaire est récente, elle repose sur des procédures spéculatives qui relèvent de notre conception moderne de l’interprétation et de l’institution de l’élève comme individu autonome.
Bibliographie
Anonyme (1985) - Réflexions sur l’enseignement du français 1983-1985, Rapport de la Commission de Réflexion sur l’Enseignement du français, Angers, CNDP de Maine et Loire.
Bulletin officiel de l'éducation nationale, « Instructions concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire », n°14, 27 mars 1958, p. 1103.
Bishop, Marie-France & Dominique Ulma (2007), «Approche historique et comparatiste de la place de la littérature à l’école», in La littérature à l’école, enjeux, résistances, perspectives, M. Lebrun, A. Rouxel & C. Vargas (dir.), Aix en Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007, p. 63-88.
Bishop, Marie-France (2010a), «Que lit-on à l’école primaire au cours du XXe siècle? Listes et corpus de textes de 1880 à 1995» in Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Rennes, PUR, 2010, p. 139-152.
Bishop, Marie-France (2010b), Racontez vos vacances, Grenoble, PUG.
Bishop, Marie-France (2013), Statuts et fonctions de la mise en perspective historique dans la didactique du français, Mémoire d’habilitation, Lille, Université de Lille 3.
Butlen, Max (2008), Les politiques de lecture et leurs acteurs (1980-2000), Lyon, INRP.
Chartier, Anne-Marie (2007), L’école et la lecture obligatoire, Paris, Retz.
Chartier, Anne-Marie & Jean Hebrard, (1989), Discours sur la lecture. (1880-2000), Paris, Fayard (2e éd. : Fayard, 2000).
Chervel, André (1988), «Pour une histoire des disciplines scolaires», Histoire de l’éducation, n°38, p. 59-119.
Chervel, André (1995), L’enseignement du français à l’école primaire. Textes officiels, t.1-3, Paris, INRP.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (1996), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck (2e éd. : De Boeck 2005).
Espérandieu, Véronique, Antoine Lion & Pierre Bénichou (1984), Des illettrés en France. Rapport au premier ministre, Paris, La Documentation française.
Girard, Grégoire (1844), De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et les familles, Paris, Debrozy, E. Magdeleine et Cie.
Jey, Martine (2003), «La littérature, un objet ambigu» in D. Denis & P. Khan (dir.), L’école républicaine et la question des savoirs, Paris, CNRS, p. 79-102.
Ministère de l’Éducation nationale (1989), La réussite à l’école. Rapport du recteur Michel Migeon à Lionel Jospin, Paris, CNDP.
Ministère de l’Éducation nationale (1992a), La maitrise de la langue à l’école, Paris, CNDP, Savoir Lire.
Ministère de l’Éducation nationale (1992b), Qu’apprend-on à l’école élémentaire?, Paris, CNDP.
Prost, Antoine (1992), Éducation, société et politique, Paris, Seuil.
Reuter, Yves & Dominique Lahanier-Reuter (2004), Présentation de quelques concepts pour analyser l’écrit, St. Louis, Colloque Writing across the curriculum international.
Schneuwly, Bernard & Dolz Joachim (2009), Des objets enseignés en classe de français, Rennes, PUR.
Sprenger-Charolles, Liliane (1988), L'apprentissage de la lecture et de ses difficultés: contribution. Thèse soutenue sous la direction de Frédéric François, Paris 5.
Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.
Tauveron, Catherine & Yves Reuter (dir.) (1996), Repères, n°13, «Lecture et écriture littéraire à l’école».
Thiesse, Anne-Marie (1991), Écrire la France, le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la belle époque et la Libération, Paris, PUF.
Thiesse, Anne-Marie (1997), Ils apprenaient la France, l’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Pour citer l'article
Marie-France Bishop, "Lire la littérature à l’école élémentaire en France", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/lire-la-litterature-a-l-ecole-elementaire-en-france
Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
... la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire...
Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
Dans votre ouvrage paru en 2015 et intitulé Enseigner la littérature aujourd’hui: «disputes» françaises (Paris, Champion), vous mettez l’accent sur les débats qui ont accompagné depuis une vingtaine d’années les réformes de l’enseignement de la littérature en France. Les prises de position, très tranchées et virulentes, ont été nombreuses. À relire certaines d’entre elles, on s’étonne de leur forte teneur émotionnelle. Comment expliquez-vous cette composante affective des débats? Serait-elle une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle?
Je me permets de répondre à votre seconde question avant de proposer quelques explications à «cette composante affective des débats» qui ont accompagné les réformes de l’enseignement de la littérature en France au cours des vingt dernières années.
Cette «composante affective» ne me semble pas être une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle, du moins pour ce qui concerne la France. En effet, comme tend à le souligner le titre donné au premier chapitre, cette «crise» est en quelque sorte «congénitale». Selon Alain Viala, président du groupe d’experts à l’origine des programmes de lycée vivement contestés au tout début des années 2000, la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire (ses évolutions et ses régressions en termes de finalités mais aussi de corpus, de contenus et de modalités d’enseignement) nous aide à comprendre les reconfigurations successives auxquelles elle est soumise.
La «teneur émotionnelle» qui caractérise les discours de déploration qui ont envahi la scène publique française au tournant du XXIe siècle n’est en rien exceptionnelle. Déjà au début du siècle précédent, Gustave Lanson a dû répondre aux vives attaques qui lui étaient adressées depuis la mise en application de la réforme de 1902, considérée alors comme le facteur essentiel de la «crise du français». Il lui a fallu expliquer à ses détracteurs que les changements sociaux et sociétaux observés à partir des années 1840 avaient accentué les écarts entre la culture littéraire classique enseignée au lycée, dont le public s’était diversifié, et la culture bourgeoise, dont les pratiques culturelles s’étaient également modifiées. Et une telle situation jalonne tout le vingtième siècle, période durant laquelle les politiques publiques d’éducation tendent progressivement à favoriser la massification et la démocratisation de l’enseignement scolaire et, plus tardivement, universitaire. Or, si les réformes Berthoin, Fouchet-Capelle et Haby 1, adoptées respectivement en 1959, en 1963 et en 1975, ont permis, en France, la massification de l’enseignement secondaire, sa démocratisation se fait attendre aujourd’hui encore, alors même que les acteurs politiques comme institutionnels n’ont eu de cesse tout au long du dernier demi-siècle de la promouvoir par une série de mesures, parfois contradictoires et contre-productives pour ce qui concerne l’enseignement de la littérature. C’est précisément ce que j’explique dans l’ouvrage L’enseignement de la littérature au collège (2005:25-91), duquel je vais tirer trois exemples afin de montrer combien cet enseignement répond à des enjeux sociaux et sociétaux et, par là même, à des enjeux politiques, raison pour laquelle toute orientation nouvelle donnée à cet enseignement est source de tensions et donc de réactions souvent très vives. On peut lire, par exemple, dans les Instructions du 27 octobre 1960 concernant «la lecture suivie et dirigée»:
[Il faut] restaurer dans une certaine mesure la notion de littérature qui a pris pour de nombreux esprits un sens péjoratif. Il faut montrer qu’elle n’est pas un jeu gratuit de l’esprit, une parade étincelante chargée de divertir la galerie, un musée poussiéreux d’écrivains qu’on salue au passage et qu’on s’empresse d’oublier, mais l’expression d’une époque dont elle reflète les idées et les rêves, les inquiétudes comme les espoirs, les déchirements comme les enthousiasmes, mais le témoignage d’hommes profondément engagés dans l’existence et qui nous font part de leurs multiples expériences. Nos élèves doivent savoir que la littérature est une force sociale, qu’elle forme et oriente les esprits, qu’elle dégage des styles de vie, qu’elle influe puissamment sur la mentalité et l’opinion et que, par suite, c’est avec sérieux qu’on doit la considérer 2.
Considérer la littérature et, de fait, son enseignement scolaire «avec sérieux» est alors d’autant plus indispensable qu’elle entre en concurrence, semble-t-il, avec un nouveau medium culturel (la télévision voire, dans une moindre mesure, le cinéma), susceptible de «forme[r] et [d’]oriente[r] les esprits». Situation qui conduit, par exemple, les auteurs du manuel Lire – Troisième (Descazaux & Littman), édité par Bordas en 1968, à émettre un véritable cri de détresse:
Homme sans passé, sans drame, sans langage, transparent et puéril, infiniment fragile, perméable à toutes les entreprises, et les plus vulgaires, de la propagande et de la publicité. Consommateur conditionné, automate consentant aux rouages bien huilés, curieux de déguisement, de violence et de bruit pour mieux dissimuler son néant intérieur. Dès lors comment douter que notre devoir le plus pressant soit de rendre à ce pantin son humanité? C’est à préparer les futurs adhérents des maisons de la culture qu’il nous faut œuvrer. Ah! Comme tout reprend sens et saveur dès que passe à nouveau le courant humain, dès que retentit la voix oubliée des poètes, dès que la litote, l’allusion, la nuance fine sont à nouveau entendues et saluées comme telles!
C’est également avec une grande charge affective que les auteurs du manuel Textes vivants – Expression personnelle – Sixième édité par Magnard en 1973 rappellent aux professeurs de français que leur mission est de «sauver la personne, au moment où elle risque d’être altérée par la mécanisation et la robotisation de la vie, happée par la fourmilière des villes, submergée par le déferlement d’images télévisées» (Arnaud L. & C.:6). On retrouve cette même «teneur émotionnelle» dans le propos tenu par l’universitaire français Jean Burgos en 1975: «J’ai l’impression que notre enseignement fait naufrage, il faut trouver au plus vite des solutions» (1977:97). Et, vingt-cinq ans plus tard, le Belge Karl Canvat dresse un constatanalogue à celui de son ainé: «Tout le monde connait la crise que traverse,depuis une trentaine d’années, l’enseignement de la littérature dans lesecondaire» (2001:151). Comme je m’efforce de le (dé)montrer dans la première partie de l’ouvrage auquel vous faites allusion, ces discours de déploration reflètent certes une situation conflictuelle mais ils sont aussi, selon moi, le signe de lavitalité d’un enseignement humaniste qui interroge sans cesse ses finalités, ses contenus,ses modalités. C’est d’ailleurs ce que tend également à rappeler Jean Caune dans sa monographie publiée en 2013. Selon ce spécialiste de la médiation culturelle, l’enseignement des sciences serait également en crise dans la mesure où il est en rupture avec l’état actuel du monde et de la société. Et, de fait, le chercheur questionne la place de la science au sein des humanités contemporaines.
La «forte teneur émotionnelle», perceptible dans les propos qui ont accompagné la mise en application de nouveaux programmes de français au tournant du XXIe siècle, est présente dans un grand nombre de discours tenus en réaction aux réformes successives qui ont jalonné le XXe siècle en vue d’adapter les disciplines scolaires – et, en particulier, l’enseignement de la littérature comme celui de la langue – à la réalité sociale et technologique du moment. À l’occasion des premières Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, Martine Jey ouvre sa communication par cette question: «Et si les débats et polémiques actuels étaient, pour une bonne part, la répétition des débats de la fin du siècle dernier?» (2001:35). On peut donner au moins deux explications, étroitement liées, à cette «composante affective des débat» d’hier et d’aujourd’hui.
La première réside dans les liens, plus ou moins ténus, qui unissent «humanités» et enseignement de la littérature, notamment française, depuis sa création, c’est-à-dire depuis l’instauration de l’explication de textes d’auteurs français au baccalauréat en 1840: mise en concurrence des humanités classiques et des humanités modernes dès le milieu du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, des humanités modernes et des méthodes dans la seconde moitié du XXe siècle (Veck 1994) puis «retour en force» des humanités au tournant du XXIe siècle (Denizot 2015) et questionnement sur la définition même des «humanités» aujourd’hui (Citton 2010; Doueihi 2008, 2011). Certes, comme N. Denizot le fait remarquer, «[d]ans le champ de l’enseignement, le terme “humanités” semble réapparaitre depuis quelques années, mais avec des acceptions qui ne sont pas complètement stabilisées» (Ibid.). On observe cependant depuis une décennie un recentrage des programmes sur la dimension humaniste3 de la culture – de la culture littéraire étroitement liée à la culture artistique, comme le soulignent les programmes de l’école et du collège de 2015 – et, de fait, sur la portée éthique, politique voire philosophique des œuvres. À l’heure où les valeurs de la République française sont ébranlées, l’enseignement de la littérature apparaît comme un espace de «formation des élèves à une posture éthique d’interprète, quels que soient les discours auxquels ils ont affaire. […] Il s'agit d'une préoccupation d'ordre politique, en ce qu'elle réintroduit la question de l'effet de vérité des textes et la question des valeurs que le lecteur actualise à leur contact» 4. On perçoit dans ces orientations, assumées tout à la fois par quelques acteurs institutionnels et par certains chercheurs (en didactique de la littérature mais aussi en philosophie éthique, en sociologie des valeurs, en théories littéraires), combien l’enseignement de la littérature est susceptible de répondre à des enjeux éthiques et politiques et, par voie de conséquence, de faire l’objet de débats à forte charge affective, et cela, indépendamment du contexte dans lequel ces débats s’inscrivent.
Afin de développer quelque peu cette deuxième explication, je vais prendre appui sur la double acception du terme «politique» que Paul Aron rappelle dans Le dictionnaire du littéraire (2002:590-591): le politique désigne «l’espace social de la confrontation des opinions et des intérêts des citoyens», la politique désigne «l’art de gouverner la cité». Et il précise:
Le domaine du littéraire ne peut être pensé à l’écart de ces deux acceptions. Il est, pour une part, un lieu d’intégration «civile» des citoyens dans la vie sociale, parce qu’il permet de maîtriser la langue, les discours, les savoirs et les représentations, et parce qu’il offre un moyen d’invention et de divertissement; d’autre part, il peut être vu comme un vecteur d’opinions et d’intérêts. La place et les missions qu’on lui accorde dépendent donc de choix (du) «politique(s)».
La réalité institutionnelle française d’hier et d’aujourd’hui confirme cette corrélation établie ici entre l’enseignement littéraire et le/la politique, tous deux reposant sur des idéologies variables. Cette corrélation explique donc aussi la dimension polémique que revêtent les réactions des uns et des autres lors de toute réforme affectant en profondeur les finalités de cet enseignement et, de fait, ses modalités ainsi que les corpus sur lesquels il repose. Le propos développé au tournant du XXIe siècle par François Baluteau au sujet de l’enseignement dispensé dans les collèges souligne les tensions idéologiques qui l’affectent alors et qui concernent aujourd’hui tout autant le lycée, soumis au phénomène de massification évoqué plus haut:
S’il [le collège] se cale sur l’égalité des chances, on dénonce un renoncement à une excellence intellectuelle, une chute culturelle de la Nation, s’il maintient une exigence savante, on entendra des voix déclarer l’élitisme, s’il s’engage dans une reconnaissance d’une éducation intégrale, certains verront les signes de la défaite intellectuelle. […] Le collège serait finalement réussi si tous les jeunes, qui lui sont confiés, pouvaient en sortir avec un égal «bagage culturel ». Et par conséquent, au centre de tous les problèmes et de tous les espoirs, se place l’accès du plus grand nombre à la culture savante. Celle-ci est défendue largement comme une fierté nationale 5. Elle est aussi un principe supérieur qui rend indécidable la solution égalitaire par un renoncement à une culture scolaire exigeante. (2001:6)
L’enseignement de la littérature cristallise la tension évoquée ici de façon plus générale. Pour certains (législateurs, enseignants, parents et même élèves, chercheurs, etc.), celui-ci vise (doit viser) à l’acquisition de ladite «culture savante», culture «commune» autour de laquelle il s’agit de fédérer des (pré-)adolescents aux identités diverses afin d’assurer la cohésion du groupe social, dont le fonctionnement est effectivement assujetti à une communauté de normes, de références. La religion a longtemps assuré cette fonction normative: elle parvenait à «lier» les hommes autour d’un même objet sacré, autour des mêmes valeurs morales. Il est dès lors attendu de l’enseignement de la littérature qu’il poursuive cette même finalité dans la mesure où, comme l’explique Emmanuel Fraisse, «même sans Dieu (et surtout peut-être sans Dieu), même sans Auteur et sans origine, le livre et la lecture demeurent, en dernière analyse, le lieu du lien, de la solidarité absolue, de la religion au sens propre du terme» (2000:594). Or, faire apparaître la littérature (et son enseignement) comme un «liant social», facteur d’harmonie dans une communauté que d’aucuns disent qu’elle souffre de déliquescence, n’est-ce pas l’asservir à des raisons d’État, comme le soulignent les auteurs de l’ouvrage S’approprier le champ littéraire?
Mais l’État n’a pas joué uniquement au cours des siècles le rôle d’une instance régulatrice ou répressive, l’État, par le biais de certains de ses appareils idéologiques ou hégémoniques (surtout l’Église au moyen âge et l’École aux temps modernes) a orienté les pratiques du champ littéraire.
Par l’art et la littérature, l’État entend produire des discours de cohésion sociale et diffuse des valeurs dans le langage de l’universel. […]
Progressivement l’Église céda ses prérogatives à l’Appareil Judiciaire d’État en matière de censure et sa fonction idéologique à l’Appareil Scolaire. (Rosier, Dupont & Reuter, 2000:144)
Que l’on adhère ou non à cette prise de position, il n’en demeure pas moins que les contours de cette discipline scolaire sont à interroger car, comme le montre Alain Vaillant, «nous sommes aujourd’hui engagés dans un bouleversement littéraire d’une ampleur exceptionnelle – peut-être le plus considérable depuis la Renaissance»: non seulement les outils numériques transforment les conditions de création, de diffusion et de réception de l’objet littéraire, mais «le processus global de mondialisation, qui touche les productions intellectuelles au moins autant que l’économie, remet en cause [le] modèle national» (2011:12) sur lequel la littérature s’est construite dans l’hexagone.
On peut percevoir dans cette rapide démonstration combien l’enseignement de la littérature s’est fondé et se fonde aujourd’hui encore sur des considérations idéologiques et politiques, ce qui explique la «teneur émotionnelle» des débats qui surgissent lors de toute réforme affectant ses finalités, ses contenus, ses modalités.
L’enseignement de la littérature est l’objet de pratiques et de réflexions de la part d’une grande diversité d’individus impliqués au primaire, dans le secondaire, dans les universités et les hautes écoles; dans les instances nationales et régionales chargées d’élaborer les programmes; parmi les formateurs et les formatrices; en didactique; et dans les études littéraires. Il semblerait, à vous lire, que les «disputes» récentes n’aient pas mobilisé au même degré chacun de ces champs. Existe-t-il néanmoins des préoccupations qui leur seraient communes − en dépit de ces divergences éventuelles?
Limitant ma réflexion à l’enseignement de la littérature au collège et au lycée en France – même si je convoque des recherches menées dans différents contextes de la francophonie –, il est vrai que certains des champs que vous évoquez peuvent sembler ne pas être concernés par ces «disputes». Je vais donc, avant de répondre à votre question, apporter quelques précisions concernant les choix que j’ai opérés.
Il faut savoir qu’en France les programmes sont élaborés par une instance nationale (la Direction générale de l'Enseignement scolaire, qui dépend du Ministère de l’Éducation nationale) et qu’ils concernent donc l’ensemble de la population scolaire de l’hexagone et des départements et régions d’outre-mer.
Les formateurs et les formatrices ont pour mission de relayer les prescriptions institutionnelles et de faciliter leur mise en œuvre. Si contestation il y a de leur part, c’est le plus souvent sous une autre «étiquette» que celle de formateurs ou de formatrices qu’elle s’exprime: ils/elles adoptent alors la posture du chercheur, qui questionne, entre autres, la validité de ces prescriptions. Les travaux de recherche en didactique de la littérature que je confronte sont donc aussi le fruit de formateurs et de formatrices engagés dans un travail de recherche personnel ou bien mené sous le pilotage d’un ou d’enseignants- chercheurs.
Par ailleurs, l’enseignement de la littérature au primaire, institué en France en 2002, a certes donné lieu à des discours multiples. Mais il s’est agi, au cours des quinze dernières années, principalement de configurer une «sous discipline du français» (Bishop 2016:383) et de donner naissance à une «didactique spécifique qui ne peut être totalement dissociée de l’apprentissage du savoir lire» (ibid.: 367),la didactique de la lecture littéraire «concern[ant] principalement les classes de collège et de lycée» (ibid.: 382). Très majoritairement et même si certaines résistances sont perceptibles au sein du corps enseignant, ces discours ne remettent pas en cause l’enseignement de la littérature de façon aussi virulente et aussi polémique que cela est le cas pour cet enseignement dans le secondaire et, plus particulièrement, au lycée 6. Et cela, pour deux raisons, me semble-t-il: cet enseignement concerne essentiellement la littérature de jeunesse, la littérature «consacrée» relevant de la «culture savante» n’est donc pas «menacée»; même si une théorisation didactique de la lecture littéraire à l’école, s’intéressant à la réception des textes par le sujet lecteur, se fait jour au tournant du XXIe siècle 7 et qu’une épreuve de littérature est inscrite au concours de recrutement des professeurs des écoles de 2005 à 2010, l’enseignement de la lecture des textes littéraires répond à deux finalités distinctes, comme tendent d’ailleurs à le rappeler les programmes du cycle 3 de 2015 8: des enjeux littéraires et de formation personnelle d’une part, des enjeux cognitifs et métacognitifs (développer la compréhension de l’écrit grâce à un enseignement explicite de celle-ci et contrôler son activité de lecteur) d’autre part. En raison de cette distinction et des corpus littéraires concernés, l’enseignement de la littérature à l’école ne «serait» donc pas contesté. Je modalise mon propos car je pense que les années à venir confirmeront ou infirmeront la validité de cette hypothèse.
Quant à l’enseignement de la littérature à l’université, il demeure prioritairement un enseignement magistral centré sur l’auteur, l’œuvre et le contexte historique, littéraire et artistique dans lequel celle-ci a émergé, comme je le montre dans un article récent rendant compte d’une enquête par questionnaire menée en 2014 auprès de quatre-vingt-deux professeurs stagiaires de lettres d’une même académie (Ahr 2017a). Il est vrai que certains universitaires s’efforcent de promouvoir un renouvellement de l’enseignement de la littérature: ouverture des corpus à la littérature toute contemporaine, prise en compte de l’actualisation des œuvres par les étudiants lecteurs, articulation entre lecture des œuvres et activités d’écriture, mise en dialogue de la littérature avec d’autres œuvres artistiques, etc. Mais, ces orientations ne sont pas majoritaires. Il est à noter cependant qu’un certain nombre d’universitaires, aux spécialités différentes, se sont engagés dans les débats qui ont dominé la sphère médiatique française au cours de la dernière décennie. En effet, il y a bien une préoccupation commune aux différents acteurs que vous listez dans votre question, et cette préoccupation ne concerne pas seulement la France: il s’agit de donner du sens à l’enseignement de la littérature, ainsi que le soulignent les auteurs de l’ouvrage Conditions de l’éducation:
Les disciplines littéraires sont parmi les plus touchées par le phénomène de perte de sens. [...]
Il faut se demander: pourquoi la littérature? On ne peut échapper à la question. Là-dessus les réformateurs ont raison. Il est vain de se voiler la face, le sens de l’enseignement de la littérature fait aujourd’hui question. Cette question doit être affrontée sans tabou ni préjugés. Est-ce l’objet littéraire en tant que tel qui est en cause, ou bien une certaine littérature? Est-ce sa fonction en général qui est atteinte, ou bien une certaine façon de la mettre en œuvre? En tout cas, l’interrogation sur la justification de cet enseignement ne saurait être éludée? (Blais, Gauchet & Ottavi, 2008:93, 95).
C’est un aspect que je développe, entre autres, dans le premier chapitre de la première partie de l’ouvrage auquel vous faites référence, en m’appuyant notamment sur les essais publiés au cours de la dernière décennie par des chercheurs dont les travaux s’inscrivent dans des champs différents 9. Consensus il y a donc quant à la nécessité de redéfinir les finalités de cet enseignement, de l’adapter à la réalité sociale, sociétale et technologique d’aujourd’hui.
En France, les prescriptions institutionnelles actuelles du lycée professionnel, de l’école et du collège s’appuient sur les travaux de recherche en didactique de la littérature menés depuis le tournant du XXIe siècle. Elles définissent clairement les finalités de l’enseignement de la littérature: acquisition d’une culture littéraire et artistique, formation personnelle, formation d’un esprit critique et de jugements de goût 10, mais aussi, pour l’école et le collège, compréhension de l’écrit, «[l]es activités de lecture mêl[a]nt de manière indissociable compréhension et interprétation» (2015:109). Cependant, leur mise en application requiert un accompagnement de la part de l’institution afin que les enseignants s’emparent également des fondements épistémologiques sur lesquels ces programmes reposent et donnent ainsi du sens aux choix didactiques qu’ils opèrent. De plus, la validité de ces prescriptions se trouve, pour l’école et le collège, contestée par le ministère recomposé suite aux élections présidentielles, et cette contestation concerne précisément les finalités que ces programmes attribuent à l’enseignement de la littérature et autour desquelles ils s’organisent. On perçoit bien ici les liens qui unissent littérature, idéologie et politique, encore aujourd’hui. Si l’on admet avec Antoine Compagnon que «l’initiation à la langue littéraire et à la culture humaniste, moins rentable à court terme, semble vulnérable dans l’école et la société de demain» (2007:31), on comprend aisément que cet apprentissage soit peu conforme à une idéologie basée sur la «rentabilité» immédiate. Néanmoins, force est de reconnaitre la nécessité d’interroger les contours de cette discipline scolaire – et, en premier lieu, les «justifications» de son enseignement, comme le confirme le choix que vous avez opéré pour ce premier dossier –, et de l’adapter à la société d’aujourd’hui. Donner du sens à cet enseignement et réévaluer ponctuellement ce sens à l’aune des évolutions sociétales et technologiques (et non politiques), certes ! Mais prenons le temps 11 de réfléchir aux enjeux prioritaires auxquels cet enseignement est susceptible de répondre et faisons en sorte que la recherche soit une force suffisamment convaincante et peut-être aussi persuasive pour influencer les choix politiques, desquels dépend la formation des citoyens de demain {{On remarquera la «composante affective» qui caractérise mon propre propos ! Peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit du devenir des enfants et des adolescents à la formation desquels nous contribuons, de façon plus ou moins directe selon nos statuts respectifs?}.
La littérature est enseignée du primaire à l’université. Et chaque degré de scolarité ou de formation en fait un objet adapté à ses fins, à ses méthodes et à ses publics. Cela implique-t-il, dans les faits, qu’il y a autant de justifications de l’enseignement de la littérature qu’il y a de programmes ou de filières? Ou observe-t-on, au contraire, des cohérences partielles au sein de ces étapes multiples de la scolarisation et des études?
Je me permets tout d’abord de revenir sur votre affirmation: autant je vous rejoins quand vous précisez que «chaque degré de scolarité ou de formation fait [de la littérature] un objet adapté à ses fins, à ses méthodes», autant je nuancerais pour ce qui concerne l’adaptation de cet enseignement «à ses publics» dans la mesure où, d’une part, ces publics évoluent aujourd’hui très rapidement (par exemple, la culture des jeunes de 2018 est-elle vraiment celle des générations précédentes auxquelles appartiennent les adultes qui les forment?) et, où, d’autre part, la massification de l’enseignement, que j’ai évoquée précédemment, a pour conséquence de diversifier considérablement la population scolaire, voire universitaire. Sont-ce exactement les mêmes publics auxquels on enseigne si l’on exerce dans un établissement situé dans le centre d’une grande ville, ou dans un établissement situé à la périphérie de celle-ci? Or, les programmes scolaires français sont effectivement nationaux 12!
Pour répondre à votre question, il me faut distinguer les différents acteurs qui, d’une façon ou d’une autre, tentent d’assurer un continuum entre les divers paliers de l’enseignement scolaire et universitaire de la littérature. Et, faute de connaitre suffisamment bien l’histoire et la réalité présente d’autres systèmes éducatifs et universitaires, je limiterai ma réflexion à la France.
Les discours institutionnels tendent, de façon plus marquée aujourd’hui, à promouvoir une progression curriculaire de l’enseignement scolaire de la littérature. Ces discours favorisent la mise en place d’actions de formation professionnelle visant à assurer la liaison entre les différents cycles et degrés d’enseignement (liaison école/collège, collège/lycée, par exemple). Cependant, ces actions restent minoritaires et généralement d’une efficacité relative, compte tenu de la durée qui leur est accordée (le plus souvent, trois journées réparties sur une année scolaire). Comme j’ai pu le remarquer, ayant assuré moi-même ce type de formation, quand, sous l’impulsion de l’inspection, d’un chef d’établissement ou des enseignants eux-mêmes, ces actions de formation continue s’inscrivent dans la durée (sur deux ou trois années, par exemple), les échanges entre enseignants ne se centrent pas seulement sur les contenus et les modalités d’enseignement, mais également sur les finalités de cet enseignement (non sur «le faire», mais sur le (pourquoi/pour quoi faire»). Par ailleurs, autant il semble possible de faire émerger une certaine continuité entre l’enseignement de la littérature à l’école élémentaire et celui dispensé en début de collège 13, autant les difficultés surgissent quand il s’agit de faire réfléchir les professeurs à la liaison collège/lycée. Deux raisons peuvent expliquer cette situation. La première concerne la pression que les examens exercent sur les choix didactiques des enseignants: la préparation au baccalauréat 14 conduit les professeurs de lycée à privilégier un enseignement, souvent magistral, centré sur les procédés d’écriture à la source des effets programmés par le texte sur la réception par le «lecteur modèle» 15; la préparation au Diplôme national du brevet, que les élèves passent à l’issue de leur dernière année de collège, invitent les professeurs à privilégier l’étude de la langue et la compréhension de l’écrit 16[4]. La seconde raison tient à l’identité des concepteurs des programmes (spécialistes de la discipline ou de la didactique de cette discipline): cette identité détermine les conceptions de la littérature et des finalités de son enseignement ainsi que les fondements épistémologiques sur lesquels les programmes d’enseignement reposent 17.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la continuité entre l’enseignement scolaire et l’enseignement universitaire de la littérature, même si des mesures sont prises par l’institution pour assurer à tous la réussite de cette transition, les écarts en termes de finalités, de contenus et de modalités sont importants dans l’ensemble des disciplines, comme le souligne un article de Sophie Blitman, publié dans Le Monde du 25 mai 2017, au titre évocateur: «Du lycée à l’université: le grand écart». La journaliste, qui a mené une enquête auprès d’enseignants exerçant dans des universités réparties sur l’hexagone, note au sujet de l’enseignement des lettres:
En lettres, l'apprentissage de la grammaire et de la linguistique est renforcé en licence, où les étudiants élargissent par ailleurs leur culture littéraire en se confrontant davantage à des œuvres anciennes, du Moyen Âge ou du XVIe siècle. Mais «il existe une relative continuité, dans la mesure où l'objectif, in fine, est de comprendre le sens des textes», relève Cécile Rochelois, maître de conférences à l'université de Pau et membre de l'Association des professeurs de lettres.
[…] «Alors que les lycéens sont surtout formés à l'analyse stylistique et à l'interprétation d'un texte seul, on leur demande, à l'université, de disserter sur plusieurs œuvres qu'il s'agit de mettre en relation les unes avec les autres, en les replaçant dans leur contexte historique et idéologique», indique Romain Vignest, président de l'Association des professeurs de lettres. Et de souligner que «l'université attend une vision plus globale qui fait parfois ressortir le manque de culture des étudiants».
Les finalités de l’enseignement universitaire de la littérature seraient donc tout d’abord de développer la culture littéraire des étudiants et, «in fine», de leur permettre de «comprendre le sens des textes». Peut-on dès lors parler d’«une relative continuité» entre l’enseignement scolaire et l’enseignement universitaire de la littérature?
Enfin, les plans de formation initiale des enseignants, que proposent les Écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ) créées en 2013, prévoient des actions visant à favoriser une réflexion sur la continuité des apprentissages de l’école au lycée. Les enseignant débutants sont donc sensibilisés à la nécessité d’envisager leur enseignement de la littérature au sein d’un espace qui ne se réduit pas au(x) seul(s) niveau(x) dans le(s)quel(s) ils enseignent ou enseigneront. Cependant, ainsi que je le montre dans un article paru très récemment (Ahr 2017b), une harmonisation des discours institutionnels s’avère indispensable: la confrontation des rapports de jury des deux épreuves orales du Capes externe de lettres modernes des trois dernières sessions (2014-2016) et des divers textes et documents officiels cadrant aujourd’hui l’enseignement de la littérature dans le secondaire me conduit à mettre au jour certaines contradictions, qui reflètent des conceptions différentes – ou, tout du moins, non stabilisées – de l’enseignement scolaire de la littérature, notamment en lien avec les autres langages artistiques. Ces contradictions sont à la fois internes, puisqu’on relève des orientations divergentes au sein des diverses commissions ou bien d’une année sur l’autre, et externes, si l’on met certaines de ces orientations en écho avec celles privilégiées par le ministère de l’Éducation nationale dans ses textes de cadrage récents.
En conclusion, ce premier «dossier» de Transpositio consacré aux «justifications de l’enseignement de la littérature» dans une perspective à la fois synchronique et diachronique montre combien il est important de réfléchir à l’articulation possible, aujourd’hui, entre ces diverses justifications et cela, à tous les paliers de la scolarité et de la formation universitaire et professionnelle. En effet, que ces finalités soient d’ordre cognitif, langagier, esthétique, culturel, éthique, social et/ou philosophique, elles déterminent la nature des connaissances et des compétences à construire ou à développer et, par voie de conséquence, les situations d’enseignement les plus propices à la réalisation des objectifs d’apprentissage ainsi clairement définis tant par/pour l’enseignant que par/pour l’élève. Avant d’enseigner ou d’apprendre la littérature, il y a lieu, dans un cas comme dans l’autre, de savoir «pour quoi faire», «pourquoi étudier la littérature», aspect auquel bon nombre de chercheurs (voir note 9) se sont intéressés au cours de la dernière décennie. C’est à cette condition que le professeur, quel que soit le niveau dans lequel il enseigne, opérera les choix didactiques adéquats (connaissances et compétences visées, contenus et modalités d’enseignement, corpus, supports, évaluations) et que les élèves, comme les étudiants, prendront plaisir à découvrir des textes et des œuvres dont la lecture leur est généralement imposée.
Votre ouvrage aborde la spécificité française des «disputes» concernant l’enseignement de la littérature. Cela signifie-t-il que la France fait exception sur ce point?
Si j’aborde dans l’ouvrage la spécificité française des «disputes», c’est en premier lieu parce que c’est l’espace que je connais le mieux. Mais il me semble aussi que les liens qui se sont tissés au cours des siècles entre littérature, école et politique sont spécifiques à la France et expliquent les changements successifs des programmes de français et, en particulier, de ceux de littérature, qui reposent sur des conceptions différentes du littéraire et sur des enjeux différents assignés à son enseignement.
Francis Marcoin explique, par exemple, dans son ouvrage À l’École de la littérature les liens étroits qui unissent l’École et la littérature:
École et Littérature, Littérature et École, de quelque façon qu’on prenne les choses, ce couple reste inséparable dans la France telle qu’elle s’est constituée tout au long du XIXe siècle, depuis la Révolution de 1789. Les livres ont existé bien avant la généralisation de l’instruction, et inversement il existait de la lecture sans livre et sans littérature. Mais l’Institution littéraire et l’Institution scolaire se sont développées solidairement et conflictuellement, en débordant le domaine d’une minorité lettrée ou d’une demande populaire fractionnée pour s’ouvrir à l’ensemble d’une population qui a fait siennes les images idéales où se construit la figure du lecteur que tous ne seront pas, mais que chacun rêve d’être. […] Sur le long terme, c’est l’école qui, bien ou mal, assure à la littérature l’essentiel de son statut, en diffusant les textes, en créant un horizon d’attente, en soutenant la commercialisation des livres (activités de lectures suivies, lectures conseillées) et en générant une corporation enseignante dont au moins une forte minorité est étroitement mêlée à la production et à la consommation de littérature. (1992:68-69)
De plus, comme je l’ai déjà rappelé, la littérature française et donc son enseignement ont été longtemps considérés en France comme un vecteur d’unification sociale. C’est notamment ce que tend à souligner la Circulaire du 15 juillet 1890:
Les grands écrivains français figurent à présent sur tous les programmes: dans l’enseignement spécial ils tiennent la première place, par les écoles supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses ils pénètrent dans l’enseignement primaire pour l’élever et le vivifier. N’offrent-ils pas ainsi le lien que l’on cherchait pour unir entre eux, sur quelques points du moins, des enseignements si dispersés? Du lycée à la plus modeste école de village ne peut-il ainsi s’établir une sorte de concert entre tous les enfants de la même patrie?
Il est quelques grands noms que tous connaîtront, quelques belles pages que tous auront lues, admirées, apprises par cœur: n’est-ce pas une richesse de plus ajoutée au patrimoine commun? N’est-ce pas un précieux secours pour maintenir, par ce qu’il a de plus intime et de plus durable, l’unité de l’esprit
national 18?
Et, effectivement, dans les instructions publiées sous les IIIe et IVe République, le caractère national de la littérature est fortement souligné. Après la suprématie des textes antiques dans l’enseignement des lettres, il apparait comme fondamental que l’école de la République transmette à ses futurs citoyens le patrimoine culturel sur lequel elle s’est fondée. De même, les avant-propos qui accompagnent les manuels font apparaitre un discours qui insiste sur la précellence de la littérature française, signe du «génie français» 19. Je cite ici un exemple parmi bien d’autres:
De plus, ils [les textes littéraires] sont empruntés exclusivement à la littérature française,les traductions des œuvres étrangères se prêtant peu à la culture littéraire et à la formation du goût. Mais lorsque les traducteurs s’appellent Fénelon ou Leconte de Lisle, leurs traductions d’Homère appartiennent évidemment à la littérature française. À ce titre, nous le savons retenues. (Philippon & Plantié, 1927. Je souligne.)
Je ne peux pas développer cet aspect dans le cadre de cette «conversation critique», mais l’analyse diachronique des instructions officielles et des manuels publiés au XXe siècle (Jey 1998; Houdart-Merot 1998; Ahr 2005; contribution de Marie-France Bishop à ce premier dossier de Transpositio) confirme la prédominance de la littérature «franco-française» dans les programmes scolaires français, celle-ci étant considérée comme un bien national dont l’École doit assurer la transmission. Ce n’est qu’au tournant du XXIe siècle où l’on observe une certaine ouverture aux autres littératures, que les programmes de l’école, du collège et du lycée général et technologique de la fin des années 2000 remettent en question. Nouveau ministère peu d’années plus tard, nouveaux programmes pour l’école et le collège fondés sur une conception plus ouverte de la littérature et des finalités de son enseignement ! On ne peut nier que celui-ci repose, en France, sur des conceptions idéologiques contrastées et donc sur des choix politiques qui varient au fil des changements gouvernementaux. C’est d’ailleurs ce que Paul Aron laisse entendre à la toute fin de son article du Dictionnaire du littéraire auquel j’ai déjà fait référence, puisqu’il précise que «l’idée qu’un président de la République se sente obligé de faire état de ses préférences littéraires est caractéristique de la relation qui unit politique et littérature dans la tradition française» (2002:591).
Pour conclure, si vous le voulez bien, permettez-nous une question un peu plus personnelle. On l’a vu, les répertoires de justification de l’enseignement de la littérature sont pluriels aujourd’hui, et ils se multiplient d’autant si l’on privilégie une approche historique sur la longue durée. À considérer toutefois l’avenir de cet enseignement, lequel de ces répertoires vous semble-t-il le plus pertinent et le plus prometteur?
Je ne pense pas qu’un répertoire soit «plus pertinent» et «plus prometteur» qu’un autre. J’estime, en revanche, que les multiples finalités assignées, hier et aujourd’hui, à l’enseignement de la littérature doivent être étayées épistémologiquement – cet étayage devant conjuguer divers champs théoriques des sciences humaines et sociales – et que ces justifications plurielles soient connues des enseignants, à quelque niveau qu’ils exercent, afin qu’ils opèrent des choix didactiques motivés. D’ailleurs, n’est-ce pas là l’un des enjeux de votre revue et, plus particulièrement, de ce premier dossier?
Avant de donner à lire et, éventuellement, d’étudier collectivement une œuvre ou un texte littéraire, la question à se poser est en effet non de savoir si elle/il est ou non conforme aux prescriptions institutionnelles (si elle/il figure dans les programmes), si cette étude préparera efficacement la classe aux évaluations certificatives, mais de savoir si elle répond aux enjeux que l’enseignant donne à son enseignement à un instant T en fonction du profil et des besoins des élèves, besoins en termes d’apprentissages et de formation personnelle (connaissances et compétences inscrites dans les référentiels, développement d’une culture littéraire et artistique, construction de l’identité individuelle et sociale, découverte de l’autre, etc.). Il revient donc à chacun de se demander, en premier lieu, pourquoi/pour quoi il choisit de faire lire et étudier à cette classe cette œuvre, ce texte; dans quelle mesure ce choix contribuera efficacement à la formation de ses élèves lecteurs, sachant que cette formation est d’une grande complexité et que l’on ne cherche pas, à l’école (et peut-être aussi, dans certains cas, à l’université), à former des lecteurs experts mais des lecteurs autonomes, capables de comprendre ce qu’ils lisent, d’interroger les représentations de l’homme et du monde que l’œuvre ou le texte leur renvoient, de percevoir l’aptitude du langage à dire le monde (dans sa diversité), d’émettre un jugement esthétique et/ou éthique personnel fondé, etc. De la réponse à ces questions préliminaires dépendront les choix que l’enseignant opérera pour ce qui concerne les modalités et les supports d’enseignement et d’apprentissage, ceux-ci pouvant être aujourd’hui de natures fort diverses20 et leur utilisation produisant également des effets différents en termes d’apprentissages.
Et, pour conclure, je reprendrai l’une des phrases par lesquelles j’achève la réflexion que je mène dans l’ouvrage qui est le point de départ de cette «conversation critique»: «Littérature, lecture, culture, humanité se déclinent désormais au pluriel». C’est, selon moi, cette pluralité qui est à privilégier dans l’enseignement de la littérature et qui doit aussi caractériser les finalités qui lui sont assignées. Il faut veiller cependant à ce que chacune d’elles conduise à des choix didactiques adéquats. Lire une œuvre littéraire ou lire un extrait de cette œuvre ne répondent pas à la même finalité. Lire (étudier) une œuvre pour rendre compte de sa compréhension globale, pour identifier le courant littéraire et artistique dans lequel elle s’inscrit, pour interroger le passé à la lumière du présent et/ou le présent à la lumière du passé, pour confronter son propre système de valeurs à celui porté par un ou des personnages, pour découvrir une culture temporellement et/ou géographiquement différente, pour développer sa sensibilité esthétique, etc., conduit à développer des postures de lecture et, de fait, des modalités d’enseignement et d’apprentissage différentes mais aussi complémentaires. On mesure combien la tâche de l’enseignant est complexe aujourd’hui (indéniablement, bien plus qu’hier) et, par conséquent, combien il est important d’assurer la circulation des savoirs entre la recherche, la formation et le terrain enseignant. On ne peut donc que féliciter l’équipe à l’origine de ce projet de création d’un «espace collectif de recherche sur l’enseignement de la littérature», accessible à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, se sentent concernés par cet enseignement, objet de multiples controverses, passées et présentes, qui sont aussi le signe de sa vitalité.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2005), L’enseignement de la littérature au collège, Paris, L’Harmattan.
Ahr, Sylviane (2017a), «Les écritures de la réception chez les professeurs stagiaires de lettres», in Les formes plurielles des écritures de la réception, Namur, Presses Universitaires de Namur, coll. Diptyque, vol. 1, p. 95-109.
Ahr, Sylviane (2017b), «L’enseignement de la littérature en dialogue avec les arts: des discours institutionnels à harmoniser», Pratiques, 175-176 | 2017, mis en ligne le 22 décembre 2017.
Arnaud, Louis et Charlotte (1973), Textes vivants – Expression personnelle – Sixième, Paris, Magnard, 1973 (livre du professeur).
Aron, Paul, Denis Saint-Jacques & Alain Viala (dir.) (2002), Le dictionnaire du littéraire, Paris, Presses Universitaires de France.
Baluteau, François (2001), «Le collège et ses tensions» in Collèges sous tension. Perspectives documentaires en éducation, n° 50/51, INRP, p. 5-9.
Bishop, Marie-France (2016), «Lire, comprendre, interpréter? Quels objectifs pour la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire, en France, depuis la fin du XIXe siècle», in A. Petitjean (dir.), «Didactique du français et de la littérature», Recherches textuelles, n° 14, Metz, CREM Université de Lorraine, p. 367-386.
Blais, Marie-Claude, Marcel Gauchet & Dominique Ottavi, (2008), Conditions de l’éducation,Paris, Stock.
Burgos, Jean (1977), «Littérature-inventaire ou littérature à réinventer? Regard sur le Second Degré», in L’enseignement de la littérature – Crise et perspectives, Actes du colloque organisé par la Faculté des Lettres modernes de Strasbourg (11-12 décembre 1975), Paris, Nathan, «Université Information Formation», p. 87-97.
Canvat, Karl (2001), «Recherches et formation au Cedocef (Centre d’étude et de documentation pour l’enseignement du français de l’Université de Namur)», in Marie-José Fourtanier, Gérard Langlade, Annie Rouxel (dir.), Recherches en didactique de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 150-154.
Caune, Jean (2013), Pour des humanités contemporaines – Science, technique, culture: quelles médiations?, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Citton, Yces (2007), Lire, interpréter, actualiser – Pourquoi les études littéraires?, Paris, Éditions Amsterdam.
Citton, Yves (2010), L’avenir des humanités – Économie de la connaissance ou cultures de l’interprétation?, Paris, La Découverte.
Compagnon, Antoine (2007), La littérature, pour quoi faire?, Paris, Collège de France / Fayard.
Denizot, Nathalie (2015), «Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire», Tréma, n° 43, mis en ligne le 25 juin 2015, consulté le 30 septembre 2015.
Descazaux, Pierre & Alfred Littman (1968), Lire – Troisième, Paris, Bordas.
Doueihi, Milad (2008), La grande conversion numérique, suivie de Rêveries d’un promeneur numérique, Paris, Éditions du Seuil.
Doueihi, Milad (2011), Pour un humanisme numérique, Paris, Éditions du Seuil.
Dufays, Jean-Louis (dir.) (2007), Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
Dulong Gustave (1925), Morceaux choisis des Auteurs Français – Troisième, Paris, Delamain.
Élèves-inspecteurs de l’École nationale supérieure de Saint-Cloud (1972), Un demi-siècle de pédagogie du français à travers les textes officiels (1923-1972), ENS Saint-Cloud, C.R.E.F.E.D., CRDP Limoges.
Fraisse, Emmanuel ([1989], 2000, 2e éd.), «Le livre, la lecture et le lecteur dans la critique littéraire en France (1880/1980)», in Anne-Marie Chartier & Jean Hébrard, Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, BPI Centre Pompidou, p. 561-594.
Houdart-Merot, Violaine (1998), La Culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes / Adapt Éditions.
Jey, Martine (1998), La littérature au lycée - Invention d'une discipline (1880-1925), Metz, CREM Université de Lorraine.
Jey, Martine (2001), «L’enseignement du français et ses enjeux sociaux: le point de vue de Lanson», in Marie-José Fourtanier, Gérard Langlade, Annie Rouxel (coord.), Recherches en didactique de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes p. 35-39.
Jouve, Vincent (2010), Pourquoi étudier la littérature?, Paris, Armand Colin.
Maingueneau, Dominique (2006), Contre Saint Proust ou la fin de la littérature, Paris, Éditions Belin.
Marcoin, Francis (1992), À l’école de la littérature, Paris, Les Éditions Ouvrières.
Merlin-Kajman, Hélène (2016), Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard, NRF Essais.
Ministère de l’Éducation nationale (2009), Lycée professionnel – Ressources Baccalauréat professionnel – Lire. En ligne.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2015), Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). En ligne.
Philippon, P. & B. Plantié (1927), Les Lectures littéraires de l’école – Cours supérieurs, Cours complémentaires et EPS, Paris, Larousse.
Rosier, Jean-Maurice, Didier Dupont & Yves Reuter (2000), S’approprier le champ littéraire. Propositions pour travailler l’institution littéraire en classe de français, Bruxelles, DeBoeck-Duculot.
Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires – Pourquoi et comment étudier la littérature?, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse.
Vaillant, Alain, (2011), L’histoire littéraire, Paris, Armand Colin.
Veck, Bernard (dir.) (1994), La culture littéraire au lycée: des humanités aux méthodes, Paris, INRP.
Viala, Alain, (2005), «Former la personne et le citoyen – Entretien avec Alain Viala», Le Débat, n° 135, Paris, Gallimard, p. 7-21.
Pour citer l'article
Sylviane Ahr, "Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature", Transpositio, Conversations critiques, 2018https://www.transpositio.org/articles/view/entretien-disputes-et-justifications-de-l-enseignement-de-la-litterature
Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique
Vouloir interroger « les modalités de circulation des savoirs entre la recherche et les pratiques enseignantes », objectif des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature et du présent dossier qui en est issu, relève d’une intention dont peu d’acteurs ou d’actrices de ce champ contesteront la pertinence – sans qu’aucun·e, assurément, ne suppose que cette question soit neuve. De même que « la question de savoir si la philosophie peut devenir pratique est aussi ancienne que la philosophie » (Habermas 2008 : 487), de même que les sciences humaines et sociales sont, depuis leur constitution au XIXe siècle, confrontées à « la problématique de l’intervention » (Bronckart 2001 : 133), de même on peut aisément dire qu’il n’y a pas eu d’époque où le problème des relations entre recherche et pratique dans le domaine de l’éducation n’ait pas été posée, en général d’ailleurs d’une manière négative – des deux côtés. Comme le dit Huberman (1992 : 69) :
Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique
Introduction
Vouloir interroger «les modalités de circulation des savoirs entre la recherche et les pratiques enseignantes», objectif des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature et du présent dossier qui en est issu, relève d’une intention dont peu d’acteurs ou d’actrices de ce champ contesteront la pertinence – sans qu’aucun·e, assurément, ne suppose que cette question soit neuve. De même que «la question de savoir si la philosophie peut devenir pratique est aussi ancienne que la philosophie» (Habermas 2008 : 487), de même que les sciences humaines et sociales sont, depuis leur constitution au XIXe siècle, confrontées à «la problématique de l’intervention» (Bronckart 2001 : 133), de même on peut aisément dire qu’il n’y a pas eu d’époque où le problème des relations entre recherche et pratique dans le domaine de l’éducation n’ait pas été posé, en général d’ailleurs d’une manière négative –des deux côtés. Comme le dit Huberman:
Le fossé entre l'univers de la recherche scientifique et celui de la pratique éducative a toujours passionné les esprits. Dans la plupart des cas, nous constatons ce phénomène à travers les litanies d'une communauté à l'égard de l'autre. (Huberman 1992 : 69)
D’une certaine manière, cette question a la caractéristique paradoxale des questions vives: par définition, elle ne donne pas lieu à des réponses consensuelles, mais en même temps on sent bien qu’elle a quelque chose de convenu, qui facilite sa répétition. Et il y a tout lieu de croire que, s’agissant des relations entre la recherche et l’enseignement, la question restera éternellement programmatique comme dans l’appel de Pastiaux-Thiriat et Berbain (1990) «pour une interactivité entre la recherche et les enseignants».
C’est sans doute en fait qu’une telle question contribue à façonner l’identité des acteurs qui (se) la posent. Et c’est ce qui explique sa constante reprise –et particulièrement dans des disciplines dont l’identité se questionne, comme c’est le cas de la didactique de la littérature. Car c’est bien à son identité que l’on touche quand on (re)pose cette question et qu’on la pose en des termes toujours identiques et toujours renouvelés: toujours identiques, car il suffit de lire des textes de notre champ des dernières décennies pour que la question d’aujourd’hui ne fasse pas l’effet d’une découverte; toujours renouvelés, parce que les contextes changent et se chargent de donner un écho particulier à nos discours, qui, de ce seul fait, se renouvèlent.
C’est dans cette optique je me propose ici d’identifier les questions identitaires qui sont en jeu dans la didactique de la littérature. Au reste, celle-ci existe-t-elle comme discipline? On peut voir là une manière de parler, pour désigner les approches didactiques de la littérature comme un contenu spécifique, de la même manière que l’on peut parler de la didactique de la grammaire, du nombre, de la danse, etc. On peut aussi entendre l’expression comme le nom d’une discipline de recherche autonome, comme on parle de didactique des mathématiques, de didactique de l’EPS, de didactique du français. Dans les deux cas, la question se pose de savoir quels sont les liens –d’appartenance, de concurrence, de complémentarité– que la didactique de la littérature peut entretenir avec la didactique du français, avec d’autres didactiques et/ou avec la didactique comme champ de recherche à la fois unifié et parcellisé.
Je me propose ici, en m’inspirant d’anciens de mes travaux sur la question (ce qui entrainera malheureusement quelque excès dans l’autocitation), de réfléchir assez librement, mais dans un classique plan ternaire, au statut de ce que pourrait être une discipline intitulée «didactique de la littérature», pour interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique (la recherche, l’Institution, la pratique effective), liens que j’envisagerai comme dialogue et/ou contrainte, comme mon titre le laissait entendre.
Une discipline didactique ?
La question disciplinaire, si l’on peut dire, est ancienne, s’agissant de la didactique de la littérature – et elle concerne directement la question qui nous occupe ici des relations entre recherche et pratiques enseignantes. Elle prend en fait sa source dans l’histoire de la didactique du français et dans la relation complexe de cette discipline avec la matière scolaire enseignée. La configuration initiale de la didactique du français, dans les années 1970-1980, s’est faite dans un souci de ne pas reproduire sur le terrain académique la subordination de l’enseignement du français à la littérature. Cette dernière s’observait institutionnellement dans le secondaire, mais était également le fait de l’enseignement primaire, de deux manières : d’une part par la valorisation de la langue littéraire, promue comme modèle de la langue à enseigner, d’autre part par la logique de l’orientation qui amenait, dès ces années-là, tous les élèves du primaire à un cursus secondaire au moins partiel. D’où le choix des didacticien·ne·s, à l’origine, de ne pas isoler la littérature d’autres objets d’enseignement et d’apprentissage, choix revendiqué même par celles et ceux qui, s’inscrivant, par leurs travaux universitaires, dans le champ des études littéraires, se désignaient comme spécialistes de l’enseignement (et plus tard comme didacticien·ne·s) du français, non de la littérature. Ces chercheur·e·s reproduisaient là, d’ailleurs, la revendication d’acteurs et d’actrices de l’enseignement de l’époque, qui tenaient à se dire enseignant·e·s de français et non de lettres, cette distinction de dénomination marquant bien une différenciation de positionnement (vécu comme idéologique) dans la conception de l’enseignement du français. Petitjean, en 1998, 25 ans après la naissance de Pratiques, écrivait que les membres du collectif, dans les années 1970, «ont contribué […] à l’invention collective […] d’une nouvelle discipline (le français vs les Lettres) et d’un champ théorique : la didactique» (1998 : 3).
On voit ici, plus sur le terrain des valeurs que des savoirs, une double circulation entre la recherche et les pratiques enseignantes: celles-ci, dans leur version militante, ont contribué à façonner un champ de recherche; ce dernier a cherché en retour à construire une nouvelle matière scolaire sur le terrain des pratiques. La question qui se posait était celle de la place de la littérature dans l’approche didactique de l’enseignement du français et cette question pouvait être considérée comme relativement vive. En témoigne cet essai de synthèse –ou de compromis?– de 1998, dans le texte d’orientation de l’Association internationale pour la recherche en didactique du français langue maternelle (DFLM), l’ancêtre de l’AIRDF, Association internationale pour la recherche en didactique du français:
Les spécificités du fait littéraire justifient-elles une autonomisation plus radicale de son champ, ou bien plutôt un va-et-vient dialectique entre les démarches centrées sur l’appropriation du fait littéraire et celles qui privilégient le développement de la lecture et de l’écriture. (DFLM 1998 : 31)
Là encore, la question est indissociable de celle de l’unité de la matière enseignée, qui fait l’objet des recherches didactiques. On sait qu’historiquement, la didactique du français a voulu penser de manière intégrative les contenus de la matière français, en la concevant de façon ouverte comme lieu de la construction des compétences (méta)langagières, ce que permettait la mise en avant des notions de textes et de discours (voir Halté 1992). Mais l’unification des problématiques didactiques au sein de la didactique du français ne voulait pas dire que ces dernières étaient indifférenciées : si penser les différences et les liens entre les contenus permet d’éviter les essentialisations hâtives qui sont parfois le fait de croyance débordantes, la vigilance théorique des didacticien·ne·s à l’égard des contenus est assez vive pour qu’elle oblige à se demander ce qu’il peut y avoir de spécifique au traitement respectif de contenus comme la littérature.
Comme le dit Bernard Schneuwly, «la littérature est un objet culturel qui a des discours de référence multiples, mais disciplinairement relativement bien définis, c’est-à-dire avec des disciplines académiques de référence» et on peut identifier le «mode de penser et de parler particulier des pratiques littéraires qui se fondent sur des savoirs tout à fait spécifiques» (Schneuwly 1998 : 271). Ce sont finalement là des questions dont le traitement est rendu possible par les théories qui pensent, de diverses manières, la transposition didactique des savoirs, des pratiques ou des discours de référence.
Encore faut-il ne pas supposer le contenu préalable à sa théorisation didactique ; car quelle consistance épistémologique serait celle d’une discipline qui supposerait tel objet –au hasard: la littérature– susceptible d’un traitement scientifique sans être constamment construit et reconstruit théoriquement par ce même traitement scientifique ? Si la question vaut évidemment pour toutes les didactiques (cf. à cet égard Chevallard 2014), elle intéresse au plus haut point la didactique de la littérature. Pour reprendre les mots de Yann Vuillet, la désignation même de «didactique de la littérature» a quelque chose de surprenant, «eu égard à l’absence de définition conceptuelle “du” littéraire» (Vuillet 2017 : 326). Il y voit comme un «nœud idéologique», sorte de cristallisation «de processus d’évaluations sociales ne pouvant se “trancher” par des savoirs» (Vuillet 2017 : 234). Les travaux genevois sur la réputation littéraire ont apporté des éclairages importants à cet égard (Ronveaux & Schneuwly (dir.) 2019).
Je suis parti, dans l’élaboration de mon questionnement, d’une évocation de la didactique du français et de l’émergence en son sein de questions spécifiques à la littérature. Or il semble qu’il existe peu de débats théoriques, dans les approches didactiques de la littérature, sur les liens possibles entre didactique du français et didactique de la littérature, même si la question est posée de manière claire et intéressante dans la synthèse récente du champ par Sylviane Ahr (2015). Plus encore, il semble que soit peu traitée la question des liens possibles entre didactique de la littérature et autres didactiques, si ce n’est dans une perspective de réflexion transdisciplinaire entre didactique de la littérature et des arts (voir Chabanne 2016). Cela m’a conduit naguère, à l’issue des treizièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature à Gennevilliers en 2012, à m’interroger sur la faible utilisation de concepts élaborés dans d’autres didactiques (Daunay 2015).
S’il est intéressant de penser la spécificité d’une didactique, encore faut-il précisément la penser en faisant le même travail que celui que suscite la récurrence de la «question vive» que mettait à l’honneur la dix-huitième école d’été de didactique des mathématiques: «La didactique ou les didactiques?» (voir Matheron et al. 2016 ; Éducation & didactique 2014). De fait, la question qui se pose entre didactique de la littérature et didactique du français est finalement de même nature que la relation entre les diverses didactiques et c’est à la condition de renouveler constamment ce débat théorique qu’il est possible de prétendre, en respectant toutes les spécificités et les frontières qu’on voudra, construire comme champ spécifique la didactique, «dont l’unité et la diversité se conjuguent» (Daunay 2016 : 318).
Une discipline aux croisements
Pour interroger le processus de disciplinarisation et/ou d’autonomisation de la didactique de la littérature, je me propose de présenter une petite formalisation de la didactique, que j’ai réalisée en m’inspirant librement de deux textes anciens, écrits la même année, de Halté (1992) et de Reuter (dans Brassard & Reuter 1992) –pour suivre le fil historique que j’ai commencé à tendre.
Cette formalisation (dont une première version se trouve dans Daunay 2017) identifie trois possibles orientations de la didactique (de la littérature), complémentaires et non exclusives évidemment, qui se réalisent en dominantes, pour reprendre le terme d’Halté (Halté 1992 : 16). Ces orientations engagent des relations particulières avec des lieux de théories ou de pratiques.
Une première orientation de la didactique concerne le travail qu’elle réalise sur les contenus disciplinaires, en l’occurrence les contenus qui ont trait aux questions de littérature. La didactique est alors liée aux théories de références qui concernent les contenus, pour nous les théories littéraires, mais aussi l’analyse du discours, entre autres.
Orientation épistémologique
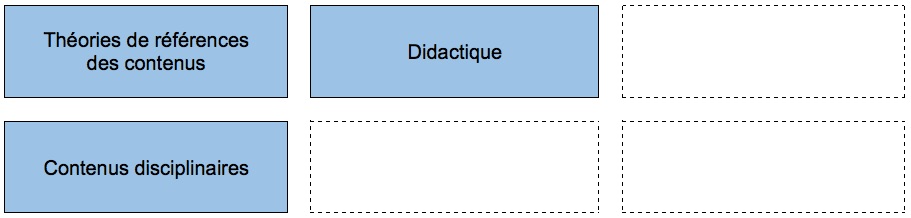
Une deuxième orientation que je nommerai subjectiviste renvoie à la préoccupation de la didactique (de la littérature, entre autres) pour les sujets didactiques (élèves comme enseignant·e·s) et les diverses institutions qui les assujettissent. Cette préoccupation théorique engage des relations avec des disciplines qui, sans nécessairement prêter d’attention aux contenus, s’intéressent aux sujets et aux institutions, de la psychologie à la sociologie, en passant par l’histoire, l’anthropologie, la philosophie, etc.
Orientation subjectiviste
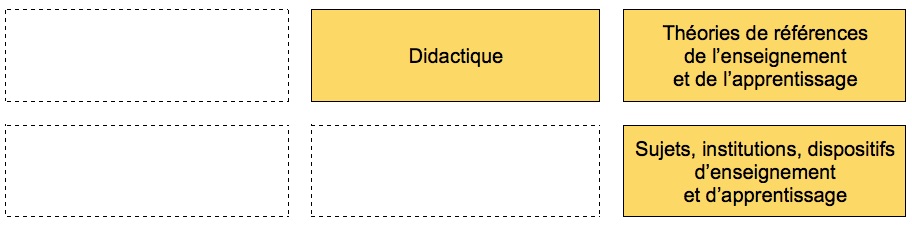
Une troisième orientation serait celle qu’Halté appelait praxéologique, qui établit une relation entre la didactique de la littérature et les pratiques disciplinaires, c’est-à-dire celles qui concernent cette discipline scolaire «littérature», quelle que soit sa relation aux autres disciplines de la matière «français»:
Orientation praxéologique
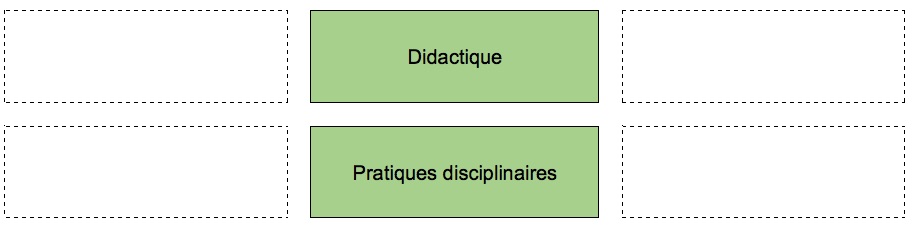
Bien sûr, cette orientation est indissociable des sujets et des contenus et il vaudrait mieux identifier ainsi la dimension praxéologique:
Orientation praxéologique (2)
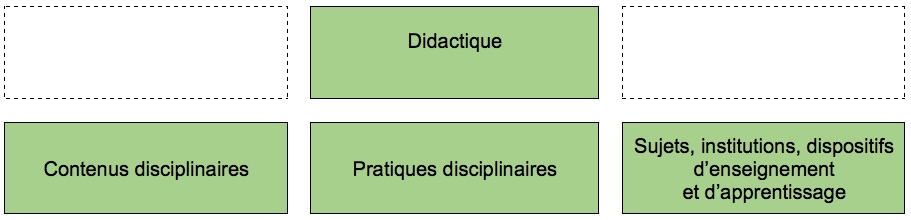
Rappelons les cases disparues et nous retrouvons l’ensemble des relations spécifiques que la didactique noue avec d’autres lieux.
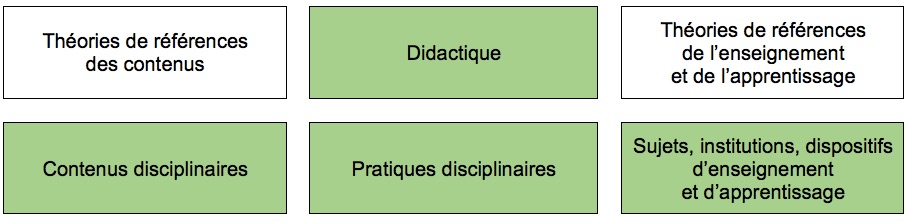
Ce schéma dit bien la dimension systémique de la didactique (Halté 1992), mais aussi sa fragilité, qui tient à ses relations multiples avec des lieux variés, qui ont pu longtemps rendre difficile son autonomie, gage de sa disciplinarisation. C’est sur ce point que je voudrais m’arrêter maintenant, en interrogeant plus spécifiquement, au-delà du caractère généraliste de cette formalisation, la didactique de la littérature.
Les conditions d’une autonomie
La question de la disciplinarisation de la didactique de la littérature n’est pas sans rappeler celle qui s’est posée historiquement dans le processus de construction de la didactique du français comme discipline de recherche, faites de «tensions constitutives» que j’ai analysées ailleurs (Daunay 2007b: 21-28). Sans pouvoir reprendre cette histoire, rappelons que la didactique du français s’est constituée en cherchant à se libérer d’un paradigme applicationniste, qui pouvait se caractériser par une triple dépendance de la recherche : à l’égard des théories dites de référence (la linguistique essentiellement), à l’égard de l’Institution scolaire à travers ses réseaux décisionnaires ou militants, à l’égard de la pratique de terrain, matière qu’il s’agissait souvent de transformer avant de vraiment la connaitre… Le mouvement d’émancipation de la didactique du français, en quoi consiste son processus de disciplinarisation, n’est pas propre à la didactique du français mais concerne, mutatis mutandis, toutes les didactiques. La didactique de la littérature permet-elle d’observer ce même mouvement d’émancipation? Rien ne permet d’en douter, mais j’aimerais interroger, dans ce qui est encore une phase d’émergence, les modalités des relations entre la didactique de la littérature et ces trois lieux, en faisant jouer des dichotomies sans subtilité, mais utiles pour un débat : soumission ou parité? Dialogue ou contrainte?
Relation entre didactique de la littérature et théorie littéraire
Prenons pour commencer la relation entre la didactique de la littérature et la théorie littéraire, que l’on peut placer dans la case en haut à gauche de notre schéma:
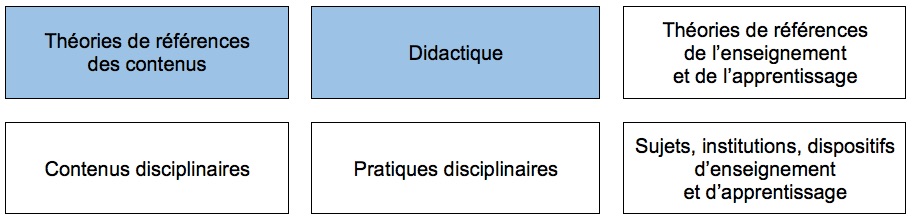
La théorie littéraire est-elle, dans la pratique de recherche effective, essentiellement perçue comme une discipline contributoire ou comme une discipline en surplomb ? Qu’il y ait dialogue entre didactique de la littérature et théorie littéraire est assez naturel. Mais, comme cela a pu être le cas avec la linguistique aux débuts de la didactique du français, la référence vaut parfois révérence : qu’on pense, anciennement, aux théories de Picard (et de Jouve) –peut-être se rappelle-t-on que j’avais, naguère, mis en cause de manière polémique les travaux de Picard, précisément parce que je voyais dans l’usage qui en était fait par certain·e·s didacticien·ne·s, une bévue, dans la mesure où, tout au respect des propositions théoriques de l’auteur, elles ou ils ne voyaient pas ce qui pourtant, dans son discours, était idéologiquement contradictoire avec leur propre projet (Daunay 2007b : 39). Je me demande si l’on n’assiste pas au même phénomène de révérence avec un Pierre Bayard ou un Yves Citton… Pour interroger la possible subordination de la didactique de la littérature aux théories littéraires, on peut se saisir de trois indicateurs, que j’avais utilisés il y a dix ans (Daunay 2007a ; 2007b), pour interroger le statut de la didactique de la littérature:
– l’absence ou la parcimonie des références aux recherches didactiques dans les écrits des théoriciens de la littérature cités par les didacticien·ne·s;
– la rareté des discussions théoriques, en didactique, des propositions de ces mêmes auteurs;
– la primauté accordée à ces derniers en tant que théoriciens, visible particulièrement dans l’usage des syntagmes «théorique et didactique» ou «universitaire et didactique» (voir le titre de la dernière livraison de Pratiques, en 2018 : Poésie et langue : aspects théoriques et didactiques), qui laisse supposer que la didactique n’aurait pas la même vertu conceptuelle que la théorie littéraire instituée comme discipline de référence.
Ces trois indicateurs (qui gagneraient à être actualisés par une étude empirique d’un corpus récent, même si l’on peut intuitivement penser qu’elle donnerait les mêmes résultats) permettent au moins d’interroger une forme de relation de dépendance de la didactique à la théorie littéraire.
J’évoquais plus haut la place encore congrue faite aux autres didactiques –ou encore, entre autres, aux travaux de sociologie des apprentissages ou des usages– dans nombre de travaux de didactique de la littérature. Or la délimitation d’un espace propre de travail ne veut pas dire se priver des dialogues possibles avec les contenus pensés par d’autres disciplines et, au rebours de l’illusion de son irréductibilité, interroger ce qui est commun à l’enseignement de la littérature et de la langue, par exemple en redéfinissant à nouveaux frais le double processus de subjectivation et d’assujettissement que suppose la prise en compte du sujet parlant (donc écrivant, lisant, pensant…) –ce que permet du reste le concept de sujet lecteur ou scripteur, quand il est utilisé de manière ouverte (pensons ici à la question d’«enseigner les littératures dans le souci de la langue», pour reprendre le titre des onzièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique des littératures de Genève : voir Ronveaux 2016). Le projet de didactique comparée peut aider à faire ressortir, dans l’étude d’un phénomène didactique, des «dimensions spécifiques (liées aux objets de savoirs) et génériques (liées à un fonctionnement indépendant de ces objets)», pour reprendre les termes que Florence Ligozat (2016 : 305) emprunte au vocabulaire propre des recherches en didactique comparée, et qu’elle illustre brillamment avec le cas de la lecture-compréhension littéraire dans le cadre des cercles de lecture.
Un rapprochement plus net avec les autres didactiques permettrait de mieux percevoir et de décrire, du point de vue didactique, les limites conceptuelles de certaines constructions théoriques littéraires et surtout l’inanité des propositions prétendument didactiques, c’est-à-dire, sous leur plume, pratiques, de certain·e·s théoricien·ne·s de la littérature, si peu aveuglé·e·s par le travail des didacticien·ne·s qu’ils peuvent gloser sur leurs objets en les ignorant… Cela permettrait de penser, indépendamment, l’origine et le devenir, en didactique de la littérature, de concepts propres, quand bien même ils seraient initialement empruntés : concernant l’emblématique lecture littéraire, on peut citer le travail de synthèse théorique de Brigitte Louichon (2011) et le programme de travail théorique que propose Jean-Louis Dufays (2016) pour affermir le concept, dans le double souci d’une clarification théorique et d’une mise à l’épreuve empirique –même si elle mérite d’être encore discutée (Gabathuler, Védrines & Vuillet 2019).
Finalement, pour parvenir à se discipliner, sans doute faudrait-il que la didactique de la littérature se fasse moins littéraire et plus didactique…
Relation entre didactique de la littérature et Institution scolaire
Qu’en est-il des relations de la didactique de la littérature avec l’Institution scolaire? Celle qui prend sa place dans la partie en bas à droite de notre schéma initial –que l’on peut finalement identifier comme un des champs de réalisation de la didactique:
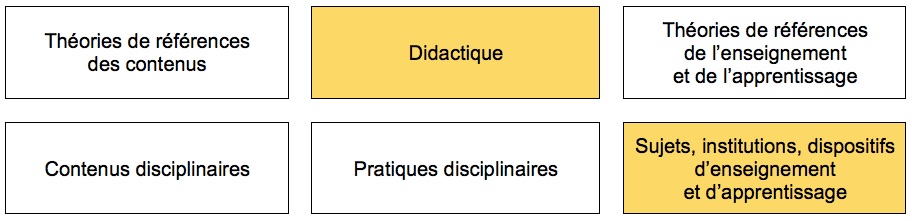
La contrainte peut se voir notamment par l’identification fréquente du discours officiel comme source et non comme corpus de l’étude: pour prendre des exemples en France, nombreux sont les travaux qui supposent l’écriture d’invention inventée par les instructions officielles de 2002 ou qui –au contraire– parlent de la «lecture méthodique», de la «lecture analytique», de la «lecture cursive», de la «lecture d’images», comme si ces choses-là existaient en dehors de leur lieu d’institution, à savoir les programmes.
Ce qui peut sembler une soumission à l’Institution, dans le domaine de l’enseignement de la littérature, me semble avoir été observé, en France, au tournant des années 2000, au moment de l’élaboration de nouveaux programmes (pour le primaire comme pour le secondaire) où la question de l’enseignement de la littérature n’a pas été mineure. Observons d’ailleurs que c’est à cette époque qu’a eu lieu la première édition des Rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature (2000).
La relation entre didactique et Institution ne s’opère alors pas seulement par le mélange des acteurs mais aussi par celui des genres de discours tenus sur les programmes : ainsi, un même contenu peut en effet être écrit par les mêmes personnes dans le cadre des documents d’accompagnement des programmes (sphère institutionnelle) et dans le cadre d’un article théorique (sphère de la recherche) (pour un développement, voir Daunay 2007b: 43). Depuis cette époque, la participation régulière d’inspecteurs ou d’inspectrices à des colloques de didactique de la littérature, qui pourrait être des occasions de confrontation, est plutôt le signe d’une sorte de consensus. Qu’on pense du reste à l’usage du terme didactique pour désigner des épreuves de concours en France ou des prescriptions de bonnes pratiques. Là encore, cette relation avec les représentants de l’Institution scolaire est placée sous le double signe de la contrainte et du dialogue: certes, on voit bien la volonté de penser la prescription comme moyen de diffusion de la recherche, mais ne doit-on pas plutôt y voir le signe d’un cadrage du champ qui réponde à ce qui est légitimement audible pour des représentants de l’Institution?
Que des didacticien·ne·s, en France comme ailleurs, aient participé à l’élaboration de certains programmes n’est un souci pour personne : on peut jouer un rôle de conseil et de proposition ingénierique sans pour autant abdiquer une indépendance théorique par rapport à l’Institution. Le problème est de s’assurer de cette indépendance, du moins si l’on considère que le propre d’une discipline de recherche est de se donner ses propres outils de pensée et d’analyse, ce qui suppose une forte distance avec ce qui existe déjà. Il est intéressant de noter qu’il semble que la didactique de la littérature, dans sa relation avec l’Institution, ait vu se reproduire le même phénomène de relation étroite entre l’Institution et la recherche qu’a connu la didactique du français, puisqu’on peut dire qu’en France, c’est dans des travaux réalisés dans le cadre du plan officiel de rénovation, sous la conduite d’Hélène Romian, qu’émergea la didactique du français. Mais je n’ai pas le souvenir, au début du XXIe siècle, de fortes tensions entre recherche et Institution, comme celle que connut la didactique du français à la sortie des programmes issus du Plan de rénovation, en 1972 (sur ce point, voir Romian 2014).
Relation entre didactique de la littérature et pratiques de classes
L’une des conséquences de ce suivisme à l’égard de l’Institution peut se voir dans la relation à la pratique dans les classes, cette case au centre de notre schéma, autre champ de réalisation de la didactique:
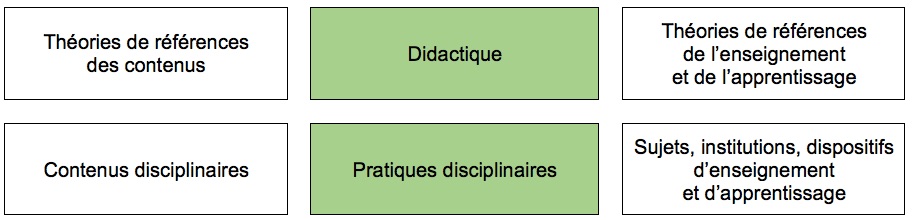
Interroger le lien entre les deux champs permet d’identifier la posture prescriptive parfois prise dans des travaux en didactique. Est-on sûr par exemple de toujours s’interdire de reprocher aux enseignant·e·s de ne pas respecter les instructions officielles, sans s’interroger sur les limites de ces dernières ? Est-on sûr aussi de ne pas privilégier ce qui est perçu comme innovant, reproduisant ainsi «l’anti-traditionalisme affiché par la didactique du français» dont parlait Claude Simard, qui plaidait pour un «un point de vue plus ouvert et plus explicatif face à la tradition» (Simard 2001 : 37) ?
En dehors des dérives évaluatives de certains discours didactiques (voir Daunay 2007c), la question de la soumission aux pratiques est plus sérieuse et, partant, plus complexe, puisque l’on sait le rôle que les pratiques d’enseignement et de formation ont pu jouer dans la construction des didactiques. Comme le dit Bernard Schneuwly, «le champ scientifique “didactique” nait [d’un] large fondement de la didactique pratique et normative» (Schneuwly 2014 : 18). De fait, on peut dire que toute didactique a suivi un processus de «disciplinarisation à dominante secondaire», qui caractérise plus généralement le champ des sciences de l’éducation (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001). Il n’est pas inutile de préciser ici que si tou·te·s les didacticien·ne·s ne relèvent pas du champ institutionnel des sciences de l’éducation, la didactique est, par définition, une science de l’éducation et a partie liée, de ce fait, avec ce champ institutionnel.
La didactique de la littérature, comme la didactique du français, dans son processus de disciplinarisation, a dû «transformer des problématiques pratiques et théorico-pratiques en questionnement scientifique», c’est-à-dire «définir des problématiques, sous forme d’un appareil conceptuel cohérent, sous une forme qui permet de fournir des réponses à travers des méthodes de recherche systématiques et explicites» (Schneuwly 2014 : 18).
La didactique de la littérature, comme les autres didactiques, a encore à s’interroger sur les formes d’hybridation bien spécifiques qu’engendre le frottement d’une théorie et d’une pratique : car sauf à se contenter d’un applicationnisme qui montre vite ses limites théoriques et cantonne le discours qui le réalise dans une vision idéaliste et peu productive d’un point de vue scientifique, la relation entre théorie et pratique ne peut pas ne pas se penser au sein même de la discipline, au prix d’une mise en doute des évidences partagées. Il ne s’agit pas, pour emprunter ses mots à Marc Bru, qui parle plus généralement des sciences de l’éducation, d’«abandonner toute mise en relation des recherches et des pratiques», mais de «modéliser ces relations sans les réduire à une visée applicationniste ou à une version idéalisée, étrangères à ce que sont les pratiques en situation» (Bru 1998 : 54). Une telle modélisation, c’est-à-dire la pensée théorique de ces relations entre théorie et pratique, ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion systématique au sein de la didactique de la littérature et c’est sans doute ce qui rend encore plus légitime la thématique des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature.
J’aimerais à cet égard, pour finir, reprendre les mots de Jean-Paul Bronckart (2001) qui montrait qu’en sciences humaines et sociales, l’opposition entre recherche fondamentale et intervention pratique n’est pas un donné de départ mais l’effet d’une élaboration progressive, qui a abouti au dualisme actuel:
Entre les sciences humaines fondamentales et le domaine de l’éducation, se sont établis les rapports hiérarchiques et descendants de l’applicationnisme : les données scientifiques étaient injectées dans le champ pratique, la plupart du temps sans réelle prise en compte des multiples paramètres qui régissent ce dernier. (Bronckart 2001 : 136)
Et l’on voit bien les effets possibles pour la didactique : du fait de l’orientation praxéologique qui la définit en partie (représentée dans les derniers schémas de la formalisation présentée plus haut), l’applicationnisme est un risque possible.
Bronckart fait la critique de cette conception applicationniste pour en suggérer une autre:
Une telle position s’adosse en réalité à l’idéologie selon laquelle l’éducation-formation constituerait une démarche non problématique de transmission de savoirs non discutables, et c’est bien cette idéologie qui oriente la logique applicationniste préconisée par Piaget aussi bien que par Skinner. Mais si l’on considère que les savoirs, même savants, sont toujours discutables, que les processus de transmission sont complexes et problématiques, et que les enjeux sont en permanence à repenser à la lumière des évolutions réelles des sociétés, alors il y a place pour une science véritable, dont l’objet est constitué par les processus de médiation formative, tels qu’ils sont conçus, gérés et mis en place par les sociétés humaines. (Bronckart 2001 : 138)
Dans sa disciplinarisation, la didactique de la littérature gagnerait sans doute à continuer à penser cette question des relations entre recherches et pratiques, en s’interdisant l’applicationnisme que pourfend si bien Bronckart, sans pour autant se soumettre aux pratiques, autre risque possible que les réflexions de ce dernier minimisent peut-être.
Conclusion
Ce travail de disciplinarisation s’accompagnera nécessairement – et c’est ici le sens de mon propos – d’une identification des risques d’un applicationnisme à trois faces que représente la soumission à des instances extérieures (la théorie littéraire, l’Institution, la pratique). C’est à ce prix que la didactique de la littérature pourra se forger une véritable identité qui la fasse reconnaitre comme un champ théorique à part entière.
Mais si l’on peut trouver un avantage à établir des frontières, c’est à la condition de se rappeler qu’une frontière marque autant la séparation que la continuité : si une discipline gagne à être autonome, c’est pour n’être pas diluée dans un espace qu’elle ne peut pas penser, mais c’est aussi pour pouvoir mieux dialoguer avec d’autres dans cet espace – ce que les schémas initiaux voulaient proposer. Autrement dit, on peut supposer que le processus d’autonomisation de la didactique de la littérature, s’il est mené à son terme, pourra l’amener à se penser comme un «espace dynamique», pour emprunter leur expression à Florey, Ronveaux et Cordonier (2015). Se penser comme «espace dynamique», c’est, loin de toute contrainte de dépendance, se penser dans le dialogue avec d’autres champs de recherche et de pratiques.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2015), Enseigner la littérature aujourd’hui : « disputes » françaises, Paris, Honoré Champion.
Brassart, Dominique Guy & Yves Reuter (1992), « Former des maîtres en français : éléments pour une didactique de la didactique du français », Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11-24.
Bronckart, Jean-Paul (2001), « S’entendre pour agir et agir pour s’entendre », Théories de l’action et éducation, J.-M.Baudouin & J. Friedrich (dir.), Bruxelles, De Boeck Université éd., p. 133-154.
Bru, Marc (1998), « Qu’y a-t-il à prouver, quand il s’agit d’éducation ? La validation scientifique des propos et discours sur les pratiques d’enseignement : après les illusions perdues », in Recherche et éducation. Vers une « nouvelle alliance ». La démarche de preuve en 10 questions, C. Hadji, J. Baillé (dir.), Paris-Bruxelles, De Boeck, p. 45-65.
Chabanne, Jean-Charles (2016), « Langue, littérature, art(s), langage(s) : Didactique de la littérature et didactiques des arts, un dialogue fécond à entretenir et à renouveler », in Didactiques du français et de la littérature, A. Petitjean (dir.), Metz, Université de Lorraine, p. 157-176.
Chevallard, Yves (2014), « Des didactiques des disciplines scolaires à la didactique comme science anthropologique. Sur un obstacle épistémologique, psychologique et institutionnel », Éducation & didactique, n°8 (1), p. 35-44.
Daunay, Bertrand (2007a), « État des recherches en didactique de la littérature », Revue française de pédagogie, n° 159, p. 139-189.
Daunay, Bertrand (2007b), Invention d’une écriture de recherche en didactique du français, Dossier pour l'habilitation à diriger des recherches, soutenue le 29 mai 2007 à l'université Lille 3 (https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01365868/document)
Daunay, Bertrand (2007c), « Comment la recherche didactique évalue les pratiques d’enseignement de la littérature », in Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? Sens, utilité, évaluation, J.-L. Dufays (dir.), Louvain, Presses Universitaires de Louvain, p. 35-43.
Daunay, Bertrand (2015), « La didactique de la littérature, un patrimoine théorique en construction », in Les patrimoines littéraires à l’école. Tensions et débats actuels, M.-F. Bishop & A. Belhadjin (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 403-407.
Daunay, Bertrand (2016), « Didactix ? Manières, termes et enjeux d’un débat didactique », in Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Y. Matheron et al. (dir.), Grenoble, La Pensée Sauvage, p. 311-320.
Daunay, Bertrand (2017), « Didactique du français et didactiques des disciplines : une interdisciplinarité contrainte », in Pluridisciplinarité en sciences humaines. Hommage à Leila Messaoudi, A. Reguigui, H. El Amrani, H. Bendahmane, Ontario, Série monographique en sciences humaines, p. 189-204.
DFLM (1998), « Texte d’orientation de l’association », La lettre de la DFLM, n° 23, p. 28-31.
Dufays, Jean-Louis (2016), « La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique », Tréma, n° 45, p. 9-17.
Éducation & didactique (2014), n°8, (1), Didactiques et/ou didactique ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Florey, Sonya, Noël Cordonier, Christophe Ronveaux & Soumya El Harmassi (dir.) (2015), Enseigner la littérature au début du XXIe siècle. Enjeux, pratiques, formation, Bruxelles, Peter Lang.
Gabathuler, Chloé, Bruno Védrines & Yann Vuillet (2019), « Didactique, réputation littéraire et connivences », Recherches, n° 70, p. 137-162.
Habermas, Jürgen (2008), « Sur le rapport de la théorie et de la pratique », Les Études philosophiques, n° 87, p. 487 à 498.
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, Presses universitaires de France.
Hofstetter, Rita & Schneuwly Bernard (1998/2001), « Sciences de l’éducation entre champs disciplinaires et champs professionnels », in Le pari des sciences de l’éducation, R. Hofstetter & B. Schneuwly (dir.), De Boeck, Bruxelles, p. 7-25.
Huberman, Michael (1992), « De la recherche à la pratique : comment atteindre des retombées “fortes” ? », Revue Française de Pédagogie, n° 98, Paris, INRP, p. 69-82
Ligozat, Florence (2016), « Didactique comparée : quels enjeux pour la construction d’un champ de recherches en didactique ? Une étude de cas en classe de français », in Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Y. Matheron et al. (dir.), Grenoble, La Pensée Sauvage, p. 277-310.
Louichon, Brigitte (2011), « La lecture littéraire est-elle un concept didactique ? » in Les concepts et les méthodes en didactique du français, B. Daunay, Y. Reuter & B. Schneuwly (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 195-216.
Matheron, Yves et al. (dir.)(2016), Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Petitjean, André (1990), « Pour une didactique de la littérature », in Perspectives didactiques en français, D. G. Brassart & A., Petitjean, Metz, Université de Metz, p. 101- 127.
Petitjean, André (1998), « Pratiques a 25 ans », Pratiques, n° 97‑98, p. 3‑5.
Pastiaux-Thiriat, Georgette & Jean-Marie Berbain (1990), « Pour une interactivité entre la recherche et les enseignants », Perspectives documentaires en éducation, n° 21, p. 107-123.
Petitjean, André (1998), « Pratiques a 25 ans », Pratiques, n° 97‑98, p. 3‑5.
Romian, Hélène (2014), « Un “plan de rénovation” de l’enseignement du Français à l’école élémentaire en 1970 », La Lettre de l’AIRDF, n° 56, p. 33-44.
Ronveaux, Christophe (dir.) (2016), Enseigner les littératures dans le souci de la langue, Bruxelles, Peter Lang.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2019), Lire des textes réputés littéraires au fil des degrés scolaires : disciplination et sédimentation. Une enquête dans les classes de Suisse romande, Bruxelles : Peter Lang.
Schneuwly, Bernard (1998), « Tout n’est pas métalangagier dans l’enseignement du français », in Activités métalangagières et enseignement du français, J. Dolz, J.-C. Meyer (dir.), Berne, Peter Lang, p. 267-272.
Schneuwly, Bernard (2014), « Didactique : construction d’un champ disciplinaire », Éducation & didactique, n°8 (1), p. 13-22.
Vuillet, Yann (2017), À la recherche didactique de concepts pour penser, dire et agir le littéraire, Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, sous la direction de J. Dolz-Mestre, soutenue à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
Pour citer l'article
Bertrand Daunay, "Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/entre-dialogue-et-contraintes-interroger-les-liens-entre-divers-champs-de-realisation-de-la-didactique
Voir également :
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
Le plan d’études romand actuel (2010){{https://www.plandetudes.ch/francais}}, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline « français », au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale{{La voie gymnasiale aboutit au certificat de maturité (l’équivalent pour la France du baccalauréat général).}} s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
1. Introduction
Le plan d’études romand actuel (2010)1, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline «français», au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale2 s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
Mais qu’entend-on par «littérature» ici? L’étude de Caron (1992) nous rappelle que le mot littérature dérive du latin litteratura qui désigne au départ le fait de savoir lire et écrire et, par extension métonymique, la connaissance des grands textes qui permet de bien lire et de bien écrire. Avec les lexicographes du XVIIe siècle, le terme désigne avant tout une compétence. Ainsi, dans le dictionnaire de l’Académie de 1694, on trouve l’expression avoir de la littérature, le terme littérature renvoyant ici aussi bien à des textes scientifiques qu'artistiques. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que la littérature va se restreindre progressivement aux ouvrages à visée esthétique, devenant un synonyme de Belles Lettres, avant de s’en démarquer définitivement:
Belles Lettres affirmait une préoccupation prédominante du bien-dire dans l’étude des objets de langage. La multiplication des occurrences de littérature, non marqué à cet égard, ne traduirait-elle pas un recul de cette «utilisation» du texte? Autrement dit, n’assiste-t-on pas au passage d’un commentaire voué à l’acquisition d’un art langagier vers un discours plus «désintéressé», moins «instrumental» que savant, spéculatif, érudit, voire scientifique avant la lettre? (Caron 1992, : 189)
Le passage des Belles Lettres à la littérature se répercute dans le champ scolaire à la fin du XIXe siècle (Houdart-Mérot 1998). Ce processus va de pair avec le déclin des humanités classiques et la disparition du cours de rhétorique, supplanté par une discipline nouvelle, le «français». Savatovsky (1999) rappelle en effet qu’en France le «français» tel que nous le concevons aujourd’hui se met en place à cette période autour de trois principes:
- dans les collèges et les lycées, l’inversion de subordination entre les langues anciennes (grec et latin) et le français, ce dernier n’étant plus un auxiliaire des langues classiques mais une langue étudiée pour elle-même3;
- à l’école primaire, l’enrichissement progressif de la «formule des apprentissages fondamentaux» (Savatovsky 1999 : 37) –lire et écrire– par l’introduction de nouveaux savoirs liés à la langue nationale: projet scolaire d’acculturation et projet politique de francisation, en lieu et place des patois;
- dans les deux ordres d’enseignement, la mise en place de nouveaux exercices, «véritables éléments fédérateurs de la discipline en voie de constitution, et qui permettent d’allier à nouveaux frais la connaissance de la langue et celle de la littérature» (Savatovsky 1999 : 37).
Qu’en est-il en Suisse romande? Quand la littérature française entre-t-elle dans la sphère scolaire et sous l’influence de quels facteurs? Que recouvre alors cette notion et que vient-elle éventuellement remplacer? Par quels exercices est-elle abordée en classe? Et quels acteurs de la sphère scolaire jouent un rôle dans ce processus?
2. Précisions méthodologiques
Pour traiter ces questions, cette recherche prend appui sur la démarche historique et mobilise donc les outils de l’historien: recueil de sources, constitution de corpus et recours à la périodisation pour saisir le développement de la discipline observée. Ainsi, cette étude, tout en se centrant sur un empan temporel circonscrit –du milieu du XIXe au premier tiers du XXe siècle– s’appuie sur un vaste corpus archivistique (plans d’études, programmes, manuels scolaires, revues professionnelles) recueilli dans trois cantons: Genève (GE), Vaud (VD) et Fribourg (FR).
L’analyse de ces sources se fait ensuite sous deux angles complémentaires: d’une part, la place et les finalités assignées par les différents acteurs du monde politique et scolaire à la littérature dans l’enseignement du «français» au primaire et au secondaire; d’autre part, le choix des corpus, ainsi que celui des exercices et des approches privilégiées pour aborder ce corpus. Pour ce faire, deux concepts didactiques sont mobilisés. Il s’agit d’abord de la disciplinarisation, qui désigne le processus d’organisation progressive des savoirs en disciplines scolaires en lien avec la généralisation de la forme scolaire moderne qui s’opère tout au long du XIXe siècle (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001)4. Il s’agit ensuite de la sédimentation des pratiques, selon laquelle l’enseignement est toujours le produit de pratiques provenant de différentes strates historiques (Schneuwly & Dolz 2009 ; Ronveaux & Schneuwly 2018).
Qui plus est, cette recherche prend en compte les deux ordres d’enseignement, primaire et secondaire. Elle se centre cependant pour le primaire sur les degrés intermédiaires et supérieurs (élèves de 9 à 15 ans environ), et pour le secondaire, sur le collège (élèves de 10 à 15 ans environ) et le gymnase (élèves de 16 à 18 ans environ)5, afin de mieux saisir quand la littérature française entre dans les classes et ce qu’elle vient éventuellement remplacer6.
Enfin, cette étude recourt à un jeu d’échelles. Tout en se situant au niveau de la Suisse romande, elle met en lumière certaines spécificités cantonales7, en lien avec deux facteurs : canton catholique (FR) versus cantons protestants (VD et GE) ; canton ville (GE) versus cantons ruraux (VD, FR). De même, des comparaisons ponctuelles avec la France permettent de mettre en exergue les spécificités de la Suisse romande en ce qui concerne l’avènement de la littérature dans la sphère scolaire au cours de cette période, mais aussi les circulations d’idées entre les deux contrées francophones.
Dans le texte qui suit, nous retraçons le processus d’entrée de la littérature au primaire et au secondaire en nous focalisant successivement sur trois périodes significatives. Nous nous centrons dans un premier temps sur les années 1850-1870, qui se caractérisent par le cloisonnement des ordres primaire et secondaire, chacun poursuivant des finalités très différentes, avec toutefois une ouverture à de nouveaux exercices et objets d’enseignement. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1870 aux années 1910, marquée par l’entrée du texte littéraire dans les corpus des deux ordres d’enseignement et l’émergence de l’explication de texte. Nous terminons avec une focale sur les années 1910-1930, période à laquelle les corpus et les exercices relatifs à la littérature se stabilisent. Enfin, notre propos est illustré par la présentation d’un ouvrage scolaire représentatif de chacune des périodes susmentionnées.
3. Les prémices d’un enseignement de la littérature (1850-1870)
Au début du XIXe siècle, le primaire et le secondaire ne sont pas destinés aux mêmes publics d’élèves. La plupart des écoliers –filles et garçons– effectuent leur scolarité à l’école primaire, centrée sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le collège accueille, quant à lui, les garçons issus des familles aisées. Son programme, fidèle à l’idéal humaniste, est centré sur l’apprentissage du grec et du latin. Après 15 ans, les jeunes gens ont la possibilité de continuer leurs études à l’Académie.
Ce qui tient alors lieu de littérature française dans les collèges, ce sont, comme en France8, les Belles Lettres, soit un «corpus d’auteurs français, essentiellement des dramaturges, des historiens et des prédicateurs du XVIIe» (Gabathuler & Védrines 2018 : 44). L’enseignement prodigué au primaire vise l’acquisition des rudiments et ne laisse pas de place à la littérature.
Or, dès les années 1850, cette situation change sous la pression de facteurs à la fois politiques et sociaux (Hofstetter & Monnier 2015). En effet, l’instruction publique se met en place dès les années 1830, par le biais d’une série de règlements et de lois, au sein de chaque canton. Ce processus est renforcé par la Constitution fédérale de 1848 qui confère officiellement la responsabilité de l’instruction publique aux autorités cantonales. Dans ce contexte, la prise de pouvoir des Radicaux à cette même période, aussi bien dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, est déterminante. Ceux-ci ont en effet la volonté de développer l’instruction publique et de la faire progresser, pour l’ajuster aux nouveaux besoins d’une société elle-même en évolution. Ainsi, la construction des systèmes scolaires en Suisse romande va se traduire, dès les années 1850, par une remise en cause du paradigme des humanités classiques, non sans impact sur la nature et la fonction des textes littéraires.
3.1. Une esquisse d’ouverture vers la compréhension des textes au primaire
Au milieu du XIXe siècle, l’enseignement primaire est encore très orienté vers la maîtrise des rudiments9. Ainsi, l’enseignement de la lecture reste principalement focalisé sur l’apprentissage du mécanisme pour parvenir à une lecture courante. En guise d’illustration, les analyses de Barras (1988) font état, pour le canton de Fribourg, de pratiques de lecture centrées sur les aspects mécaniques de l’apprentissage de la lecture, «l’intelligence» du texte, pour reprendre le terme usité à l’époque, n’important guère. Les recommandations exposées par A. Biolley dans la revue pédagogique l’Educateur en 1866 vont également dans ce sens : la lecture courante doit essentiellement porter sur la prononciation, l’observation de la ponctuation et les liaisons. Cependant, la série d’articles proposée par Biolley (1866) ne se limite pas à la lecture courante, ce dernier y ajoutant parmi les «espèces principales de lecture» (Biolley 1866 : 300), la lecture intelligente et la lecture expressive. Ces formes de lecture portent sur la compréhension du texte par l’élève qui se matérialise dans les programmes (ou équivalents10) par la prescription d’«explications» et de «comptes rendus».
Les prescriptions contenues dans les programmes sont très succinctes mais laissent à supposer que les explications sont essentiellement données par le maître. A titre d’exemple, dans le plan d’études vaudois paru en 1868, la leçon de lecture devient raisonnée et comporte des exercices d’intuition qui sont avant tout des questions précises posées par l’enseignant11 qui permettent aux élèves de mieux comprendre les textes.
Concernant les supports, les indications sont également vagues, comme en témoignent les prescriptions du programme genevois de 1852-1853 : des «livres élémentaires» pour les élèves de deuxième et troisième année ; des «livres moins faciles» pour les élèves de quatrième année ; enfin, des «livres plus difficiles» pour les élèves de cinquième année.
Néanmoins, l’analyse du corpus d’ouvrages pour l’enseignement de la lecture en usage à cette époque12 met en évidence que l’apprentissage du mécanisme s’effectue sur des tableaux de lecture, les élèves pratiquant ensuite la lecture courante sur des romans adaptés à la jeunesse dans les cantons protestants (Tinembart 2015), ou encore sur des textes religieux (Bible et catéchismes) dans le canton de Fribourg. C’est une visée instructive qui prédomine alors, la lecture courante se pratiquant sur des textes au caractère encyclopédique, moralisant ou éducatif, permettant à l’élève d’acquérir des connaissances utiles à son éducation.
Les différentes autorités cantonales sont à la recherche active d’ouvrages répondant à cette visée. Le canton de Vaud organise tout au long du XIXe siècle une série de concours pour doter les maîtres d’ouvrages scolaires de lecture destinés à l’enseignement. Les programmes de concours permettent aux auteurs d’alors de connaître les attentes des autorités et aux chercheurs d’aujourd’hui de mieux saisir la conception de la lecture et de la littérature des divers acteurs de l’époque.
Ainsi, dans l’école primaire vaudoise, la première trace laissée par les autorités scolaires relative à une préoccupation liée à la littérature remonte au Programme des concours pour la publication de livres élémentaires(1840)13. En effet, il s’agit pour les futurs auteurs de «conduire les jeunes élèves à lire couramment un livre quelconque, en leur offrant des exercices gradués de prononciation, et des lectures progressives, en accord avec les premiers développements de l'intelligence des enfants» (p. 44), mais aussi de leur apporter «toutes les choses bonnes, utiles, propres à concourir au but de l’éducation populaire» (p. 50). De plus, «on ne se fera pas un point d'honneur de n'offrir que des morceaux neufs et originaux: les grands écrivains présentent des pages aussi bien appropriées aux besoins des élèves d'une école primaire qu'elles sont admirées par l'homme du goût le plus cultivé» (p. 53). Enfin, les futurs auteurs sont également encouragés à s’inspirer de la Chrestomathie (1829, 1e éd.) d’Alexandre Vinet14, car son ouvrage offre des «modèles pour la composition» aux écoles primaires. Cette recommandation dénote une influence de l’ordre secondaire sur le primaire, la Chrestomathie de Vinet étant, comme nous allons le voir, un ouvrage conçu pour les élèves du secondaire.
La seconde trace remonte au 25 janvier 1859. En effet, suite à l’expertise d’un ouvrage de lecture, le rapport du Département donne l’autorisation d’éditer l’opuscule bien qu’«on ne saurait lui trouver un mérite réel, ni au point de vue philosophique ou scientifique, ni au point de vue littéraire»15. Certes, il était conseillé aux potentiels auteurs d’ouvrages scolaires de s’inspirer d’«exemples puisés dans les meilleurs écrivains»16, mais c’est encore avant tout le caractère encyclopédique et progressif des textes contenus dans les ouvrages de lecture qui régit le choix des autorités.
Il s’avère que les représentations liées à ce que devrait contenir un ouvrage de lecture destiné à l’école primaire changent dans la décennie suivante. Une volonté institutionnelle de faire entrer la littérature dans les ouvrages scolaires primaires s’exprime alors. En 1865, les cantons romands organisent une seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers, choisis notamment dans la littérature, au degré supérieur.
3.2. Entre Belles Lettres et littérature
Qu’en est-il au collège et au gymnase? L’analyse des programmes de ces deux institutions montre que les années 1850 se situent dans un entre-deux, où l’ancien côtoie le nouveau.
Jusqu’alors centré sur les humanités classiques, le curriculum du collège s’ouvre à des disciplines nouvelles, dont le français, qui s’autonomise par rapport aux langues anciennes et comprend une véritable progression. Ainsi, à Genève (programme de 1859), le jeune homme commence dans les petits degrés par la récitation de morceaux choisis «dans le Manuel»17, pour finir par des exercices de composition en lien avec des «exercices d’analyse grammaticale et littéraire de morceaux en prose et en vers». Ces derniers sont tirés des tomes 1 et 2 de la Chrestomathie de Vinet. De même, dans le canton de Vaud, le programme de «langue française» de 1853 commence dans les premiers degrés par la lecture d’ouvrages d’Histoire adaptés aux enfants18, pour aller vers la «lecture analytique» et la «lecture cursive» de morceaux de la Chrestomathie de Vinet (tome 1, puis 2, puis 3), avec en dernière année l’introduction du Cinna de Corneille. Il n’en demeure pas moins que la lecture de ces morceaux reste au service de la composition qui constitue la finalité de cet enseignement, en vue de l’entrée au gymnase sur lequel souffle cependant également un vent nouveau.
Au gymnase, le cours de rhétorique à Genève (programme de 1859) s’intitule «rhétorique et littérature française». Le programme, sur deux ans, est le suivant : rhétorique et histoire abrégée des principaux genres de prose et de poésie, exercices de composition française, récitation de morceaux choisis tirés du tome 2 de la Chrestomathie de Vinet et récitation de l’Art poétique de Boileau. De même, à Fribourg, les programmes du gymnase de l’Ecole cantonale19 de 1849 et 1857 prescrivent pour le cours de «langue française» le recours aux deux premiers volumes de la Chrestomathie de Vinet20, auxquels s’ajoutent quelques auteurs du XVIIe (Boileau, La Fontaine, Fénélon), utilisés comme supports pour l’«analyse»21, et pour les exercices constitutifs du cours de rhétorique –«étude de modèles» ou encore «essais oratoires».
Ainsi, bien que l’on reste dans un enseignement très imprégné par la rhétorique, l’omniprésence de la Chrestomathie de Vinet dans les programmes des collèges et gymnases des trois cantons inscrit ceux-ci sans conteste dans une ère nouvelle. Dans l’Avant-propos du tome 1 de sa Chrestomathie (1829a), Vinet annonce la singularité de son projet qu’il met en regard des Leçons de Littérature et de morale de Noël et Delaplace (1804-1805):
Aussi les morceaux qui composent le recueil de MM. Noël et Delaplace paraissent-ils avoir été destinés surtout à des exercices de mémoire et de déclamation ; et ils y conviennent parfaitement. [...] Nous voudrions une chrestomathie qui renfermât sinon des ouvrages, du moins des morceaux assez considérables pour qu’on y pût voir déployés une grande partie des procédés nécessaires pour la confection totale de l’ouvrage auquel ces morceaux appartiennent (Vinet 1829a : 8)
L’ouvrage de Noël et Delaplace est un manuel de rhétorique (Douay-Soublin 1997). La littérature, bien que présente dans le titre, est encore un synonyme de «Belles Lettres», dans la mesure où, comme le rappelle Chervel «elle n’est pas en prise sur des ‘œuvres’ ; elle n’a besoin que de morceaux choisis à titre d’illustrations [qui] n’ont pas vocation à être ‘expliqués’ au sens moderne du terme, mais à être appris par cœur et imités» (Chervel 2006 : 488-489).
Or, le projet de Vinet est tout autre, même si sa visée reste rhétorique, car au service d’une composition centrée sur l’elocutio qui «seule a du prix à nos yeux» (Vinet 1829a : 7). Son point de départ est en effet l’enseignement de la langue française et de la littérature, non pas en contexte francophone, mais en contexte germanophone. Il s’agit d’abord pour Vinet, qui enseigne à Bâle, de proposer à ses élèves d’apprendre le français en lisant et en traduisant des extraits issus des grands textes de la littérature française. Le tome premier, La Littérature de l’Enfance, est d’ailleurs accompagné d’un lexique français-allemand fait par un ami de l’auteur. Dans ce cadre «expliquer» signifie donc «traduire».
Comme le rappelle Rambert (1930) cependant, Vinet a aussi songé aux écoles françaises en élaborant son anthologie. Plaçant sa réflexion sur l’enseignement de la littérature «à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes» (David 2017 : 12), Vinet a l’ambition de faire lire en classe les auteurs classiques du XVIIe, mais aussi certains auteurs contemporains «avec les soins attentifs et la précieuse lenteur qu’on apporte à celle des classiques anciens» (Rambert 1930 : 174). Vinet s’en explique lui-même dans la préface de la première édition du tome 2 intitulé Lectures pour l’adolescence:
On a lieu de s’étonner que la méthode suivie dans nos écoles pour la lecture des auteurs latins et grecs ne soit appliquée, avec les modifications convenables, à la lecture des classiques de la langue maternelle. [...] Les circonstances qui m’ont porté à faire usage de cette méthode dans l’enseignement de la littérature française à de jeunes étrangers m’ont fourni l’occasion de me convaincre qu’elle est applicable, dans ce qu’elle a d’essentiel, au cas de jeunes gens lisant sous la direction d’un maître les chefs-d’œuvre de leur propre langue. (Vinet 1829b : 1-2)
Dans cette première édition, il ne développe cependant pas sa propre méthode, mais invite les enseignants à recourir avec leurs élèves à la méthode de Rollin22.
La Chrestomathie de Vinet comprendra 30 rééditions successives jusqu’en 1930. Dès la deuxième édition de 1833, elle devient rapidement un «best-seller». Intéressons-nous à présent à ses contenus.
3.3. La Chrestomathie de Vinet
Vinet, passionné d’œuvres littéraires, a à cœur de rédiger une Chrestomathie dont les extraits sont tirés «des chefs-d’œuvre classiques» (Vinet 1829a : IX). Ceux-ci doivent permettre «d’apprendre à les imiter sous le triple rapport de la langue, du style et de la composition générale, en un mot sous le rapport de l’art d’écrire, tel que Buffon le concevait» (Vinet 1829a : IX). La première édition du Tome 1 de 1829 destinée aux collégiens de 12-14 ans se compose de neuf parties ayant pour titres : narrations fictives (6 extraits), biographies (4 extraits), histoire (7 extraits), voyages (3 extraits), descriptions (2 extraits), genre didactique (3 extraits), dialogues (8 extraits), lettres (4 extraits) et poésies réparties en fables (25 fables), narrations (6 extraits) et scènes (2 extraits). La plupart des auteurs23 sont présentés sous la forme d’une courte biographie.
Si Vinet sélectionne des morceaux, c’est parce qu’un ouvrage complet «est hors de proportion avec la capacité de l’enfant ou le degré de ses connaissances philosophiques» (Vinet 1829a : V). Cela évite aussi à l’instituteur de devoir lui-même choisir les extraits. Ceux qu’il propose sont courts (en moyenne dix pages pour les textes narratifs et descriptifs) car «dans la jeunesse, ce sont les détails qui nous frappent et nous séduisent ; des figures neuves, des images éblouissantes, des expressions originales nous paraissent l’essentiel de l’art d’écrire» (Vinet 1829a : VII). Le grand choix de lectures proposé peut être «coordonné à l’enseignement grammatical» (Vinet 1829a : VIII) et permet de «retrouver dans un morceau d’histoire la plupart des éléments du talent de l’historien, dans un morceau d’éloquence les principales conditions qui constituent l’orateur, et ainsi des autres genres» (Vinet 1829a : VIII). Enfin, les morceaux sont organisés afin que «la marche du facile au difficile, du simple au composé, y fût suivie autant que possible, soit à l’égard du style, soit à l’égard des idées» (Vinet 1829a : IX) ; pour ce faire, une table des matières particulière permet à l’enseignant de concevoir la progression entre les textes. Enfin, Vinet a porté son choix sur les écrivains «qui font autorité en fait de langage et de style» (Vinet 1829a : IX) et les «talents contemporains» dans le but de «présenter la langue française avec toutes les acquisitions qu’elle a faites jusqu’à nos jours» (Vinet 1829a : X).
Vinet ajoute à la seconde édition (1833) 26 nouveaux extraits dont neuf appartiennent à une nouvelle sous-partie intitulée «poésie lyrique». Ces ajouts concernent tous les thèmes, mais essentiellement les lettres et les fables. Sur les 114 extraits que contient la deuxième édition de la Chrestomathie, Tome 1, les auteurs sont essentiellement français (seulement quatre Suisses figurent parmi eux). Un tiers des textes sont de Fénélon, La Fontaine, Florian et Madame de Sévigné. Nous trouvons 48 extraits d’auteurs du XVIIe siècle, 33 extraits du XVIIIe siècle et 28 extraits émanent de contemporains de Vinet encore vivants, dont 15 ajoutés dans la deuxième édition. Cet ajout démontre que l’auteur s’informe des nouveautés littéraires de son époque et souhaite que son ouvrage reste d’actualité.
4. Littérature et disciplinarisation du «français» (1870-1910)
La période couvrant la fin du XIXe et le début du XXe siècle se caractérise par l’avènement des «Etats enseignants» (Hofstetter 2012) qui, suite à la Constitution fédérale de 1874, vont entériner l’obligation scolaire jusqu’à 15 ans. Cette obligation entraîne alors la création d’institutions et de filières au niveau secondaire, d’enseignement général, mais aussi professionnel. Il s’agit en effet d’une part de répondre aux besoins de l’industrie qui se développe en Suisse et qui requiert des ouvriers qualifiés, d’autre part de préparer une élite à l’entrée dans les universités et les écoles polytechniques qui sont créées à cette période.
Chaque canton institue de fait un système scolaire, avec un ordre secondaire, constitué d’un degré inférieur et d’un degré supérieur, et désormais articulé à l’ordre primaire. Cette première phase de démocratisation de l’enseignement (Hofstetter & Monnier 2015), qui se traduit par l’ouverture du secondaire à tous les publics d’élèves, entraîne de fait la mise au rebut officielle des humanités classiques, au profit de disciplines nouvelles, dont le «français». Cette dernière s’étend rapidement sur l’ensemble du système, entraînant progressivement la montée vers le secondaire de certains manuels de lecture conçus pour le primaire supérieur, ces derniers étant élaborés sur le modèle de la Chrestomathie de Vinet.
4.1. Vers l’explication de texte (littéraire) au primaire
L’enseignement de la lecture au primaire prend une autre dimension à partir des années 1870. Les trois dernières décennies du XIXe siècle voient en effet s’amplifier le processus de disciplinarisation du «français» amorcé dans les années 1850, processus qui se caractérise notamment par une articulation de la lecture et des éléments relatifs à la langue (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) dans un dispositif dont l’aboutissement est la composition. Dans ce processus, en partie influencé par les proposition du Père Girard, pédagogue fribourgeois, le livre de lecture devient progressivement central24, comme l’illustre ce propos tenu dans l’Educateur :
Le livre de lecture doit donc devenir désormais le point de départ, le centre de l’enseignement de la langue maternelle comme cet enseignement lui-même doit être le centre des études primaires. C’est à l’étude raisonnée du livre de lecture, que doit se rapporter le résumé grammatical ; c’est sur ce livre de lecture, que doit se régler aussi le cours de style et enfin le cours de composition. (Bourqui 1870 : 336)
Au niveau des prescriptions, on observe une diversification des formes de lecture : à la lecture courante est ainsi ajoutée la lecture expressive25 et le «compte rendu» évolue progressivement vers l’explication, processus qui s’achèvera avec l’avènement de la lecture expliquée dans les premières décennies du XXe siècle.
En continuité avec les prescriptions des années 1850-1860, le compte rendu s’inscrit tout d’abord dans le paradigme de la lecture instructive et morale. Ainsi, le règlement scolaire fribourgeois de 187626 préconise, pour le deuxième cours (élèves de 10-12 ans), d’effectuer le compte rendu «par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et propres à orner la mémoire de l’enfant de connaissances utiles et à diriger son éducation morale» (Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg, 1876). La visée morale de la lecture perdure ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, comme en témoignent également les prescriptions vaudoises de 1899 : «Sujets en rapport avec les autres leçons. Analyse du contenu, énoncé des faits principaux, comparaison ; préceptes moraux et applications pratiques. Récitation de morceaux choisis» (Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1899, degré intermédiaire 2e année).
Cependant, tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques en place, le compte rendu s’oriente progressivement vers la compréhension du texte pour lui-même. On trouve ainsi dans le Programme prescrit pour les écoles primaires du canton de Fribourg de 1886 : «compte-rendu par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et de nature à obtenir l’expression claire et correcte des principales idées du texte» pour le premier cours du degré supérieur ; «compte-rendu libre et constituant le résumé oral et correct des idées renfermées dans le texte» pour le deuxième cours du même degré. Le compte rendu s’y effectue essentiellement oralement: d’abord à partir des interrogations du maître, puis librement. Bien que les prescriptions varient en fonction des cantons, une tendance commune semble se dégager : une partie de l’explication porte sur le vocabulaire et la grammaire, une autre partie est consacrée à la compréhension du texte (dégager l’idée générale, énoncer les faits principaux, rechercher le plan, etc.).
Enfin, les mentions relatives aux supports sont très succinctes dans les programmes : morceaux simples (pour les petits degrés), prose et poésie pour la récitation. Cette période voit cependant la parution de deux livres de lecture qui, comme nous allons le voir, annoncent l’entrée des textes littéraires au primaire.
4.2. Un ouvrage primaire et secondaire
En 1865, les cantons romands organisent une Seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers au degré supérieur, choisis notamment dans la littérature. Les premiers livres de lecture adoptés par la Suisse romande (Renz 1871 ; Dussaud & Gavard 1871) en sont de parfaits exemples.
Le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard27 (1871) est destiné à la fois aux degrés supérieurs de l’école primaire vaudoise et genevoise. Les courts morceaux choisis par les auteurs, tous deux enseignants, sont numérotés et regroupés par thématiques qui se répartissent en neuf parties28: histoire naturelle (120 extraits descriptifs dont une moitié est anonyme), descriptions et voyages (16 récits), histoire (15 morceaux), biographies (huit portraits), anecdotes, traits moraux, caractères (21 extraits), style épistolaire (10 extraits de lettres), dialogues en prose (trois extraits de pièces théâtrales), dialogue en vers (trois extraits) et poésie narrative et lyrique (31 extraits).
Force est de constater que les thèmes de science naturelle prennent une grande place dans cet ouvrage annonçant la «leçon de chose», tout en offrant cependant également une place importante à la littérature de Suisse romande (Schneuwly & Darme 2015 ; Gabathuler 2017). Il y a en effet 32 textes d’écrivains suisses essentiellement vaudois et genevois (Agassiz, Vuillemin, Monnard, Porchat ou Töpffer) contre 75 auteurs français. Parmi eux, nous retrouvons certains auteurs déjà présents dans la Chrestomathie de Vinet (1833)29 (Fénélon, Florian, La Fontaine, Molière, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand ou Buffon). Fribourg renonce dans un premier temps à utiliser ce livre de lecture à l’école primaire, mais décide d’en éditer une adaptation en 1882. Celle-ci se divise alors en deux parties clairement identifiées, la partie scientifique et la partie littéraire, dont :
Les morceaux ne sont point choisis au hasard. Ils forment un petit cours de composition donnant des modèles de tous les genres de style, en même temps qu’une histoire littéraire, très succincte sans doute, mais bien suffisante pour les élèves auxquels ce livre est destiné. (Dussaud & Gavard adapté par Fribourg 1882 : 7)
Par l’observation de ces deux éditions, nous pouvons relever un processus de sédimentation : une grande part des auteurs choisis par Vinet (1833) sont repris par Dussaud et Gavard (1871); l’ouvrage propose ainsi une histoire de la littérature adaptée à l’âge des élèves, mais sur le modèle proposé dans le secondaire supérieur qui reste au service de l’enseignement de la composition selon le modèle rhétorique. Les textes sont numérotés, classés par catégories et organisés selon leur complexité.
4.3. Un corpus littéraire au service de nouvelles finalités
L’articulation progressive des degrés inférieurs et supérieurs du secondaire facilite la mise en place d’un «français» unifié sur l’ensemble du secondaire, qui va se caractériser avant tout par un corpus littéraire spécifique. En effet, contrairement à la période précédente où les enseignants s’appuient très largement sur la Chrestomathie de Vinet, le dernier tiers du XIXe siècle peut être considéré comme un moment clé dans l’élaboration de ce qu’on entend aujourd’hui par «littérature» en classe de français.
L’analyse des programmes du Collège cantonal de Vaud (1877, 1891) et des degrés inférieurs du Collège de Genève (1877, 1889) montre que, outre l’ouvrage de Dussaud et Gavard (1871) introduit dans les premiers degrés, la Chrestomathie de Vinet continue à être présente dans les derniers degrés30. Avec l’ouverture du secondaire à un nouveau public d’élèves, le nombre de classe augmente et l’utilisation d’un manuel qui a fait ses preuves permet de garantir une certaine harmonisation dans les pratiques.
Il n’en est cependant pas de même au secondaire supérieur, où les anthologies tendent à disparaître au profit d’une liste d’auteurs et de textes, élaborée par les enseignants eux-mêmes. Très succincts dans le dernier tiers du XIXe, et limités aux œuvres travaillées en classe de français, ces inventaires s’étoffent au tournant du XXe siècle pour devenir de véritables listes qui comprennent deux sections: les lectures à faire en classe, et –pratique nouvelle– un choix de lectures à domicile:
Les lectures faites à domicile et contrôlées en classe ne sont pas tout à fait une innovation. La plupart de nos établissements possèdent une bibliothèque où les élèves puisent abondamment. Ils continueront, espérons-le. Mais on veut qu’il y ait un plan de lecture graduée, commençant par des morceaux choisis et continuant par des fragments plus étendus des grands écrivains, par des pièces de théâtre, par des morceaux de poésie caractéristiques, de façon que l’enseignement de la littérature, venant à son heure, s’appuie sur des souvenirs précis, sur la connaissance de quelques textes. (Plan d’études pour les collèges et gymnases du canton de Vaud 1910 : 7-8)
Ce phénomène est particulièrement visible dans le programme du Collège de Genève de 1900 (cf. Annexe 1). Le corpus des lectures en classe, tout en conférant une large place aux auteurs du XVIIe siècle –Corneille, Racine, Molière, mais aussi Boileau, Fénélon et Bossuet– est organisé désormais selon une progression chronologique, qui va de la Chanson de Roland aux auteurs du XIXe (Chateaubriand, Musset, Gautier). Ce corpus sert avant tout de support au cours d’histoire de la littérature qui figure désormais à l’épreuve orale de maturité, laquelle comporte trois parties : grammaire française, histoire de la langue française et histoire de la littérature française31.
Le choix des textes proposés en lecture à domicile fait, quant à lui, état d’une sédimentation des pratiques. Ce corpus garde en effet des traces des Belles Lettres, avec une large place donnée aux textes historiques et rhétoriques du XVIIe siècle (Dialogues sur l’éloquence de Fénélon). Pourtant, au sein de cette continuité, le corpus comprend également une très large sélection de textes d’auteurs du XIXe, et offre une place de choix à la nouvelle, avec notamment Les Lettres de mon Moulin et Contes du lundi d’Alphonse Daudet, et au roman, avec par exemple François le Champi et La Mare au Diable de George Sand. Par ailleurs, les auteurs suisses romands (Eugène Rambert), voire genevois (Victor Cherbuliez, John Petit-Senn, Marc Monnier, Rodolphe Töpffer), sont largement représentés, dans la ligne directe du corpus proposé dans le Dussaud et Gavard (1871). On trouve ainsi des poètes, mais aussi des scientifiques (Horace Bénédict de Saussure) et des philosophes (Charles Secrétan).
Autrement dit, on sort avec ce double corpus du paradigme rhétorique où le texte littéraire est là pour être appris par cœur et imité, même si ce dernier perdure à titre résiduel. La lecture de ces textes, en classe ou à domicile, obéit désormais à de nouvelles finalités : l’acquisition d’une culture littéraire large, qui n’est cependant pas détachée de la construction d’une identité helvétique.
En 1911, Henri Mercier32 n’hésite pas à placer la Suisse romande en avance sur la France dans l’élaboration d’un corpus littéraire spécifique au «français» : «dans notre pays, nous n’avons pas certes attendu jusqu’en 1880 pour autoriser les Provinciales, pour donner un laisser-passer à Victor Hugo» (Mercier 1911 : 195). Il n’en demeure pas moins que l’ouverture du corpus aux auteurs modernes ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant, comme le met en évidence cet article de Charles Favez33, publié la même année dans la Gazette de Lausanne, et qui porte le débat sur la place publique :
Dans l’étude faite au Collège et au Gymnase des grands écrivains français, M. Sensine34, comme M. Bouvier35, donne la préférence à ceux du XIXe siècle, parce, dit-il, que les grands maîtres du siècle de Louis XIV, «tout remarquables qu’ils sont, ont le défaut, au point de vue pédagogique, d’exprimer une autre âme que la nôtre et de parler une langue que nous n’employons plus, tandis que ceux du XIXe expriment notre vie, notre âme, et emploient vraiment notre idiome moderne». Je demande au distingué professeur la permission de discuter ici cette idée. […] A notre époque […] quoi de plus actuel que le caractère de Phèdre ou celui d’Oreste? […] Ce n’est pas tout : il y a encore la langue. […] Certes, personne n’admire plus que moi la prodigieuse invention verbale de Victor Hugo […]. Mais pour la pureté de la langue, il me paraît cependant qu’il faut donner la préférence aux écrivains du siècle de Louis XIV. (Favez 1911).
Au cœur du débat en réalité, la langue : faut-il privilégier les auteurs du XVIIe siècle, qui incarnent un certain idéal de la langue française, ou plutôt les auteurs du XIXe, qui s’expriment avec la même langue que les élèves? Et si l’on maintient les classiques du XVIIe siècle, ne doit-on pas imaginer de nouveaux exercices permettant aux élèves, toujours plus nombreux avec la création d’un secondaire pour tous, de comprendre ces textes, dont la langue n’est plus la leur?
5. De la lecture expliquée à l’explication de texte (1910-1930)
Le début du XXe siècle est marqué par la stabilisation des systèmes scolaires cantonaux qui va de pair avec la stabilisation des disciplines scolaires. Ainsi, le «français» s’organise désormais autour de composantes – grammaire, littérature, lecture, composition – et d’exercices spécifiques. C’est dans ce contexte qu’apparaît un nouvel exercice de lecture – la lecture expliquée – qui va s’étendre sur le primaire et le secondaire.
5.1. Avènement de la lecture expliquée au primaire
A partir des années 1920, l’orientation donnée à la lecture dans le dernier tiers du XIXe siècle s’affirme et se stabilise. Elle se caractérise notamment par la place centrale du texte littéraire dans la composante lecture et la lecture expliquée36 comme exercice phare au primaire (voir également les analyses de Schneuwly & Darme 2015).
Ainsi, en adéquation avec les recommandations figurant dans les préfaces des livres de lecture, les prescriptions recentrent clairement les exercices d’explication sur le texte littéraire. A titre anecdotique, mais révélateur de ce mouvement au niveau romand, on voit apparaître dans la partie pédagogique de l’Educateur une rubrique «Texte littéraire». En outre, on observe l’entrée du terme littéraire, jusqu’ici absent des prescriptions37, dans les programmes des trois cantons parus dans les années 1920-193038. Enfin, on y note l’apparition de la «lecture expliquée»39, qui résulte de la progressive stabilisation des exercices d’explication et de comptes rendus prescrits dès le dernier tiers du XIXe siècle.
Cette nouvelle forme de lecture a été amorcée dans différents articles spécialisés parus dans les revues pédagogiques dans les années 1910, à l’instar de La lecture expliquée par Henri Mercier (1911) et Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée par Henri Duchosal40 (1918). Fait significatif de l’articulation entre le primaire et le secondaire, ces deux écrits sont rédigés par des enseignants du secondaire. Celui de Duchosal est même une adaptation pour le primaire supérieur d’un article que ce dernier a publié dans l’Educateur en 1917 pour le secondaire inférieur:
Pensant que notre article sur la lecture expliquée paru dans L’Educateur, au mois de février 1917, et destiné aux établissements d’instruction secondaire, pourrait être aussi de quelque utilité pour les écoles primaires, le Département de l’Instruction publique a bien voulu nous demander de l’adapter à ce degré de l’enseignement en le simplifiant et en le faisant suivre d’exemples concrets qui lui donneraient un caractère pratique (Duchosal 1918 : Avant-propos).
De ces articles se dégagent quelques traits fondamentaux de la lecture expliquée au primaire. Ainsi, pour Mercier, une première phase de l’explication devrait être centrée sur le vocabulaire : «Un autre service de ces premières lectures expliquées devrait être d’enrichir le vocabulaire, le vocabulaire concret s’entend, encore si pauvre» (Mercier 1911 : 199). L’explication devrait être ensuite consacrée à l’étude du plan et à la compréhension des idées contenues dans le texte. La marche à suivre proposée par Duchosal (1918) est différente de celle de Mercier, mais on y retrouve les mêmes composantes, à savoir un travail sur le fond et un travail sur la forme (comprenant la grammaire en sus du vocabulaire). L’ordre des étapes est le suivant:
1. lire le morceau
2. donner le sujet du morceau et préciser le but de l’auteur
3. retrouver le plan
4. expliquer les idées du texte
5. discuter la valeur de celles-ci
6. dégager les caractéristiques formelles du morceau avec une centration sur le vocabulaire et la grammaire
7. procéder au compte rendu, soit à la synthèse de l’explication.
A noter que ce compte rendu pour Duchosal doit être effectué par un élève, les autres étapes de la leçon devant être réalisées sous la forme d’une leçon dialoguée entre maître et élèves.
Dans les prescriptions du primaire toutefois, il n’est pas aussi aisé de saisir en quoi consiste la lecture expliquée dans le détail ni la manière de procéder. En effet, certaines préconisations figurant dans les programmes restent assez vagues, à l’instar des exemples suivants : «Étude élémentaire du contenu et de la forme» (Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932, degré moyen) ; «Remarques littéraires élémentaires» (Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Vaud, 1926 : degré supérieur). Qui plus est, on relève la persistance d’une dimension morale, présente cependant explicitement chez Duchosal (1918), dans le programme fribourgeois de 1932 : «Exciter et développer le goût de la lecture saine et réconfortante par des lectures faites par le maître de pages littéraires et morales captivantes [...]» (p. 32).
5.2. Une nouvelle génération d’ouvrages de lecture
Si la littérature devient prépondérante dans les manuels de lecture au primaire comme au secondaire, désormais, c’est le type de littérature à privilégier qui sera discuté. En 1893, Le Département de l’Instruction publique et des cultes vaudois mandate Louis Dupraz et Emile Bonjour41 pour rédiger deux ouvrages afin de remplacer le Renz (1871) et le Dussaud et Gavard (1871). Non seulement les autorités vaudoises se désolidarisent des autres cantons romands, mais demandent en outre aux auteurs de faire une large place à la littérature nationale. Deux nouveaux ouvrages sont édités : le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1895) et le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire (Dupraz & Bonjour 1903).
Ces deux livres de lecture annoncent un changement quant aux morceaux choisis qui se confirme dans la seconde édition de l’opuscule destiné au degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1899, 2e éd.). L’ouvrage comporte désormais un quart de textes d’auteurs suisses, dont la plupart sont francophones, et sept traductions. Nous constatons également que les textes descriptifs sur les sciences naturelles disparaissent au profit de textes littéraires dont le thème est la nature. Enfin, les morceaux choisis traitent de thématiques proches de l’environnement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui permettrait, selon les auteurs, d’inscrire leur apprentissage dans leur quotidien (Tinembart 2018).
Dix ans plus tard, Dupraz et Bonjour, en collaboration cette fois-ci avec Henri Mercier, rédigent une Anthologie scolaire (1908) destinée aux collèges secondaires et aux écoles primaires supérieures (élèves de 13 à 15 ans) et adoptée par le canton de Genève. Cette anthologie comporte 259 extraits de textes répartis en dix parties. Non seulement elle contient des auteurs qui ne figurent pas dans le livre de lecture écrit pour les écoles primaires (Fénélon, Stendhal, Zola, Descartes, Flaubert, Flammarion, Montaigne, La Bruyère, Musset, etc.), mais une partie «études littéraires» et une partie «théâtre» sont intégrées. Dans la première, les élèves apprennent les caractéristiques de la langue française, les particularités de l’orthographe et de la ponctuation. Dans la seconde, ils font entre autres la connaissance de Corneille et retrouvent Racine et Molière. Enfin, l’ouvrage se termine par 26 pages regroupant des biographies succinctes des 159 auteurs présents dans ce manuel.
A la mort de Dupraz, Bonjour édite deux nouveaux manuels : Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire (1925) et Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur (1931). Les morceaux choisis abordent des thématiques qui concernent encore davantage les élèves telles que l’observation des animaux, les récits d’aventure, les qualités et les défauts, la vie quotidienne, etc. Celles-ci répondent plus aux intérêts des enfants et à leurs goûts personnels. L’influence de l’École nouvelle42 pourrait expliquer ce changement. La plupart des morceaux choisis écrits par des auteurs français ne figurent pas dans les ouvrages précédents de Bonjour. Celui-ci fait également entrer de nouveaux auteurs suisses tels que Maurice Porta, René Morax, Gonzague de Reynold ou encore Charles Ferdinand Ramuz. Sont également privilégiés les auteurs contemporains (sur les 244 textes présents dans l’ouvrage, 93 auteurs sont nés au XIXe siècle et 41 au XXe siècle). Le livre de lecture n’est désormais plus encyclopédique, mais il offre une grande diversité littéraire. Il propose ainsi des textes proches du vécu de l’enfant et ses extraits proviennent de la littérature suisse et française.
En 1910, Henri Mercier résume bien ce renouveau dans les ouvrages de lecture : «Gardons ce qui est substantiel en littérature, en morale, en histoire. Préoccupons-nous de la vie. Ornons les esprits, mais tâchons d’abord de les faire réalistes et pratiques» (Mercier 1910 : 90-91) ; «[…] Le manuel, lui aussi, s’est mis au ton du jour. Il suit le mot d’ordre : “Tout par les textes !”» (Mercier 1910 : 94).
5.3. De l’institutionnalisation de l’explication de texte au secondaire
Les années 1910-1920 peuvent être considérées pour le secondaire comme le moment clé où le «français» devient une discipline organisée désormais autour de trois piliers : un corpus littéraire spécifique et deux exercices progressivement placés à égalité. Il s’agit de la dissertation, présente dans les programmes dès la fin du XIXe, et de l’explication de texte, qui entre dans les pratiques à cette période, non sans débats cependant, comme le laisse entendre Mercier:
L'explication française, officiellement instituée partout ou peu s'en faut, n'est-elle qu'un vain ornement sur la façade des programmes? Est-ce une expression creuse et sonore? N'est-ce pas plutôt le bon sens même et une pièce essentielle de l'enseignement? Des livres excellents, de nombreux articles, des discussions courtoises ou vives nous prouvent l’intérêt, l’importance et la nouveauté de ce sujet. Oui, sa nouveauté. (Mercier 1911 :198)
Sur la scène romande en effet, si les pédagogues s’accordent sur la nécessité de travailler à partir de morceaux tirés d’anthologies, les approches pour aborder ceux-ci diffèrent. Ainsi, Bouvier, dans une conférence adressée aux futurs ou jeunes maîtres de français en 1910 à Zurich, défend la «lecture analytique», qu’il centre sur les auteurs du XIXe, et qu’il distingue de «l’explication française» (Bouvier 1910 : 16). Sa méthode, expérimentée à l’Université de Genève dans son séminaire de français moderne, est envisagée ici au niveau secondaire, pour «un maître idéal et un élève idéal, affranchis de la surveillance administrative et du souci des examens» (Bouvier 1910 : 2). Celle-ci s’organise autour de deux questions : «qu’est-ce que l’auteur a voulu faire? Par quels moyens l’a-t-il réalisé?» (Bouvier 1910 : 12). Son but? «Faire saisir à notre élève l’individualité de chaque écrivain» (Bouvier 1910 : 10).
Mercier (1911), quant à lui, prône la lecture expliquée selon la méthode proposée par Ch.-M. Des Granges43 dans son manuel Morceaux choisis des auteurs français du Moyen-Âge à nos jours préparés en vue de la lecture expliquée de (1910/1920). Celle-ci comprend les étapes suivantes : replacer, s’il y a lieu, le morceau dans l’ensemble dont il a été détaché ; le lire à haute voix, établir son plan; le commenter phrase par phrase sans tomber dans la paraphrase, en s’arrêtant sur la propriété des termes et sur les figures de style ; terminer par une conclusion philosophique et morale. Mercier précise néanmoins : «Y a-t-il pour expliquer un auteur français une seule méthode? Non pas. Qui ne sent qu’on ne commente pas Boileau comme Lamartine. […] Cela dépend aussi de la préparation de l’élève» (Mercier 1911 : 204).
C’est la lecture expliquée qui l’emporte. Présente dans les programmes du collège de Genève dès 1914 au secondaire inférieur, celle-ci se répand dès 1918 au secondaire supérieur et, comme nous l’avons vu, au niveau du primaire supérieur, suite à des propositions pédagogiques publiées au niveau romand (Duchosal 1918). Corollairement, alors que la fin du XIXe se caractérise au niveau de la voie gymnasiale par une absence des manuels, dès les années 1920, le manuel de Ch.-M. Des Granges (1910/1920) est cité dans les programmes aussi bien à Genève (1925) qu’à Fribourg (1926). Cela est d’autant plus intriguant qu’à Fribourg, on reste au secondaire dans un enseignement de la «langue française» très influencé par la rhétorique, centré dans les petits degrés sur la grammaire et qui aboutit en dernière année à la «rhétorique» avec, comme exercices, le discours, les analyses et critiques littéraires et les plaidoyers.
Le choix de l’anthologie de Des Granges, loin d’être le produit du hasard, signe en réalité une ère nouvelle dans l’enseignement du «français» en Suisse romande. Cette anthologie est en effet prescrite dans la voie gymnasiale en lien avec le cours d’histoire de la littérature qui procède désormais par siècles : Moyen-Âge et XVIe siècle en 1e année, XVIIe siècle en 2e, XVIIIe siècle en 3e et XIXe siècle en 4e. Contrairement aux anthologies précédentes, celle de Des Granges a en effet l’avantage de proposer une série de morceaux d’auteurs allant du Moyen-Âge à 1900, classés par siècles, et à l’intérieur de chaque siècle, par genres. Mais surtout, comme le relève un critique belge de l’époque, «cette anthologie est particulièrement intéressante pour les professeurs, car plus de vingt textes commentés donnent des modèles d’explication littéraire et constituent une véritable méthode» (Hombert 1932), plaçant de fait le texte littéraire au centre de l’enseignement du «français».
L’institutionnalisation de la lecture expliquée sur l’ensemble du secondaire en Suisse romande semble donc s’opérer plus tardivement qu’en France où «c’est […] des premières années du XXe siècle que date la pratique régulière de l’explication française dans les classes» (Chervel 2006 : 531). Elle se réalise in fine par le biais de l’épreuve orale de maturité qui devient, dans les années 1920, une «explication de texte»44, aux côtés de l’épreuve écrite de français, qui est une «composition sur un sujet littéraire ou scientifique», soit une dissertation45. Avec cette nouvelle épreuve, l’interprétation des morceaux littéraires va alors s’imposer dans les pratiques, au point de devenir «à l’école secondaire, la branche la plus importante de l’enseignement du français» (Robadey 1933 : 193).
6. Conclusion
Que retient-on de ce parcours historique? Dans les classes de Suisse romande, il apparaît que l’avènement du texte littéraire en «français» s’opère entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, en lien avec la disciplinarisation du «français» au primaire et au secondaire. A l’intérieur de ce processus cependant, le modèle rhétorique perdure dans les pratiques sous forme de traces, et ce dans les trois cantons, même si les cantons protestants de Genève et de Vaud apparaissent comme plus avant-gardistes que Fribourg. En tant que canton catholique, ce dernier continue en effet sur cette période à privilégier les manuels français du XIXe siècle, au détriment de ceux édités sur la scène romande par les cantons protestants.
Dans les grandes lignes du processus que nous avons retracé, la Suisse romande ne se distingue pas de la France vers laquelle les professeurs de l’époque se tournent largement pour repenser leurs pratiques. Rollin, Des Granges, pour ne citer que quelques noms, constituent en effet des références incontournables pour les pédagogues romands. Cependant, cette histoire comprend des spécificités liées notamment au fait que la Suisse est constituée de plusieurs régions linguistiques, dans lesquelles le «Français» a le statut, soit de langue maternelle, soit de langue étrangère. La Chrestomathie de Vinet est emblématique de la circulation des idées pédagogiques entre les cantons suisses, mais aussi entre les pays à cette période. L’originalité de cette anthologie –lire les auteurs de langue française en suivant la méthode utilisée alors pour les auteurs de l’Antiquité– tient au fait qu’elle est prévue au départ pour l’enseignement de la langue et de la littérature française à Bâle (canton germanophone). Or, elle va non seulement s’imposer dans l’ensemble du secondaire en Suisse romande, mais elle sera également imprimée en France et en Belgique.
Par ailleurs, cette étude montre que les professeurs du secondaire, dont certains ont été au début de leur carrière instituteurs, ont joué un rôle majeur dans l’avènement du texte littéraire à l’école. Ce sont eux qui façonnent les contours de la littérature française dans les classes de Suisse romande, et qui élaborent de nouveaux exercices pour lire, comprendre et interpréter ces textes, selon une progression qui va du primaire à la fin du secondaire supérieur. Ainsi, au primaire, les auteurs contemporains sont plus présents qu’au secondaire où, dès le début du XXe siècle, l’approche de la littérature est désormais chronologique, allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. De plus, au primaire, les morceaux choisis sont également plus proches de l’enfance au niveau des thèmes abordés. Corollairement, la manière d’approcher ceux-ci s’inscrit dès les années 1920 dans une progression, qui va de la lecture expliquée de type littérale (axée sur le vocabulaire et la grammaire) au primaire à l’explication de texte qui laisse une large place au commentaire (axé sur les figures de style et visant à dégager le style particulier de l’auteur) au secondaire supérieur.
Les choix qui ont été faits par les acteurs du système scolaire à cette période ont été décisifs. Ils constituent encore la base de la discipline «français» aujourd’hui. Dans les Directives pour l’examen suisse de maturité (2012), il est en effet précisé que, pour le «français» langue première, le candidat sera évalué par le biais d’une épreuve écrite, soit une dissertation, et d’une épreuve orale, soit une analyse d’un extrait tiré d’une œuvre littéraire. Cependant, aussi bien au secondaire qu’au primaire, les plans d’études ne prescrivent pas un corpus littéraire précis, se limitant à des indications en ce qui concerne les genres à travailler et les siècles à couvrir pour chaque année. Le choix de telle ou telle œuvre et la manière de la travailler en classe relève de l’expertise de l’enseignant. Ce dernier, comme ceux d’hier, contribue ainsi, à son échelle, à la définition de ce qu’est la littérature scolaire aujourd’hui.
Bibliographie
Balibar, Renée (1985), L’institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République, Paris, Presses Universitaires de France.
Barras, Jean-Marie (1988), Deux siècles d’apprentissage de la lecture dans le canton de Fribourg, Fribourg, Auteur.
Bishop, Marie-France (2019), « Quelle didactique de la littérature dans les manuels de l’enseignement primaire en France de 1880 à nos jours? », in N. Denizot, J.-L. Dufays & B. Louichon (Ed.), Approches didactiques de la littérature, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 33-48.
Caron, Philippe (1992), Des « Belles Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760), Louvain/Paris, Peeters.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Darme, Anouk (2018), Enseigner la grammaire pour développer l’expression de la pensée ? Eléments d’histoire de la grammaire scolaire en Suisse romande, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
David, Jérôme (2017), « Enseigner la littérature : une approche par les justifications (XIXe -XXIe siècles) », Transpositio, 1 [Page web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-une-approche-par-les-justifications-xixe-xxie-siecles
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Denizot, Nathalie (2015), « Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire », Tréma, 43 [Page Web]. URL : https://journals.openedition.org/trema/3301
Douay-Soublin, Françoise (1997), « Les recueils de discours français pour la classe de rhétorique », in M.-M. Compère & A. Chervel (Ed.), Les Humanités classiques, Paris, INRP, p. 151-185.
Gabathuler, Chloé (2017), « Manuel de lecture genevois au début du XXe siècle », Transpositio, 1 [Page Web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/manuels-de-lecture-genevois-au-debut-du-xxe-siecle
Gabathuler, Chloé & Bruno Védrines(2018), « Des pratiques d’enseignement de la littérature : quelques jalons historiques et analyses de pratiques effectives », in Ch. Ronveaux et B. Schneuwly (Ed.), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang, p. 43-66
Hofstetter, Rita (2012), « La Suisse et l’enseignement aux XIXe -XXe siècles. Le prototype d’une ‘Fédération d’États enseignants’ », Histoire de l’Éducation, n°134, p. 59-80.
Hofstetter, Rita & Anne Monnier (2015), « Construction de l'instruction publique et démocratisations contrastées », in G. Durand, R. Hofstetter, G. Pasquier, L. Palandella & Syndicat des enseignants romands (Ed.), Les Bâtisseurs de l'école romande. 150 ans du Syndicat des enseignants romands et de l'Educateur, Genève, Georg, p. 134-177.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (1998/2001), « Introduction », in R. Hofstetter & B. Schneuwly (Ed.), Le Pari des sciences de l’éducation, Bruxelles, De Boeck, p. 7-28
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (à paraître), « Les manuels comme emblèmes des reconfigurations disciplinaires de la forme école au 19e siècle ? Essai historiographique », in S. Wagnon (Ed.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : Enjeux actuels et perspectives, Berne, Peter Lang.
Houdart-Mérot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Monnier, Anne (2018). Le temps des dissertations. Chronique de l'accès des jeunes filles aux études supérieures (Genève, XIXe -XXe), Genève, Droz.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (Ed.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.
Rouiller, Viviane. (2018), « Apprendre la langue de la majorité des Confédérés ». Une discipline scolaire, entre enjeux pédagogiques, politiques, pratiques et culturels (1830-1990), Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Savatovsky, Dan (1999), « Le français: genèse d’une discipline », in A. Collinot & F. Mazière (Ed.), Le français à l’école: un enjeu historique et politique, Paris, Hatier, p. 36-76
Schneuwly, Bernard (2016), « Forme-t-on au même rapport à la langue des deux côtés de la Sarine ? Premières explorations dans les livres de lecture durant un siècle », Forumlecture, 2/2016 [Page Web]. URL : https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/573/2016_2_Schneuwly.pdf
Schneuwly, Bernard & Anouk Darme (2015), « La lecture dans la discipline Français. Analyse des plans d’études et des manuels de lecture de 1870 à 1990 dans le Canton de Genève », in L. Perret-Truchot (Ed.), Analyser les manuels scolaires. Questions de méthodes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.109-128
Schneuwly, Bernard & Joaquim Dolz (Ed.) (2009), Des objets enseignés en classe de français : le travail de l'enseignant sur la rédaction de textes argumentatifs et sur la subordonnée relative, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Tinembart, Sylviane (2018), « La littérature fait son entrée en classe primaire (1830-1990). Illustration de sa présence dans les plans d’études et les manuels de lecture du canton de Vaud », Forumlecture, 3/2018 [Page Web]. URL : https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/650/2018_3_fr_tinembart.pdf
Sources imprimées
Biolley, Alexis (1866), « Quelques mots sur la lecture et l’enseignement de cette branche du programme de l’école primaire », Educateur, 2(18), p. 298-302.
Bourqui, Auguste (1870), « Encore l’enseignement de la composition à l’école primaire », Educateur, 6(21), 328-340.
Duchosal, Henri (1918), Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée (2e éd), Genève : Imprimerie Atar.
Favez, Charles (1911, 19 février), « Classiques ou modernes ? », Gazette de Lausanne, 49 [Page Web]. URL : https://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1911_02_19/1/article/1309269/Favez
Hombert Joseph (1932), « Des Granges (Ch.-M), Morceaux choisis des auteurs français du moyen âge à nos jours », Revue belge de philologie et d'histoire, 11(1-2) [Page Web]. URL : https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1932_num_11_1_1371_t1_0181_0000_2
Mercier, Henri (1910), « L’Année littéraire », Annuaire de l’Instruction publique, 1, 83-108 [Page Web]. URL : http://doi.org/10.5169/seals-109043
Mercier, Henri (1911), « La lecture expliquée », Annuaire de l’Instruction publique, 2, p. 195-209 [Page Web]. URL : https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=aip-001:1911:2::10#256
Rambert, Eugène (1930), Alexandre Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, Lausanne : Payot.
Robadey, Louis (1933), « La lecture expliquée et, par elle, la culture littéraire », Bulletin pédagogique, 62 (13), p. 193-200.
Manuels et ouvrages scolaires
Emile, Bonjour (1925), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire, Lausanne, Payot.
Emile, Bonjour (1931), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur, Lausanne, Payot.
Des Granges, Charles-Marc (1910/1920), Morceaux choisis des auteurs français du moyen-âge à nos jours en vue de la lecture expliquée (842-1900). Classes de Lettres. 2e cycle, (14e éd.) Paris, Hatier.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1895/1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Adrien Borgeaud, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (avec Mercier H.). (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises, Lausanne, Payot.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1882), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg, Lausanne, Imprimerie Lucien Vincent.
Noël, François & François Delaplace (1804-1805), Leçons de littérature et de morale (2e éd., vol. 1-2), Paris, Le Normant.
Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Vinet, Alexandre (1829a), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1829b), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 2, Lectures pour l’adolescence, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1830), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 3, Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1833, 2e éd.), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Textes institutionnels
Commission suisse de maturité (CSM) (2012), Directives pour l’examen suisse de maturité, Confédération suisse. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [Page Web]. URL : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2006), Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations, Neuchâtel : CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010), Plan d’études romand, Neuchâtel : CIIP[Page Web]. URL : https://www.plandetudes.ch/per
Canton de Genève
Programmes de l’enseignement primaire (1852, 1875, 1889 1912, 1923) : Bibliothèque de Genève (BGE).
Programmes d’enseignement du Gymnase (1848-1886) : BGE.
Programmes d’enseignement et plans d’études du Collège de Genève (1855, 1877, 1889, 1900, 1925) : BGE.
Canton de Fribourg
Programmes et plans d’études pour l’enseignement primaire (1886, 1899, 1932) : Office du matériel scolaire Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire de l’Etat de Fribourg (BCUEF).
Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg (1850, 1876) : Archives d’Etat de Fribourg.
Programme général des cours de l’école cantonale de Fribourg (1848, 1856) : BCUEF.
Programme des études du collège et du lycée de Fribourg et de l’école normale d’Hauterive (1871) : BCUEF.
Programme des études du collège Saint-Michel (1887, 1926) : BCUEF.
Canton de Vaud
Catalogue des élèves du collège cantonal et de l’école préparatoire. Objets d’enseignement. (Année scolaire 1853-1854). Lausanne : Imprimerie Pache-Simmen.
Plan d’études pour l’enseignement primaire (1868, 1899, 1926) : Archives cantonales vaudoises (ACV)
Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud (1910) : ACV.
Programme des cours du Collège cantonal (1877, 1890) : ACV.
Annexe 1 : Contenus des parties qui composent le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard (1871)
- Histoire naturelle comprenant la zoologie, l’étude des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles et batraciens, poissons, insectes, mollusques, crustacés, zoophytes), la botanique (fleurs, herbes, arbres, arbres exotiques, arbustes) et l’industrie (machine à vapeur, imprimerie). De nombreuses illustrations accompagnent ces textes descriptifs. Parmi les 120 extraits, 23 sont d’Adam Vuillet et 20 de Milne-Edwards. La moitié sont anonymes.
- Descriptions et voyages qui reprend 16 récits d’auteurs différents, mais parmi lesquels nous retrouvons huit descriptions de voyages en Suisse.
- Histoire qui contient 15 morceaux dont « Regulus » de Chateaubriand déjà présent dans la Chrestomathie de Vinet. Là encore, la moitié des textes concerne l’histoire suisse.
- Biographies : parmi les huit portraits, certains mettent notamment à l’honneur deux pédagogues suisses (Pestalozzi et le père Grégoire Girard de Fribourg), mais également un inventeur (Jean-Marie Jacquard), un géologue (Esther de la Linth), un général d’empire (Antoine Drouot)
- Anecdotes-traits moraux-caractères : 21 extraits hétéroclites au niveau des sujets composent cette partie. Parmi eux figurent quatre textes de Fénélon et deux de La Bruyère.
- Style épistolaire : Mme de Sévigné côtoie Racine, Voltaire, Rousseau, Constant et Montesquieu, mais d’autres comme Joseph Joubert ou Paul-Louis Courrier sont également présents.
- Dialogues en prose sont constitués de trois extraits de théâtre dont un de Molière (Don Juan) et deux de Brueys et Palaprat (Patelin).
- Dialogues en vers au nombre de trois dans lesquels figure également Molière (Tartuffe), un extrait d’Edmé Boursault (Le Mercure Galant) et Petit-Senn.
- Poésie narrative et lyrique : sur les 31 extraits, il n’y a que trois fables de La Fontaine et deux de Florian. Par contre, nous trouvons deux textes de Lamartine et deux de Hugo.
Annexe 2 : La littérature prescrite en « français » dans la voie gymnasiale à Genève, 1900
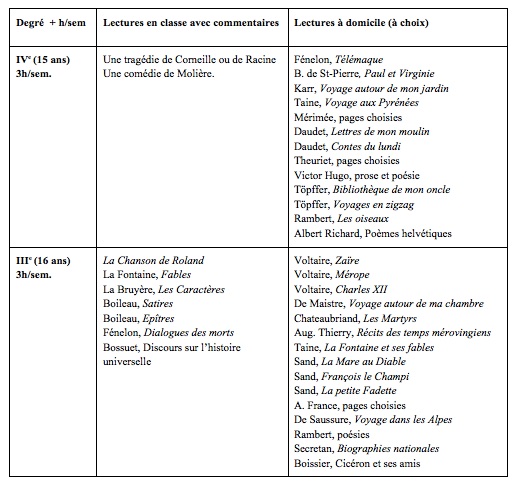
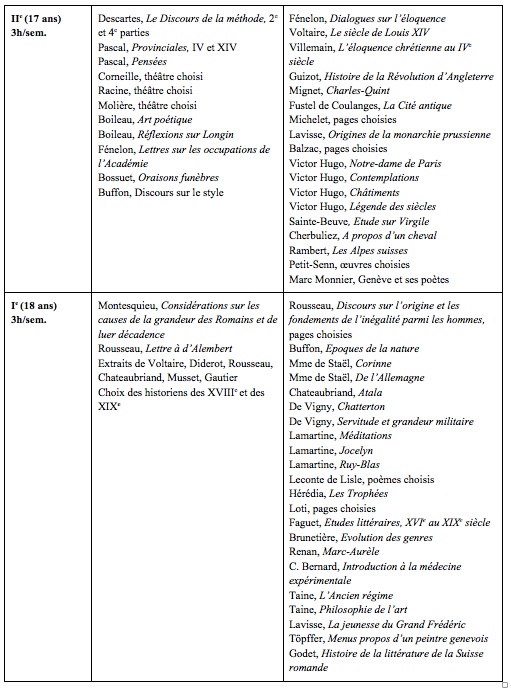
Alexandre Gavard (1845-1898): régent, puis professeur du collège, cet homme politique genevois sera désigné conseiller d’Etat en charge du Département des travaux publics, puis du Département de l’Instruction publique.
Louis Dupraz (1852-1920) : instituteur, puis maître de français au collège de Payerne, il complète sa formation en Lettres à Paris. Il est désigné professeur de français à l’école supérieure de jeunes filles de Lausanne en 1881. En 1893, il est nommé chef bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Il en devient le directeur en 1898.
[Page Web]. URL : https://data.bnf.fr/14301685/charles-marc_des_granges/
Pour citer l'article
Anouk Darme-Xu, Anne Monnier & Sylviane Tinembart , "L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/l-approche-historico-didactique-pour-penser-l-avenement-du-texte-litteraire-dans-l-enseignement-du-francais-suisse-romande-1850-1930
Voir également :
Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz
Sollicitée dans le cadre du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement», qui a pour objectif de « questionner les usages et l’ergonomie de la boîte à outils narratologique pour l’enseignement de la littérature aux degrés du secondaire I et II dans quatre pays francophones : la France, la Suisse, la Belgique et le Québec », je tiens d’emblée à préciser que mon expérience d’enseignement, de formation et de recherche autour du récit est ancrée dans ma fonction d’enseignante dans les degrés primaires de l’école publique genevoise, dans les années 1970-1980, au moment de la rénovation de l’enseignement du français dans les classes romandes.
Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz
Jean-Michel Adam
Professeur honoraire de linguistique française à l’Université de Lausanne, Jean-Michel Adam est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, traduits dans plusieurs langues, sur la linguistique textuelle, le récit, la description, l’analyse du discours littéraire et l’argumentation publicitaire. Derniers titres parus : Le Paragraphe (A. Colin 2018), Souvent textes varient (Classiques Garnier 2018), ainsi que la 4ème édition de Les Textes : types et prototypes (A. Colin 2017) et la 4ème édition de La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours (A. Colin 2020).
Françoise Revaz
Professeure émérite de linguistique française à l’université de Fribourg (Suisse) et narratologue, Françoise Revaz a dirigé plusieurs projets de recherche et publié de nombreux articles dans le champ de la linguistique textuelle et de la narratologie, dans le souci constant d’aborder la narrativité dans une variété de genres de discours: bande dessinée, entretiens thérapeutiques, historiographie, littérature et presse écrite.
Entretien
FR : Avant de répondre aux diverses questions ci-dessous, j’aimerais faire quelques remarques liminaires.
Sollicitée dans le cadre du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement», qui a pour objectif de « questionner les usages et l’ergonomie de la boîte à outils narratologique pour l’enseignement de la littérature aux degrés du secondaire I et II dans quatre pays francophones : la France, la Suisse, la Belgique et le Québec », je tiens d’emblée à préciser que mon expérience d’enseignement, de formation et de recherche autour du récit est ancrée dans ma fonction d’enseignante dans les degrés primaires de l’école publique genevoise, dans les années 1970-1980, au moment de la rénovation de l’enseignement du français dans les classes romandes. Dès lors, mes réponses au questionnaire ci-dessous vont déborder du cadre scolaire sélectionné dans la recherche du prof. Baroni, à savoir le secondaire I et II. Ce débordement me semble nécessaire dans la mesure où le rappel de ce qui s’est passé à cette époque, à Genève, au niveau de l’enseignement primaire ne peut qu’éclairer les processus d’appropriation du récit qui ont suivi dans les degrés du secondaire I et II dans toute la Romandie. La conséquence de cet ancrage dans mon tout début de carrière est que la question du processus de scolarisation du récit sera moins envisagée dans le cadre de l’enseignement de la littérature que dans le cadre plus large de l’apprentissage des types de textes dans l’enseignement du français.
Enfin, mes réponses résultent d’une plongée dans des souvenirs d’il y a parfois plus de quarante ans. A ce titre, elles doivent donc être considérées comme un témoignage personnel partiel et partial avec tout ce que cela comporte d’approximations et peut-être de faux souvenirs !
JMA : Avant de répondre aux questions, je dois introduire, moi aussi, deux remarques préalables. La première est que, très sincèrement, je ne peux rien dire d’un peu documenté sur l’enseignement actuel du français (langue maternelle, seconde ou étrangère) et sur la didactique de la langue et de la littérature. Je n’ai plus aucun contact avec ce domaine, sauf quand je suis sollicité pour des questions précises et plutôt théoriques par des collectifs de revues destinées aux enseignants comme Recherches (n°42, 2005 : «La notion de typologie de textes en didactique du français : une notion “dépassée”?» ; n°56, 2012 : «Discursivité, généricité et textualité» et n°76, 2022 : «Autour de l’explicatif»), Le Français aujourd’hui (Postface au n°175, 2011, consacré à «Littérature et linguistique : dialogue ou coexistence ?»), Québec français (entretien dans le n°99, 1995, et n°128, 2003 : «Entre la phrase et le texte») et, plus régulièrement, dans Pratiques (n°169-170, 2016 : «Pratiques, la linguistique textuelle et l’analyse de discours dans le contexte des années 1970» ; n°129-130, 2006 : réponses à des questions relatives au «contexte» et n°179-180, 2018 : réponses à un entretien sur la poésie ; ou encore le n°181-182, 2019 : «Linguistique – récits – narratologie», qui nous rapproche de l’objet du présent entretien, mais reste à un niveau historique et théorique). La seconde remarque préalable est que je n’ai aucune idée du devenir actuel de mes travaux dans le champ de la didactique, en France, Belgique, Suisse ou Québec. Les titres de quelques-unes de mes interventions des 20 dernières années donnent une idée de la place plutôt réduite de la narratologie dans ce qui m’a été demandé et pouvait donc éventuellement intéresser enseignant·e·s et didacticien·ne·s.
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous ?
FR : La question de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie ne peut être traitée indépendamment de la question plus générale de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la linguistique des textes. En outre, elle prend sa source dans un contexte historique particulier, à savoir le bouleversement opéré par le «renouvellement» de l’enseignement du français dans les années 1970, tant en Suisse romande qu’en France, en Belgique ou au Québec. Il me semble donc utile de proposer un bref rappel chronologique afin de situer l’émergence de l’enseignement du récit dans le contexte des innovations pédagogiques de cette époque et dans ses liens étroits avec la recherche en psychologie cognitive et en linguistique.
En 1967, une Commission interdépartementale romande de coordination de l’enseignement (CIRCE) produit un programme cadre pour l’enseignement du français dont l’objectif est la rédaction et l’adoption de plans d’études harmonisés. La première étape (CIRCE I) concerne les quatre premiers degrés de l’école primaire1 ; elle voit la publication, en 1972, d’un nouveau plan d’études. Puis, dans le cadre de CIRCE II, c’est un nouveau plan d’études pour les cinquième et sixième années primaires qui est publié en 1979.
Les plans d’études de 1972 et de 1979 marquent un jalon important puisqu’ils sont marqués par le «tournant communicatif» qui imprègne les recherches en didactique du français menées à cette époque. Ces plans se fondent clairement sur le fait que le langage est une pratique sociale «située» et que la langue, en tant qu’outil de communication, doit être enseignée via des activités en lien avec des genres discursifs et des actes de parole variés.
Pour pouvoir être appliquée cette réforme de l’enseignement du français ambitieuse et novatrice nécessitait encore une nouvelle méthodologie et des manuels eux aussi «renouvelés». C’est dans ce contexte que paraît en 1979 Maîtrise du français, un ouvrage méthodologique collectif rédigé par M.-J. Besson, M.-R. Genoud, B. Lipp et R. Nussbaum (actifs dans la formation des enseignants primaires genevois) sous la supervision et l’évaluation de deux professeurs de linguistique (E. Roulet et H. Huot) et d’un professeur de psychopédagogie de la langue (J.-P. Bronckart). L’idée forte était qu’il ne pouvait y avoir de renouvellement de l’enseignement du français sans maîtrise préalable d’un savoir linguistique chez les enseignants. Cet ouvrage, élaboré dans l’effervescence des recherches en linguistique et en psychologie cognitive, propose deux types d’activités : d’une part des activités dites de «structuration» autour du lexique, de la conjugaison, de la syntaxe et de l’orthographe, d’autre part des activités langagières dites de «libération» dont l’objectif est de permettre à l’élève de «libérer sa parole». La grande nouveauté de Maîtrise du français sera d’avoir donné une importance majeure aux activités de compréhension et de production de textes en classe via des exemples de genres et de visées différents, les théories de référence étant résolument la linguistique du texte.
L’introduction de l’enseignement rénové du français s’est faite de manière progressive dans les classes genevoises à partir de la rentrée scolaire 1980, via un recyclage de tous les enseignants primaires planifié sur plusieurs années. J’ai vécu ces étapes de recyclage de très près puisque, nommée institutrice dans la campagne genevoise en automne 1976, j’ai été sollicitée pour faire partie d’un petit groupe d’enseignants prêts à s’engager pour suivre une formation de linguistique et de didactique du français pendant deux ans, puis pour former à leur tour les collègues de leur circonscription. J’ai occupé cette fonction officielle d’«animatrice de français» jusqu’en automne 1984. Dans l’intervalle, j’ai eu l’opportunité de faire une licence en Sciences de l’éducation à l’Université de Genève et, dans ce cadre, de suivre les enseignements du professeur Jean-Paul Bronckart, dont plus particulièrement un séminaire de recherche en psychologie du langage centré sur une méthode d’analyse de quatre «architypes discursifs» : le discours en situation, le discours théorique ainsi que deux genres narratifs, le récit conversationnel et la narration. Une fois encore, la théorisation du récit était intégrée à une réflexion plus large sur divers types discursifs. Ce travail de recherche théorique a abouti en 1985 à la parution du Fonctionnement des discours, ouvrage dont j’ai fait une recension en 1988 dans le numéro 58 de la revue Pratiques. Dans la section « Perspectives didactiques », constatant «l’hétérogénéité propre à tout texte concret», je concluais que le modèle de Bronckart semblait «être la meilleure piste pour approcher non pas des types de textes, ce qui paraît encore trop ambitieux, mais des types de séquences textuelles» renvoyant ainsi aux propositions de Jean-Michel dans le numéro 56 de Pratiques.
En 1988, j’avais quitté l’enseignement primaire genevois depuis quelques années et avais été engagée en automne 1985 comme assistante de recherche par Jean-Michel, professeur de linguistique française récemment nommé à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. J’intégrais ainsi un projet de recherche interdisciplinaire consacré à la description… encore un genre textuel! Dans le cadre de cette recherche, je tentais d’appliquer le modèle de Bronckart via une grille d’analyse détaillée de marques linguistiques censées indiquer à quel genre discursif appartient un texte donné. C’est en analysant un corpus de textes descriptifs que j’ai pu constater que la distinction entre textes descriptifs et textes narratifs n’était pas si claire. En effet, je me trouvais face à des textes dont les marques linguistiques les faisaient osciller entre le genre narratif et le genre descriptif. Ces textes que, dans un premier temps, j’ai catégorisés comme des « descriptions d’action » étaient des textes dont la visée était effectivement descriptive mais qui décrivaient des personnages en action. Selon la grille d’analyse de Bronckart, les marques de surface relevées, des verbes d’action principalement, faisaient basculer ces textes dans la catégorie du genre narratif ! Cette découverte d’une catégorie intermédiaire, entre récit et description, m’a conduite par la suite, dans le cadre de ma thèse dirigée par Jean-Michel et intitulée «Aux frontières du récit», à élaborer une typologie de textes d’action (le fait divers, le conte, la nouvelle, la fable, et le roman, certes, mais aussi la recette, le mode d’emploi, l’horoscope, la notice nécrologique, le bulletin météo ou le reportage sportif), qui montrait l’existence de divers « degrés » de narrativité2.
Quant aux publications importantes des années 1980 qui ont certainement inspiré les chercheurs et les didacticiens, je citerais, outre les ouvrages de Jean-Michel sur le récit, deux ouvrages de psychologie cognitive: Le récit et sa construction de Michel Fayol paru en 1985 chez Delachaux et Niestlé et Il était une fois… Compréhension et souvenir de récits de Guy Denhière paru en 1984 aux Presses Universitaires de Lille.
JMA : J’ai l’habitude de me référer à des étapes et grandes dates de la recherche… Pour le versant « entrée dans les classes de la narratologie », je suis tenté de mettre en avant le travail accompli avec mes amis de la revue Pratiques, dans la seconde moitié des années 1970 et les années 1980. Je retiens surtout les années 1976-1978 et, en particulier, les numéros 11/12 (1976) et 14 (1977) de Pratiques et le n°38 (1978) de Langue Française: «Enseignement du récit et cohérence du texte». Dix ans après le n°8 de Communications consacré à « L’analyse structurale du récit », les paradigmes étaient en train de changer et nous mesurions mieux le fait que le récit n’est qu’une forme de mise en texte, à côté de bien d’autres formes importantes. À commencer par le dialogue, la description et le commentaire qui, soit se mêlent au récit de façon harmonieuse, soit l’envahissent et l’enlisent (abondance descriptive, invasion de commentaires méta-textuels). L’histoire de la littérature narrative est celle des diverses étapes de la fin de l’hégémonie du récit. À cette hétérogénéité constitutive, il faut ajouter l’argumentation en général, mais aussi l’explication et les discours régulateurs. Ce point est important car il explique mon rejet progressif du fondement de la «sémiotique narrative» de Greimas et de l’École de Paris, pour laquelle tout était récit.
Ce qui m’intéresse, c’est que nous ne cessons d’expliquer et de demander des explications. La compréhension des mystères de l’agir humain est au cœur de notre fascination pour les récits, mais elle n’a d’égal que l’explication continue des mystères du monde qui nous entoure et qui se traduit par les questionnements en pourquoi? dont usent et abusent les enfants, entre 3 et 7 à 8 ans. Nous avons tous fait l’expérience de cet «âge questionneur de l’enfant» (Piaget 1947 : 156), point de rencontre des logiques des adultes et des enfants que Saint-Exupéry place au cœur du Petit Prince:
Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d’explications. […]
[…] Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications.
Dans un de ses premiers livres, Le Langage et la pensée chez l’enfant (1923), Jean Piaget consacre d’ailleurs un chapitre entier (p. 155-208 de l’édition 1947) à la question des différentes sortes de pourquoi enfantins. Il distingue différents types d’explications et confirme l’importance sociocognitive de ce questionnement des adultes par les enfants.
Alors que l’omniprésence de la narration (fictionnelle, factuelle, mensongère) dans nos vies et dans toutes les pratiques discursives (de la religion et la littérature à la presse et la politique, en passant par l’histoire et la psychanalyse) est largement reconnue, les discours régulateurs incluant des consignes et des conseils, incitant à agir ou ne pas agir et guidant ainsi les actions humaines, de la cuisine à la circulation routière, du vestiaire sportif au champ de bataille, n’ont pas autant intéressé les chercheurs, même si les didacticiens y sont plus sensibles.
Mon dernier livre sur le récit pose la question du cadre théorique qu’il nous faut adopter pour aborder toutes ces questions. Il met en avant, pour cela, la problématique des genres de discours: Genres de récits. Narrativité et généricité des textes (Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2011).
2. En conséquence, quelles ont été, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français ?
JMA & FR : En 1988, de nouveaux moyens d’enseignement romands ont vu le jour dans le canton de Vaud, qui proposaient des activités «textuelles» pour les degrés du secondaire I (à l’époque 7e, 8e et 9e). L’enseignement des types de textes était réparti ainsi: en 7e, le texte narratif, en 8e, le texte informatif et en 9e le texte argumentatif. On voit que ces intitulés suivent les grandes lignes mentionnées plus haut.
Pour ce qui concerne la didactisation des recherches sur le récit et les autres formes de textualité, on peut renvoyer aux rôles importants du collectif de la revue Pratiques : d’André Petitjean (sur le récit et la description), de Jean-François Halté (sur le récit et l’explicatif), de Jean-Pierre Goldenstein (sur le récit), d’Yves Reuter (sur la description), de Michel Charolles (sur le récit et l’argumentation), de Caroline Masseron (sur divers genres de récits). Il suffit de citer les numéros suivants de Pratiques n°11-12, 1976: «Récit 1»; n°34, 1982: «Raconter et décrire»; n°55, 1987: «Les textes descriptifs», pour que se dessinent les grandes orientations et propositions qui en découlaient. La bascule se fait entre le n°56, 1987, sur «Les types de textes» et les n°59, 1988, sur «Les genres du récit» et n°66, 1990, sur «Didactique des genres». Les moyens d’enseignement qui se sont développés dans la francophonie ont largement suivi ce cadre que nous dessinions collectivement.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique ?
FR : Durant sept ans (entre 1989 et 1996), parallèlement à mon poste d’assistanat à l’UNIL, j’ai eu l’opportunité de proposer un enseignement ponctuel de deux mois par année sur les types de textes au Département d’audio-visuel et d’informatique (DAVI) de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Cet enseignement s’inscrivait dans une collaboration institutionnelle entre l’UNIL et l’ECAL. Il s’agissait d’animer un atelier intitulé «Construction du discours» qui consistait en une alternance de cours théoriques et de travaux pratiques (analyses de films) sur les théories de la communication et sur les discours narratif, descriptif, argumentatif et poétique.
Durant cette même période (1989-1996), l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a confié la formation continue des professeurs de français de l’Ecole de Commerce de Châtelaine (GE) à l’Unité de linguistique française de l’UNIL. En collaboration avec Jean-Michel, j’ai ainsi pu proposer des sessions de formation d’une semaine, deux fois par année, sur l’enseignement renouvelé du français. Nous avons abordé, une fois de plus, les types de séquences narrative, descriptive et argumentative tout en prolongeant dans les dernières années notre enseignement des types textuels dans le cadre de genres discursifs spécifiques tels que la presse et la publicité.
Au milieu des années 1990, à la suite d’une conférence donnée à la Sorbonne en 1992 dans le cadre des «Entretiens Nathan» intitulée «Enseigner à écrire des textes. L’expression écrite à l’école» et à l’article qui en a découlé sur les «schémas de récit» (Entretiens Nathan, Actes III, 1993), j’ai été sollicitée par l’éditeur Nathan, via Alain Bentolila, pour élaborer des moyens d’enseignement destinés aux élèves français de CE1, CE2, CM1 et CM2 et «conformes aux programmes de 1995». Il s’agissait, comme le rappelle la quatrième de couverture des ouvrages intitulés «Expression écrite» de proposer «cinq grandes catégories d’écrits, toutes liées à un objectif de communication, pour apprendre à l’élève à reconnaître à chaque fois l’objectif qu’il assigne à sa production: échanger, convaincre, expliquer, jouer avec la langue, raconter». Encore une fois, le récit n’était pris en compte que comme une forme de mise en texte parmi bien d’autres. Ce qui était mis en avant était moins l’apprentissage de formes textuelles précises que le repérage de divers buts communicatifs. Dans ces ouvrages, les productions spontanées de l’élève étaient systématiquement confrontées à l’observation de textes de natures différentes. Puis des outils textuels étaient proposés (vocabulaire, temps verbaux, connecteurs et organisateurs textuels) afin de permettre à l’élève de réécrire son texte initial « spontané » en l’améliorant. Pour rédiger ces ouvrages j’ai collaboré étroitement avec Bernard Schneuwly de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation (FPSE) et avec le Service du français de l’enseignement primaire du canton de Genève3.
JMA : Outre ma participation à certains numéros de Pratiques, dès le début de l’existence de la revue, je dirai que mon travail a consisté à introduire aux grandes théories du récit, en particulier dans mon Que sais-je ? (n°2149): Le Récit, qui a connu six rééditions entre 1984 et 1999. De Propp aux théories énonciatives et textuelles de la narration, en passant par la sémiotique de Greimas, la narratologie de Genette, la socio-linguistique de Labov et les recherches de psycholinguistique sur le récit (en particulier Michel Fayol: Le récit et sa construction, déjà cité plus haut par Françoise). À côté, dans Le Texte narratif (Nathan 1985 & nouvelle éd. 1994), je replaçais cette fois ces travaux narratologiques dans le cadre théorique unifié de la linguistique textuelle4. En multipliant les exemples d’analyses je me suis efforcé d’indiquer comment passer de la théorie à l’analyse de textes très différents, pas uniquement littéraires (comme c’était le cas dans une certaine narratologie littéraire).
Je suis surtout fier de notre petit ouvrage de la collection Mémo, L’analyse des récits, au Seuil (n°22, 1996), dans lequel les recherches de Françoise ont permis des avancées significatives. L’ouvrage est, grâce à notre collaboration, une réussite en termes de clarté des définitions et distinctions de concepts clés.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort ?
FR : Le concept narratologique certainement le plus souvent mobilisé a été la formalisation du récit sous la forme d’une structure prototypique comportant cinq macro-propositions de base (le fameux « schéma quinaire »). L’engouement pour ce schéma et son emploi incontournable tant au niveau de la réception/compréhension des récits que de la production doit être replacé dans le contexte épistémologique des années 1960-1970 marqué par le structuralisme et le distributionnalisme. Si du côté de la structuration des phrases les emprunts à la grammaire générative de Chomsky imposaient alors aux élèves de représenter les phrases selon un modèle arborescent (dans une organisation hiérarchique de leurs constituants), la même apparente rigueur formaliste était comblée par le schéma quinaire. On peut ainsi faire l’hypothèse que les enseignants se sont emparés de ce schéma que Jean-Michel avait élaboré en tenant compte des travaux de Todorov, de Greimas, de Labov et de Larivaille (auquel il a été attribué par la suite, à la plus grande surprise de ce dernier) parce qu’il offrait un modèle concret pour l’analyse et la production de récits. Le problème a évidemment été l’imposition rigide du schéma quinaire, sa grammaticalisation.
JMA : Parmi les autres concepts, présentés largement dans notre Mémo commun et dans nos deux livres sur le récit, il faudrait probablement citer le schéma actantiel de Greimas, souvent utilisé pour distinguer les rôles profonds des personnages de surface, et la question de l’ordre du récit (discordances entre l’ordre du texte et celui de l’histoire) dont Genette a bien montré que le cas de la chronologie absolue est extrêmement rare et que la norme est le désordre de la suite, non chronologique, des événements et actions.
Pour répondre à la dernière partie de votre question, je vois au moins trois concepts oubliés. Le premier est celui de gradients de narrativité. Tous les textes ne sont pas des récits et ils le sont, de surcroît, à des degrés divers : ils sont plus ou moins narratifs. Comme les travaux de Françoise l’ont montré, une description d’actions est faiblement narrative et ce qui est intéressant c’est : quels aspects sont communs avec le récit et lesquels avec la description ?
Le deuxième concept oublié découle de ce premier point : c’est celui d’hétérogénéité textuelle et de dominante. L’effet global a tendance à l’emporter sur les différences locales et, de ce fait, sur la complexité compositionnelle du tout textuel.
Le troisième est celui de scène ou épisode. À côté des découpages séquentiels de l’intrigue, un épisode correspond souvent à un chapitre, comme c’est le cas dans Le Petit prince, déjà mentionné plus haut, dont la lisibilité tient probablement à ce découpage en petits épisodes d’une histoire dont la structure temporelle est particulièrement difficile à rétablir. Les scènes-types de la vie quotidienne (scripts d’action dans le monde: aller au restaurant, prendre le train ou l’avion, commander ses courses sur internet, saluer un inconnu, dire au revoir, etc.) et les scènes-types de genres de récits (bagarre du western, piège tendu au coupable d’un récit policier, triplication des épreuves subies par le héros d’un conte, etc.), sont d’une très grande importance pour la lecture comme pour l’écriture.
FR : Si je peux me permettre un témoignage personnel à propos du schéma quinaire, j’ai vécu l’enseignement du récit au secondaire I au début des années 1990 via mes filles scolarisées à Lausanne. J’ai ainsi pu constater à quel point les enseignants voulaient faire entrer tous les récits dans ce cadre quinaire rigide. Plus grave, ma fille aînée s’est vue sanctionnée pour la rédaction d’un récit d’imagination dont le seul défaut était qu’il ne comportait pas toutes les phases du schéma! Elle s’était en effet autorisée à ne pas décrire la situation finale, au demeurant facilement déductible du dénouement.
En somme, si l’analyse structurale des récits a permis la prise en compte de ce type de textes dans leur réalité formelle, elle a malheureusement autonomisé le texte narratif au point d’en oublier l’aspect communicationnel et les visées pragmatiques indissociables de toute production narrative.
Un autre concept, moins narratif qu’énonciatif, mais dont tous les manuels ont abusé (et abusent encore) pour théoriser le récit est la notion de «récit/discours», terme simplificateur que les rédacteurs de manuels (tout comme de nombreux linguistes!) attribuent à Émile Benveniste (1966). Ce dernier – qui souhaitait établir un système des temps verbaux construit non plus sur la fameuse tripartition temporelle en passé, présent, futur mais sur un critère énonciatif – a certes proposé de distinguer l’«énonciation historique» dont le temps pivot est le passé simple et l’«énonciation de discours» dont le temps pivot est le présent. Malheureusement, cette opposition entre deux modes énonciatifs s’est transformée très vite en une opposition entre deux types de textes: le récit et le discours oral. En 1998, nous avions rédigé Jean-Michel et moi, en collaboration avec Gilles Lugrin, un article dans Pratiques n° 100, afin de dénoncer ce raccourci dommageable5. Mais le couple « récit/discours » semble s’être installé durablement dans les manuels de français.
Durant les 17 ans de ma charge de professeure de linguistique française à l’université de Fribourg (2001-2018), je n’ai cessé, tant dans les formations continuées que dans les cours destinés aux futurs enseignants de français, de montrer les problèmes concrets que pose cette dichotomie «récit/discours», le problème majeur étant évidemment la place du récit au passé composé6. Pendant toutes ces années, j’ai vu passer plusieurs lignes de manuels, édités chez Nathan, Belin, puis chez Hatier. Les manuels Hatier, dûment agréés par la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et actuellement utilisés dans les classes, reprennent la dichotomie «récit/discours» sous une nouvelle désignation : «énoncé coupé» vs «énoncé ancré». Cette allusion à une coupure de (ou un ancrage dans) la situation d’énonciation désigne de façon caricaturale «les récits menés au passé simple» d’une part, «les lettres et les dialogues réels ou fictifs» d’autre part.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français ?
JMA : Je citerais d’abord Jean Peytard, dans le n°38 (mai 1978) de Langue Française, consacré à « Enseignement du récit et cohérence du texte », dont j’ai déjà parlé plus haut. Il termine ainsi sa présentation du numéro: «La théorie, ici comme ailleurs, permet à l’enseignant de prendre aussi distance par rapport à lui-même et à sa pratique. Pour s’en défier et ne point s’y confondre» (p. 6). Nous ne visions pas autre chose, dans le cadre du collectif de la revue Pratiques, dans le cadre de la formation des enseignants, dans nos échanges avec les formateurs, en Suisse, au Québec, en Belgique et en France, et dans nos contacts avec les concepteurs de manuels. Nous avons toujours distingué ce qui concerne l’enseignement, d’une part, et la recherche, d’autre part.
Les concepts travaillés dans le cadre de nos recherches sur la textualité et les degrés de narrativité ou d’argumentativité des textes n’étaient jamais destinés à l’application directe en classe! Il s’agissait d’indiquer des directions en vue de transpositions et d’adaptations aux besoins des enseignants, sur la base d’une formation initiale et continuée digne de ce nom. C’est du moins ce que nous attendions de la didactique et de la formations initiale et continuée que nous ne prétendions pas remplacer.
Pour en revenir à votre question, que Finkielkraut, Orsenna7 et d’autres aient rendu les concepts narratologiques, rhétoriques et linguistiques responsables de la «détérioration de l’enseignement-apprentissage du français», c’est à la fois trop d’honneur et un absurde aveuglement qui ne mérite même pas d’être discuté. L’état de l’enseignement de la langue maternelle et de la culture littéraire et artistique dépasse les questions de méthodes. Les didacticiens ont, depuis un certain temps déjà, appris à prendre leurs distances par rapport aux données de la recherche universitaire. Nous n’entrerons donc pas dans ce débat, nous contentant de dénoncer le fait que certaines dérives didactiques aient pu aboutir au fait de plus enseigner le «schéma quinaire» du récit ou l’opposition «récit/discours» ou les divers types de «focalisations» au lieu d’étudier les textes et les usages contextuels de la langue et des langues. On a trop confondu le moyen et le but, l’outil d’exploration et de découverte et les visées d’un projet de formation et d’acquisition-construction de connaissances.
La question de la théorie et des outils conceptuels comme instruments de mise à distance des objets étudiés est une question plus large d’épistémologie de la connaissance. Comme le dit Gaston Bachelard dans le Rationalisme appliqué, la connaissance scientifique, comme toute connaissance formatrice, est une connaissance double: «Elle est à la fois intuition sensible et intuition intellectuelle. Qui peut aller par la pensée de la flamme à la frange d'interférence connaît la lumière du cuivre intimement. Et s'il souhaite revenir par la perception de la frange à la flamme il n'a en rien diminué son bonheur de voir» (1949, p. 21-22). Nous sommes en train de sombrer dans un monde qui a remplacé l’usage de la raison par les fictions alternatives et l’indistinction des projections fantasmatiques et idéologiques en rejetant tout acte de connaissance. Il me semble que l’histoire est actuellement en première ligne, confrontée qu’elle est aux récits alternatifs et révisions en tous genres. Alors, non, si nous en sommes là, ce n’est pas la faute à la narratologie classique! Et oui, la narratologie pourrait être en première ligne, avec l’analyse de discours, pour interroger le problème des «narratifs» étatiques et groupusculaires. En particulier, elle devrait permettre de démonter les mécanismes de mise en place de la causalité narrative, masquée sous la consécution temporelle, les mécanismes de constitution de héros et de bouc émissaires, de détournement de la parole. La force de conviction du récit est utilisée aussi bien dans l’explication (en lieu et place de «parce que») que dans l’argumentation (exemplum). On le sait bien depuis la Rhétorique d’Aristote.
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général ?
JMA : Comme toute démarche de connaissance – et pas plus que les autres (en particulier l’enseignement de l’argumentation et de la rhétorique, de la langue et des langues) – l’analyse des différentes formes de récit, des ressources manipulatoires de la narration qui commencent par l’usages des temps verbaux du français et des autres langues est d’une indéniable importance. Toute démarche de connaissance susceptible d’introduire une mise à distance par rapport à l’objet d’étude est, à nos yeux, importante.
Alors que la société enseigne l’exaltation d’un moi hédoniste et consumériste, l’école est le lieu de la rencontre d’une altérité radicale: celle des grands textes (pas seulement littéraires), d’objets qui résistent dans leur altérité à un usage immédiat, libre et personnel. Les langues étrangères et la langue étrangère des grands textes littéraires sont des lieux d’altérité qui nous décentrent de nous-mêmes. Je sais que cela va à l’encontre de certaines approches des textes littéraires qui ont actuellement le vent en poupe. Je n’exclus pas d’autres usages ludiques et personnels des récits, mais il y a des choses que seule l’école peut enseigner et c’est sur cela que nous devons concentrer nos efforts. C’est du moins notre raison, encore actuelle, de travailler et de répondre à un entretien comme celui-ci.
FR : Je n’ai pas suivi les évolutions «actuelles» de la didactique du français, mais j’ai pu constater que la place du récit dans les manuels d’enseignement (du secondaire inférieur entre autres) est tributaire de la volonté de ratisser large et de prendre en compte toutes sortes de textes qui «racontent». Or, la variété des récits devrait être théorisée à l’aulne des gradients de narrativité, ce qui n’est jamais fait. On se retrouve face à ce paradoxe en tant qu’enseignant: d’un côté, une variété d’exemples de textes qui racontent proposés à la lecture et à l’analyse des élèves ; de l’autre côté, des notices théoriques qui ne présentent que le seul récit canonique, à savoir un récit à la 3e personne et au passé simple. Les autres textes sont ainsi considérés comme des exceptions (par exemple, les récits en JE rédigés au passé composé). Comment alors aborder avec pertinence L’Etranger de Camus ?!?
Dans la mesure où certains chercheurs, dont Raphaël Baroni, envisagent de repérer quels outils issus de recherches narratologiques récentes seraient susceptibles d’être utilisés dans l’enseignement de la littérature8, j’aimerais conclure cet entretien sur une réflexion à propos d’une notion qui paraît très en vogue actuellement: la narratologie «transmédiale» (ou «intermédiale»). Tout d’abord il me semble que ce n’est pas tant la narratologie qui doit être qualifiée de transmédiale mais son objet, à savoir l’ensemble des récits qui se manifestent dans des médias divers, sous des formes verbales ou non verbales. Si maintenant la narratologie transmédiale désigne simplement l’étude des pratiques narratives dans divers médias, alors il n’y a rien de nouveau sous le soleil narratologique puisque, sans parler de transmédialité, Barthes et bien d’autres contemporains structuralistes parlaient déjà dans les années 1960-1970 de la diversité des récits du monde (oraux, écrits, en images fixes ou animées). J’ai moi-même été toujours intéressée à élargir l’objet de mes investigations narratologiques en analysant des récits issus de formations discursives diverses (presse, bande dessinée, entretiens médicaux, etc.) et en revisitant à ces occasions les théories narratives existantes. En travaillant par exemple sur le genre du récit «suspendu» (ou feuilleton), j’ai pu mettre en évidence que ce dernier constitue bien un objet «transmédiatique» puisqu’il peut se manifester sous la forme d’un feuilleton télévisé ou journalistique, d’un feuilleton littéraire ou encore d’une histoire à suivre en bandes dessinées. A mon sens, dans la mesure où les productions narratives peuvent appartenir à différents médias, la transmédialité est assurément « constitutive » de la narrativité.
Si je ne peux que saluer l’élargissement de l’analyse narratologique aux récits non strictement verbaux, je redoute cependant que l’objectif de refonder les concepts de la narratologie afin «de les rendre suffisamment souples pour s’adapter à n’importe quel média» (Baroni, ibid., p.2) ne s’accompagne d’une définition de la narrativité plus cognitive que verbale, comme semble le réclamer Marie-Laure Ryan qui prétend en effet que «le récit n’est pas un objet linguistique mais une représentation mentale» (Introduction à la narratologie postclassique, dir. S. Patron, 2018, p. 154). Face à une définition de la narrativité fondée sur un invariant tellement large, je crains pour ma part que la notion de narratologie transmédiale ne perde toute pertinence. Mais ce n’est que le modeste avis d’une narratologue-linguiste!
En conclusion, ne contribue-t-on pas à une inflation des notions en adoptant ce concept de narratologie transmédiale? Ou alors est-ce simplement une stratégie pour assurer la survie des institutions universitaires qui, comme le remarque très justement Jürgen E. Müller dans un article de 2006 sur l’intermédialité (Médiamorphoses, n° 16: 99-100), «ne peuvent plus bâtir leur légitimité scientifique sur un partage disciplinaire strict du savoir» ?
Références citées
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Que sais-je ?».
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif, Paris, Nathan-Université.
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Que sais-je ?».
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif, Paris, Nathan-Université.
Adam, Jean-Michel (2003), «Entre la phrase et le texte : la période et la séquence comme niveaux intermédiaire de cohésion», Québec français, n° 128, p. 51-54. URL: https://id.erudit.org/iderudit/55780ac
Adam, Jean-Michel (2005), «La notion de typologie de textes en didactique du français: une notion “dépassée”?», Recherches, n° 42.
Adam, Jean-Michel (2011a), Genres de récits : narrativité et généricité des textes, Louvain-la-Neuve, Academia, coll. «Sciences du langage : carrefours et points de vue n° 4».
Adam, Jean-Michel (2011b), «Postface - Littérature et linguistique : dialogue ou coexistence ?», Le français aujourd'hui, n° 175 (4), p. 103-114. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2011-4-page-103.htm
Adam, Jean-Michel (2012), «Discursivité, généricité et textualité», Recherches, n° 56.
Adam, Jean-Michel (2016), «Pratiques, la linguistique textuelle et l’analyse de discours, dans le contexte des années 70», Pratiques, (169-170). URL: https://dx.doi.org/10.4000/pratiques.2931
Adam, Jean-Michel (2017 [1992]), Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan Université.
Adam, Jean-Michel (2019), «Linguistique – récits – narratologie», Pratiques, n°181-182. URL: https://dx.doi.org/10.4000/pratiques.5632
Adam, Jean-Michel (2022), «Autour de l’explicatif», Recherches, n° 76.
Adam, Jean-Michel, Guy Achard-Bayle, Dominique Maingueneau, B. Combettes & Sophie Moirand (2006), «Textes/Discours et Co(n)textes. Entretiens avec Jean-Michel Adam, Bernard Combettes», Pratiques, n° 129-130, p. 20-49. URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2006_num_129_1_2094
Adam, Jean-Michel, Gilles Lugrin & Françoise Revaz (1998), «Pour en finir avec le couple récit / discours», Pratiques, n° 100 (1), p. 81-98.URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1998_num_100_1_1853
Adam, Jean-Michel & Françoise Revaz (1996), L'analyse des récits, Paris, Seuil, coll. «Mémo 22. Lettres».
Bachelard, Gaston (1949), Le rationalisme appliqué, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Bibl. de philosophie contemporaine. Logique et philosophie des sciences».
Baroni, Raphaël (2017), «Pour une narratologie transmédiale», Poétique, n° 182 (2), p.155-175. DOI: https://doi.org/10.3917/poeti.182.0155
Benveniste, Émile (1966), Problèmes de linguistique générale, Paris, N.R.F., coll. «Bibliothèque des Sciences humaines».
Bronckart, Jean-Paul, Daniel Bain & Bernard Schneuwly (1985), Le fonctionnement des discours: un modèle psychologique et une méthode d'analyse, Lausanne, Delachaux et Niestlé, coll. «Actualités pédagogiques et psychologiques».
Denhière, Guy (1984), Il était une fois... Compréhension et souvenir de récits, Lille, Presses universitaires de Lille, coll. «Psychologie cognitive».
Fayol, Michel (1994 [1985]), Le récit et sa construction : une approche de la psychologie cognitive, Lausanne , Delachaux & Niestlé, coll. «Actualités pédagogiques et psychologiques».
Genot, Gérard (1984), Grammaire et récit : essai de linguistique textuelle, Nanterre, Université Paris X - Centre de recherches de langue et littératures italiennes.
Müller, Jürgen E. (2006), «Vers l'intermédialité. Histoires, positions et options d'un axe de pertinence», MédiaMorphoses, n°16, p. 99-110. URL: https://www.persee.fr/doc/memor_1626-1429_2006_num_16_1_1138
Paret, Marie-Christine & Raymond Blain (1995), «La structure compositionnellle des textes - entretien avec Jean-Michel Adam», Québec français, n° 99, p. 54-57. URL: https://id.erudit.org/iderudit/44223ac
Revaz, Françoise (1993), «L'expression écrite à l'école: les "schémas de récit"», in Les entretiens Nathan, Actes III, A. Bentolila (dir.), Paris, Nathan, p. 131-140.
Ryan, Marie-Laure (2018), «Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiale», in Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, S. Patron (dir.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Pour citer l'article
Jean Michel Adam & Françoise Revaz, "Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-michel-adam-et-de-francoise-revaz
Voir également :
Témoignage de Jean-Paul Bronckart
Nous amorcerons notre diachronie par l’examen d’une phase qui, si elle se situe dans la préhistoire des emprunts et usages aux théories textuelles et narratologiques, fournit néanmoins, pour cette raison même, un utile éclairage sur les raisons pour lesquelles ces emprunts se sont avérés utiles ou nécessaires. Nous remonterons à la publication, en France, du Plan Rouchette, qui a constitué le déclencheur des démarches d’adaptation/modernisation des programmes et méthodes didactiques, requises d’un côté par la volonté politique de démocratisation de l’enseignement et d’un autre par un souci de mise à jour ou de modernisation des méthodes pédagogiques et des références théoriques, en particulier linguistiques.
Témoignage de Jean-Paul Bronckart
Jean Paul Bronckart
Professeur honoraire de didactique des langues à l’université de Genève, Jean-Paul Bronckart a développé divers programmes de recherche portant notamment sur l’épistémologie des sciences humaines/sociales, l’analyse des discours, les processus d’acquisition du langage et la didactique des langues.
Entretien
Dans la mesure où elles requièrent un examen rétrospectif à caractère en partie au moins autobiographique, les réponses que nous proposerons aux questions qui nous sont adressées saisiront la problématique des emprunts et usages des théories du récit dans le cadre plus large que nous nous sommes donné dans nos travaux, à savoir celui de l’investigation, sur les plans didactique et théorique, des théories du texte, des genres de textes et des types discursifs. Nos réponses seront en outre marquées par le fait que nos interventions didactiques ont, pour des raisons institutionnelles, concerné surtout l’enseignement primaire, avec néanmoins des interventions épisodiques dans l’enseignement secondaire inférieur.
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Nous amorcerons notre diachronie par l’examen d’une phase qui, si elle se situe dans la préhistoire des emprunts et usages aux théories textuelles et narratologiques, fournit néanmoins, pour cette raison même, un utile éclairage sur les raisons pour lesquelles ces emprunts se sont avérés utiles ou nécessaires. Nous remonterons à la publication, en France, du Plan Rouchette, qui a constitué le déclencheur des démarches d’adaptation/modernisation des programmes et méthodes didactiques, requises d’un côté par la volonté politique de démocratisation de l’enseignement et d’un autre par un souci de mise à jour ou de modernisation des méthodes pédagogiques et des références théoriques, en particulier linguistiques. L’accent majeur de cette réforme était d’abandonner l’hyper-centration sur un enseignement grammatical à visée orthographique, et de se donner comme objectif premier le développement et la maîtrise des capacités d’expression/communication.
Dans la mise en place de ce Plan, il s’agissait d’abord d’inciter les élèves à «libérer» leurs capacités verbales et à les adapter aux diverses situations de communication et ensuite de compléter cette démarche par des «approfondissements analytiques» structurels, qui en l’occurrence étaient inspirés des premiers écrits de grammaire générative, considérés alors comme la ressource scientifique la plus «sérieuse» dans le domaine de la structuration des connaissances langagières.
La Suisse romande a adhéré d’emblée à cette démarche, ce qui s’est concrétisé par l’élaboration de Maîtrise du français (1979), ouvrage à la réalisation duquel le signataire a participé en effectuant une large part de la formation linguistique des auteurs. C’est dans le chapitre de cet ouvrage consacré à la morphosyntaxe du verbe qu’apparaît l’une des premières références à des notions d’ordre narratologique, en l’occurrence une présentation de l’opposition discours/récit inspirée de l’ouvrage de Weinrich (1973), qui visait essentiellement à mettre en évidence et à conceptualiser les valeurs des temps des verbes; domaine qui fut et est resté celui de l’emprunt majeur aux théories narratologiques.
Dans le canton de Genève, une réforme de l’enseignement inspirée de Maîtrise du français ayant été engagée à partir des années 1985, il a fallu préparer les enseignants du secondaire inférieur à l’accueil d’élèves ayant bénéficié de cette réforme, et leur proposer de nouveaux moyens d’enseignement; ceux-ci n’existant guère sur le marché, il a été décidé de créer une série de moyens d’enseignement, en l’occurrence les manuels Pratique de la langue, 7e, 8e et 9e, élaborés dans l’urgence en 1988-89 et publiés en 1990. Ces trois manuels comportaient un premier chapitre centré sur les propriétés d’un ou deux genres de texte et, puis de nombreux chapitres centrés sur la grammaire, et enfin un chapitre final intitulé «De la phrase au texte».
- - Le premier chapitre du manuel de 7e portait sur les textes narratifs et les descriptions, et présentait les notions de «phases du plan» et de «narrateur» issues de l’ouvrage Le texte narratif de J.-M. Adam (1985). Le chapitre final intitulé «le fonctionnement discursif des unités» était centré sur les conditions d’usage des temps des verbes et sur les enchainements d’organisateurs temporels.
- - Le premier chapitre du manuel de 8e, était centré sur les textes informatifs et proposait un ensemble de notions ayant trait à la progression thématique, telle qu’elle était présentée dans l’ouvrage de Combettes (1983). Le chapitre final était centré sur les reprises anaphoriques et les modalisations dans une perspective inspirée des travaux du signataire.
- - Le premier chapitre du manuel de 9e était consacré à l’argumentation dans les textes, avec des références à la linguistique textuelle allemande; le chapitre final, d’inspiration pragmatique, était centré sur le fonctionnement des connecteurs et le discours rapporté.
À cette même époque, le signataire a créé, chez l’éditeur Delachaux et Niestlé, une nouvelle collection intitulée Techniques et méthodes pédagogiques, dont le but était de «contribuer à la création de moyens didactiques efficaces, inspirés des théories nouvelles, tout en restant centrés sur les besoins pratiques des éducateurs». Le premier ouvrage de cette série, L’écriture buissonnière; pédagogie du récit (Bach 1987), était destiné à l’enseignement secondaire. Il comportait des références explicites aux écrits d’Adam, Brémond, Bronckart, Greimas et Propp; il introduisait les notions d’«acteurs-narrateur», de «schéma narratif», de «personnage» et présentait surtout une nouvelle approche de la valeur des temps des verbes, tout en considérant que «le modèle théorique choisi n’a pas grande importance; l’essentiel est qu’il y en ait un». (Bach: 25). Il y eut une suite à cette approche dans le remarquable ouvrage de Tauveron (1995) centré sur une approche du «personnage» destinée à l’enseignement primaire.
Au cours de la décennie 1990-2000, divers ouvrages à visée didactique ont introduit des notions issues de la linguistique textuelle et de la narratologie. En 1994, Genevay a publié Ouvrir la grammaire, ouvrage conçu comme document de référence de l’enseignement du français au cycle secondaire du canton de Vaud. Dans cet ouvrage sans référence théorique et sans la moindre indication bibliographique, les trois premiers chapitres traitaient de trois aspects de l’organisation textuelle: d’abord, sous l’intitulé «le cadre de l’énonciation», une présentation des valeurs des temps des verbes et des conditions d’usage des «marqueurs de lieu» et des «mots personnels»; ensuite un chapitre sur les modes de réalisation des divers actes de parole; enfin un chapitre sur les marques de modalisation et les discours rapportés. Suivaient dans cet ouvrage quatre longs chapitres de «grammaire de phrase» d’inspiration radicalement chomskyenne. Venait enfin un chapitre terminal intitulé «Cohésion et progression du texte», mais qui était de fait centré sur les modalités d’articulation, dans la textualité, des structures syntaxiques, sans prise en compte effective de la textualité même.
Au Québec, a été publié en 1999 la Grammaire pédagogique du français aujourd’hui, ouvrage dirigé par S. Chartrand, réédité en 2011 et toujours en usage, qui est destiné aux élèves du secondaire et à leurs enseignants. Cet ouvrage propose ce qui est qualifié de «grammaire du texte», long chapitre comportant d’abord une définition de cette grammaire, puis des développements ayant trait aux reprises anaphoriques, au discours rapporté et à la modalisation, et enfin une approche centrée sur les «modes de discours», consistant en l’occurrence en une reformulation des «séquences» telles que J.-M. Adam les a présentées dans diverses publications.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Issue d’une profonde analyse de Verret (1975), la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1985/1991) pose que la confection des objets d’enseignement procède par transformation de savoirs savants en savoirs à enseigner, puis par transformation de ces derniers en savoirs tels qu’ils sont enseignés, en un processus à l’issue duquel les savoirs de référence se trouvent détachés du système théorique au sein duquel ils ont émergé, découpés et réorganisés en fonction des objectifs et de la programmation d’une matière scolaire.
Comme Brassart & Reuter (1992) ainsi que Chervel (1998) notamment, nous avons questionné la pertinence et l’éventuelle spécificité de cette théorie pour l’enseignement du français, en raison de l’hétérogénéité des théories proposées dans le champ linguistique et du fait que divers objets de cette matière scolaire n’avaient pas d’origine proprement scientifique. Cette réserve demeure pour ce qui concerne l’exploitation didactique de notions issues de la narratologie, en raison certes de la richesse/diversité des cadres théoriques en ce domaine, mais en raison surtout de la diversité, du peu de clarté voire de la confusion des objectifs didactiques ayant trait à ces notions. Comme Veck, Fournier & Lancrey-Javal (1990) l’avaient montré à propos de la notion de thème, la transposition dans les programmes de littérature prend régulièrement la forme d’un déplacement sémantique résultant de l’insertion de ce terme nouveau dans un paradigme de termes anciens de valeurs parentes.
À notre avis, le problème majeur en ce domaine n’a pas trait à la richesse ou même à l’hétérogénéité des données théoriques, mais plutôt au fait que les visées et objectifs didactiques en ce domaine, et en conséquence la place et le statut que peuvent y prendre les notions et/ou concepts narratologiques, ne sont aujourd’hui pas clarifiés. Ce qui n’est pas le cas dans le domaine proprement grammatical où l’histoire de l’enseignement, quelle que soit sa lourdeur (ou en raison de sa richesse), a fourni des éléments de réflexion sur la base desquels peuvent être plus aisément élaborés des objectifs, des programmations et des principes de progression.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique ?
Dans mon parcours de didacticien, ayant été formé à la grammaire générative par Nicolas Ruwet à l’Université de Liège, dès mon arrivée à Genève au début des années 1970, j’ai pu œuvrer pendant quatre décennies à la transposition des notions de grammaire de phrase; tâche au fond assez simple quant à la construction d’un système de notions qui soit cohérent et assez clairement structuré. Cependant, si les objectifs de maitrise notionnelle voire conceptuelle étaient clairs en ce domaine, l’utilité même de ces connaissances formelles pour une maitrise de l’usage de la langue l’était beaucoup moins.
Sur le plan discursif/textuel, nous avons proposé dans deux ouvrages (Bronckart et al. 1985; Bronckart 1997), des constructions théoriques puisant à divers cadres théoriques et y mettant notre grain de sel, et nous demeurons convaincu de la pertinence globale de notre mode d’analyse des valeurs des temps des verbes, ainsi que de notre analyse des types discursifs. Quant à la transposition didactique, nous avons été confronté aux difficultés globales énoncées plus haut pour les concepts narratologiques; en ce domaine nous avons eu, et nous avons encore, le souci majeur de ne pas saisir les entités textuelles dans une perspective dogmatique, comme c’est le cas pour certaines approches centrées sur les genres textuels et leurs propriétés présumées. La situation reste donc difficile en ce domaine notamment faute d’une clarté sur le lieu de cette transposition dans la structure technique et signifiante des programmes didactiques actuels, et de leur histoire.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort?
Comme indiqué plus haut, c’est dans le domaine des temps des verbes que les concepts narratologiques ont été les plus utilisés, primairement pour fournir une conceptualisation de leurs valeurs, jusque-là manquantes ou d’une pertinence plus que discutable, et secondairement (ou comme conséquence) pour conceptualiser les cadres structurels qui orientent ou conditionnent la distribution de ces valeurs.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Réponse simple; au vu des ressources théoriques et conceptuelles antérieurement à disposition dans l’enseignement du français, l’introduction de concepts narratologiques ne pouvait que constituer un progrès ou en tout cas ne pas faire de mal, même si un travail important reste à faire en ce domaine, qui, comme indiqué plus haut, concerne certes le choix des cadres et notions théoriques, mais surtout la constitution de programmes didactiques qui soient utiles et pertinents pour les objectifs de maîtrise textuelle; ce qui implique à nos yeux que soient poursuivies et/ou mises en place des recherches proprement didactiques susceptibles de mettre en évidence les utilités et pertinences évoquées.
Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
Pour la société en général, nous n’avons pas d’éléments de réponse. Pour la didactique du français, les travaux de narratologie sont utiles, voire indispensables, pour autant que leur mobilisation au service de la didactique, ni ne s’effectue dans une perspective unilatéralement descendante, ni ne soit reçue dans le champ éducatif dans la perspective figée et dogmatique qui toujours guette.
Références citées
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif - précis d'analyse textuelle, Paris, Nathan-Université.
Bach, Pierre (1987), L'écriture buissonnière: pédagogie du récit, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. «Techniques et méthodes pédagogiques».
Besson, Marie-Josèphe, Marie-Rose Genoud, Bertrand Lipp & Roger Nussbaum (1979), Maîtrise du français: méthodologie pour l'enseignement primaire, Lausanne, Office romand des éditions et du matériel scolaires.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi & Isabelle Nicolazzi-Turian (1990), Français 7e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi & Isabelle Nicolazzi-Turian (1990), Français 8e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi, Isabelle Nicolazzi-Turian & E. Rougemont (1990), Français 9e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Brassart, Dominique-Guy & Yves Reuter (1992), «Former des maîtres en français: éléments pour une didactique de la didactique du français», Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11.
Brassart, Dominique-Guy & Yves Reuter (1992), «Former des maîtres en français: éléments pour une didactique de la didactique du français», Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11-24.
Bronckart, Jean-Paul, Daniel Bain, Bernard Schneuwly, Clairette Davaud & Auguste Pasquier (1985), Le fonctionnement des discours: un modèle psychologique et une méthode d’analyse, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Bronckart, Jean-Paul (1997), Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionnisme socio-discursif, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Chartrand, Suzanne-Geneviève & François Morin (1999), Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui, Montréal, Graficor.
Chervel, André (1988), «L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 59-119. URL: https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1988_num_38_1_1593
Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage, coll. «Recherches en didactique des mathématiques» [Réédition augmentée en 1991].
Chiss, Jean-Louis & Jacques David (2018 [2012]), Didactique du français: enjeux disciplinaires et étude de la langue, Paris, Armand Colin, coll. «Collection U, Lettres».
Combettes, Bernard (1983), Pour une grammaire textuelle: la progression thématique, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, coll. «Pratiques. Série formation continuée».
Combettes, Bernard & Roberte Tomassone (1988), Le texte informatif: aspects linguistiques, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, coll. «Prisme. Problématiques».
Genevay, Éric (1994), Ouvrir la grammaire : interlocuteur, énoncé, communication, phrase, Lausanne, Loisirs et Pédagogie, coll. «Langue et parole».
Tauveron, Catherine (1995), Le personnage: une clef pour la didactique du récit à l'école élémentaire, Lausanne, Delachaux et Niestlé, coll. «Techniques et méthodes pédagogiques».
Lancray-Javal, Romain, Jean-Marie Fournier & Bernard Veck (1990), «Un cas de transposition didactique en français: la notion de thème», Revue française de pédagogie, n° 93, p. 41-49. URL: https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1990_num_93_1_1372
Verret, Michel (1975), Le temps des études, Paris, Honoré Champion.
Weinrich, Harald (1973), Le temps: le récit et le commentaire, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Pour citer l'article
Jean Paul Bronckart, "Témoignage de Jean-Paul Bronckart", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-paul-bronckart
Voir également :
Témoignage de Jean-Louis Dumortier
Au tournant des années 1960-1970, en même temps que paraissaient les premiers ouvrages des fondateurs de la narratologie française (Barthes, Genette, Todorov, Greimas, etc.) ou les traductions en français des précurseurs russes (Propp, Bakhtine, Chklovski, Tomachevski…), en même temps que se répandait, au sein du corps professoral, l’esprit de contestation de la tradition académique et pédagogique qui avait contribué à la flambée de mai 1968, s’opérait, en Belgique francophone, une rénovation des programmes de l’enseignement obligatoire liée à une réforme des structures scolaires dont l’objectif était, dans une conjoncture socio-économique encore favorable (nous sommes à la fin des Trente glorieuses), de mettre fin à une répartition précoce des élèves dans les formes d’enseignement générale, technique et professionnelle et de permettre à l’École de jouer pleinement son rôle d’ascenseur social.
Témoignage de Jean-Louis Dumortier
Jean-Louis Dumortier
Professeur honoraire de l’université de Liège, Jean-Louis Dumortier y a été responsable du service de didactique des langues et littératures françaises. Ses travaux ont porté, entre autres, sur les pratiques scolaires de lecture/écriture du récit. Il est ainsi l’auteur d’un Tout petit traité de narratologie buissonnière à l’usage des professeurs de français qui envisagent de former non de tout petits (et très mauvais) narratologues mais des amateurs éclairés de récits de fiction (2005).
Entretien
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Au tournant des années 1960-1970, en même temps que paraissaient les premiers ouvrages des fondateurs de la narratologie française (Barthes, Genette, Todorov, Greimas, etc.) ou les traductions en français des précurseurs russes (Propp, Bakhtine, Chklovski, Tomachevski…), en même temps que se répandait, au sein du corps professoral, l’esprit de contestation de la tradition académique et pédagogique qui avait contribué à la flambée de mai 1968, s’opérait, en Belgique francophone, une rénovation des programmes de l’enseignement obligatoire liée à une réforme des structures scolaires dont l’objectif était, dans une conjoncture socio-économique encore favorable (nous sommes à la fin des Trente glorieuses), de mettre fin à une répartition précoce des élèves dans les formes d’enseignement générale, technique et professionnelle et de permettre à l’École de jouer pleinement son rôle d’ascenseur social. C’est la conjonction de ces innovations qui, à mon avis, a favorisé l’engouement de certains jeunes professeurs de français pour la première narratologie.
Je pense que celle-ci s’est implantée dans l’enseignement secondaire (puis dans l’enseignement primaire) avant même d’être résolument enseignée dans les universités, par l’action d’enseignants progressistes et militants qui, au cours des décennies suivantes ont pu faire connaître leurs transpositions didactiques des travaux des narratologues grâce à des revues et à des collections dédiées à la formation des maîtres (Enjeux, Français 2000, Revue de la Direction générale de l’Organisation des Etudes, «Formation continuée», «Séquences», pour m’en tenir à des publications belges), grâce aussi à des propositions de formation continuée bien accueillies par une fraction dynamique du corps enseignant soucieuse d’innover en s’appuyant sur des connaissances solides.
Quitte à tomber dans le piège de l’idéalisation d’une époque qui a été celle de mes premiers pas professionnels, je dirais volontiers que la diffusion de la narratologie dans le secondaire est une des conséquences de l’effervescence pédagogique des années 1970-1980. Cette dernière a suscité, dans la sphère des professeurs de français, un appel de savoirs et de pratiques rompant avec les approches académiques qui tenaient encore le haut du pavé (celles de la «philologie romane») comme avec une tradition d’enseignement que la «sociologie de la reproduction» (Bourdieu) avait prise à partie. Ceux qui ont été alors les champions de la narratologie dans l’enseignement obligatoire avaient, je pense, le sentiment de participer à une révolution scolaire qui conjuguait exigence de scientificité et volonté de donner à tous les élèves des instruments d‘observation des récits qui ne supposaient pas une connivence culturelle préalable entre enseignants et apprenants. Avec le recul, je suis porté à croire qu’il était (un peu?) illusoire de penser réduire l’écart entre les dispositions culturelles de certains maîtres et celles de certains élèves, issus des milieux défavorisés, en donnant à tous les mêmes outils pour l’étude des textes et les mêmes modes d’emploi de ces outils : ce que ces derniers permettaient de constater et de dire pouvait paraître, aux yeux des peu nantis, tout aussi vain, tout aussi inintéressant – voire plus oiseux encore – que les observations et les discours qui concrétisaient les approches traditionnelles des récits, celles qui reposaient sur le «dogme de l’expression-représentation» alors mis à mal par la «nouvelle critique».
Les premiers narratologues s’étaient donné comme objet de recherche le récit (littéraire) en tant que construit sémiotique, coupé de son auteur et de son lecteur. Ils ont mis au jour ses structures profondes et les procédés de «mise en intrigue» de l’histoire qu’il donne à connaître. C’est la nouveauté, la solidité et la relative simplicité de leurs outils de description qui ont séduit certains maîtres du secondaire comme du primaire1 et leur ont souvent fait perdre de vue – un peu ici, complètement là – les raisons pour lesquelles les gens lisaient des récits (de fiction notamment), celles pour lesquelles l’étude de ces derniers avait pris tant de place dans la formation littéraire aux degrés primaire et secondaire et, en fin de compte, celles qui justifiaient l’enseignement de la littérature dans le programme rénové des humanités. La transposition didactique de la narratologie m’apparait, a posteriori, comme une manifestation parmi d’autres d’une entreprise pédagogique qui a commencé dans le dernier quart du XXe siècle: celle d’initier précocement les élèves aux méthodes de la recherche scientifique. Sans que cela n’ait été dit aussi clairement que nécessaire pour donner prise à la contestation, le but est devenu de former des linguistes, des historiens, des chimistes, des physiciens… en herbe et, subsidiairement, comme je l’ai écrit naguère, «de tout petits (et très mauvais) narratologues [plutôt que] des amateurs éclairés de récits de fiction». La redéfinition des objectifs de l’enseignement en termes de compétences (1999) peut être envisagée comme une ratification de ce but latent : il s’agissait désormais de rendre les élèves capables de mettre en œuvre leurs connaissances… pour imiter la démarche des chercheurs… sans être dans une authentique situation de recherche. Dès lors, plus l’appareil d’investigation avait une apparence scientifique et plus il était facile d’un exhiber l’usage («Qui est l’auteur? Qui est le narrateur?», «Le narrateur est-il intra-extra-homo-hétéro diégétique?», «Avons-nous affaire à une focalisation interne, externe ou zéro», etc.: je caricature un peu), plus les performances se prêtaient à une évaluation critériée objective. Une des explications de l’usage scolaire de la première narratologie est, me semble-t-il, à chercher de ce côté-là.
Je ne pense pas que l’extension, au cours des années 1980-1990, des recherches narratologiques aux genres narratifs non fictionnels, dans quelque champ que ces recherches s’inscrivent, que ce soit celui de l’anthropologie (Bruner), de la sociologie (Labov), de la philosophie (Ricoeur), de la psychologie cognitive (Fayol), etc., ait eu un impact important dans l’enseignement obligatoire. Cela tient probablement au fait que les résultats de ces recherches n’ont pas donné lieu à de nombreuses vulgarisations, à des transpositions didactiques encore moins. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que les outils des premiers narratologues ont reçu la consécration des programmes et bénéficié d’une large diffusion par les manuels. D’un instrument d’étude avalisé par l’institution scolaire, la majorité des enseignants se servent souvent sans se demander si ce à quoi il sert concourt à pourvoir les élèves des dispositions dont on voudrait nantir la jeunesse que l’on diplôme. Les outils en question et les pratiques dans lesquelles ils ont été mis en œuvre se sont révélés commodes pour évaluer les acquis de la formation littéraire et je pense qu’ils ont ainsi fait obstacle à la rénovation de cette dernière, qu’ils auraient pu pourtant favoriser.
En même temps que s’élargissait le domaine de la recherche narratologique, se transformait l’objet que s’étaient donné les premiers narratologues. Les investigations des spécialistes du récit de fiction ont porté sur l’interaction entre ce dernier et le(s) lecteur(s). Les pionniers –Iser, en Allemagne; Eco, en Italie; Marghescou et Picard, en France– et leurs successeurs – Jouve, en France; Gervais, au Québec; Dufays, en Belgique; Baroni, en Suisse, etc. – se sont attachés à théoriser la lecture du récit en accordant une attention variable à ce que l’auteur a mis en place pour faire réagir le lecteur, et aux dispositions de ce dernier à prêter attention aux facteurs des effets que le texte est susceptible de produire. Ces travaux, qui avaient l’avantage d’intégrer les recherches antérieures sur ce que Genette avait appelé le «discours du récit» et d’exhiber la puissance d’action de ce dernier sur l’esprit des (ou de certains) lecteurs, étaient, au prix d’une transposition didactique accessible, avalisés par l’institution et largement diffusés par l’édition scolaire, susceptibles d’ébranler et, à terme, de ruiner les pratiques de lecture excessivement «formalistes» auxquelles avait donné lieu la réception scolaire de la première narratologie. Est-ce que c’est ce qui s’est passé? Je pense que non et je le déplore.
Cela ne s’est pas passé parce que ne s’est pas reproduite la conjonction des ruptures (dans le champ de la recherche, dans les programmes et dans le rapport des maîtres à l’institution) qui, une trentaine d’années auparavant, avait favorisé la transposition didactique de la narratologie et l’adoption par la fraction progressiste des enseignants de français des pratiques qu’induisait cette transposition. Cela ne s’est pas passé en dépit de la sévère critique, dans la première décennie du siècle actuel, de ces pratiques devenues de plus en plus formalistes, par ceux-là mêmes qui les avaient inspirées ou répandues, et des propositions concrètes en vue d’une rénovation appuyée sur les travaux des néo-narratologues.
Ce n’est pas que ces travaux n’aient eu aucun impact dans le champ de la didactique du français: c’est sur certains de ceux-ci (entre autres) que s’est appuyé J.-L. Dufays pour conceptualiser la «lecture littéraire», mais c’est que cette didactique est devenue une discipline de recherche et que les résultats de la recherche en didactique dédiée à l’étude du récit se sont moins répandus au sein de l’ensemble du corps professoral que ceux des premières recherches en narratologie. Ces derniers avaient donné lieu à une transposition rapide de la part d’enseignants engagés sur la voie académique (Goldenstein, Petitjean, Halté, Reuter…) et animés par la conviction de concourir au progrès de l’École par le partage du «savoir savant». Trente ans plus tard, les «courroies de transmission» du savoir narratologique que sont les revues pédagogiques, les ouvrages de vulgarisation scientifique, la formation en cours de carrière, les programmes, les manuels, les conseils de l’inspection se sont distendues ou ont tout bonnement disparu, et (surtout, peut-être) le sentiment de concourir à l’amélioration du vivre ensemble en rénovant les savoirs et les pratiques scolaires n’anime plus guère une partie du corps professoral, lequel est, dans son ensemble, excédé par des réformes où le contrôle des acquis d’apprentissage prend aux professeurs une bonne partie du temps que certains consacraient naguère à la rénovation de leurs connaissances. Par ailleurs, il ne me semble pas que les néo-narratologues aient, autant que leurs prédécesseurs, produit un arsenal conceptuel et une nomenclature afférente organisés en distinctions de préférence binaires, pas plus que des savoirs qui se prêtaient autant à la schématisation et à la simplification. Enfin – et paradoxalement – plus la didactique de la littérature (où l’objet «lecture du récit» occupe toujours une place léonine) s’intéressait au «sujet lecteur» et à sa production de sens, moins elle produisait de résultats exploitables par des maîtres de plus en plus contraints à n’enseigner que ce qui pouvait être évalué et à utiliser des outils d’évaluation congruents avec la (néfaste) visée de l’égalité de résultats.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Pour autant que je comprenne bien ces «modalités particulières du phénomène de transposition», je pense avoir anticipé cette question en répondant à la précédente. La transposition didactique des premières recherches en narratologie a été, me semble-t-il, relativement rapide, favorisée par un «esprit d’époque» porté à la démocratisation de l’enseignement secondaire, entendue comme processus visant à en faire bénéficier les moins nantis économiquement, socialement et culturellement. Elle s’inscrit dans un ample courant de réforme des contenus et des pratiques d’enseignement inspiré par l’innovation scientifique et la volonté de rendre tous les élèves capables de manier les mêmes instruments d’investigation (des textes en l’occurrence). Elle a été le fait d’une fraction progressiste du corps professoral qui s’affirmait en rompant à la fois avec la tradition académique et la tradition pédagogique.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
Ayant été au nombre des tout premiers vulgarisateurs des recherches en narratologie (1980, 1986) et ayant constaté avec effarement la dérive formaliste de l’usage des savoirs que j’avais contribué à faire connaître, il m’est arrivé de penser que j’aurais mieux fait de me casser le poignet au lieu d’écrire les livres et les articles où je partageais les connaissances que je devais aux spécialistes. J‘ai néanmoins toujours résisté à la tentation de l’accident volontaire en me disant qu’un exemple de plus de l’usage de la narratologie au service de la réflexion sur le(s) plaisir(s) de lire et sur la pragmatique du récit pouvait éviter à quelques-uns de dériver ainsi. Ma foi en la vertu de l’exemple est déraisonnable, mais credo quia absurdum : on sait ça…
Une vingtaine d’années après mes premiers méfaits, j’ai tenté de rassembler dans une thèse de doctorat (2001) ce que je savais des différents apports au domaine de la narratologie et d’en proposer des usages qui évitaient (vaille que vaille) les fourvoiements du formalisme.
Informé des dégâts provoqués dans l’enseignement primaire par des pratiques fondées sur des vulgarisations de troisième main, je n’ai pas cru inutile de rappeler, dans un livre destiné aux instituteurs, qu’on ne devrait pas appeler n’importe quoi n’importe comment et se servir d’une panoplie de notions bancales dans des pratiques qui dégoutaient prématurément les enfants de la lecture (2006). En outre, je me suis fendu, à l’usage des enseignants du secondaire, d’un Tout petit traité de narratologie buissonnière… (2005) qui contribuait au chantier de démolition d’un enseignement de la littérature gâté par le formalisme et pour lequel je garde quelque indulgence parce que je pense y avoir allègrement persévéré sans (trop) verser dans le diabolique.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort ?
Je me garderais bien d’affirmer que ce sont des «concepts» qui ont été mis en œuvre par tous les enseignants ayant utilisé le vocabulaire des narratologues et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’emploi de ce vocabulaire a été souvent erratique ou incongru.
Cela dit, au palmarès des mots les plus utilisés, je ferais figurer : «récit» et «histoire», «auteur» et «narrateur» (j’ajoute «personnage» quand il a été arraché au discours commun pour compléter le trio devenu indispensable pour l’étude des «récits de vie», fictionnels ou non), «schéma narratif» (avec ses composantes), «schéma actantiel» (avec ses actants), «fictionnel» et «factuel», «vraisemblable» et «invraisemblable», ainsi que tout l’appareil descriptif (je renonce à l’inventaire : pardon pour cette paresse) élaboré par Genette pour distinguer les procédés de «mise en intrigue» (Ricoeur) relevant de la «voix», de la «personne» et du «temps» –mais dans des versions adaptées ad usum delphini qui manifestaient rarement les scrupules terminologiques de l’auteur de «Discours du récit» (in Figures III), de Nouveau discours du récit, et de Fiction et diction, entre autres).
La fortune de ces mots tient, selon moi, notamment au fait que la plupart d’entre eux peuvent entrer dans des oppositions binaires aisément mémorisables («situation initiale» vs «situation finale», «sujet» vs «objet», «focalisation interne» vs «focalisation externe», «analepse» (rétrospection) vs «prolepse» (prospection), «factuel» vs «fictionnel», etc.) et servent à opérer ces distinctions élémentaires devenues un nec plus ultra dans un enseignement piloté par le contrôle des acquis d’apprentissage.
Au nombre des concepts ou des notions qui auraient pu (ou dû) mieux retenir l’attention, j’accorderais une priorité aux modes de réception du personnage par le sujet lisant (personnage perçu comme pion, comme personne et comme prétexte) distingués par Jouve (1992) et, surtout, aux affects distingués par Baroni2 (2007), ceux-là comme ceux-ci permettant de s’interroger sur la pragmatique du récit, sur les effets potentiels de procédés identifiés par Genette. Du lot de ces derniers, je sortirais volontiers, comme l’a fait Genette lui-même (2004), la métalepse, fort utile pour susciter une bien nécessaire réflexion des élèves sur la fiction et le rapport du lecteur aux mondes fictionnels (Ryan, Cohn, Jacquenod, Schaeffer, Caïra, etc.).
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Du «français»? Je ne saurais dire. Mais voici deux mots sur l’impact qu’a eu, selon moi, la transposition didactique de la narratologie sur la formation littéraire au cours de la scolarité obligatoire.
Le savoir narratologique a renouvelé les pratiques scolaires d’étude du récit, il a rendu possible des procédures d’analyse que les élèves étaient capables de s’approprier vaille que vaille, et cela pouvait être interprété comme un progrès par les tenants de l’apprentissage par l’activité. Mais ces pratiques, qui donnaient prise à une évaluation critériée objective du savoir lire, ont freiné (empêché?) le changement de cap de la formation lorsque celle-ci, dans une conjoncture culturelle marquée au coin d’un individualisme hédoniste (qui s’est malheureusement radicalisé), s’est déportée des objets littéraires sur l’usage de ces objets par le sujet lecteur. La néo-narratologie aurait pu favoriser ce changement de cap, mais sa transposition didactique, dans le cadre de la «lecture littéraire» notamment, pour les raisons que j’ai dites, a eu moins d’influence que celle des savoirs établis par les pionniers, d’autant moins que la plupart des contempteurs du formalisme dans l’enseignement littéraire se sont acharnés sur ces savoirs au lieu de s’intéresser aux plus récents, qu’il y avait bien des raisons de promouvoir.
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
Est-il trop tard pour rédimer la narratologie par l’exemple de pratiques qui articulent les savoirs anciens et les nouveaux pour expliquer les effets potentiels du récit sur le lecteur et pour rendre intelligibles l’actualisation de certains de ces effets sur certains sujets lisants? Peut-être pas, mais il n’y a pas de temps à perdre car, pour ce que je sais de la place qu’en Belgique francophone la formation littéraire prendra dans les nouveaux programmes de français, on fera la part un peu trop belle à une réception esthétique des œuvres par des jeunes – et non des élèves – que l’on n’a pas assez songé à nantir des moyens de les apprécier. Que l’on se soucie de ce mode de réception plus qu’on ne l’a fait précédemment, je m’en réjouis, mais je ne me réjouis pas d’un renoncement à la réflexion sur les goûts personnels, ni à une éducation du goût susceptible de favoriser un vivre ensemble qui ne se pervertit pas en communautarisme tolérant. À cette réflexion, à cette éducation, un solide savoir narratologique pourrait sans doute contribuer bien plus que ne l’imaginent ceux qui, sans précaution, le jettent avec l’eau du bain formaliste.
J.-L. Dumortier 21.01.2022
Références citées
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Dumortier, Jean-Louis & Francine Plazanet (1980), Pour lire le récit : l’analyse structurale au service de la pédagogie de la lecture. Langages nouveaux, pratiques nouvelles pour la classe de langue française, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (1986), Écrire le récit, Bruxelles-Paris-Gembloux, DeBoeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction : pour étayer un apprentissage : théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck-Duculot, coll. «Savoirs en pratique : français ».
Dumortier, Jean-Louis (2005), Tout petit traité de narratologie buissonnière : à l'usage des professeurs de français qui envisagent de former non de tout petits (et très mauvais) narratologues mais des amateurs éclairés de récits de fiction, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Diptyque».
Dumortier, Jean-Louis & Micheline Dispy (2006), Aider les jeunes élèves à comprendre et à dire qu'ils ont compris le récit de fiction, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Tactiques 1».
Genette, Gérard (2004), Métalepse : de la figure à la fiction, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Jouve, Vincent (1992), L'effet-personnage dans le roman, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Écriture».
Pour citer l'article
Jean-Louis Dumortier, "Témoignage de Jean-Louis Dumortier", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-louis-dumortier
Voir également :
Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction
LIMINAIRE Dans l’introduction de son ouvrage Les rouages de l’intrigue, Raphaël Baroni (2017) reconnait sans ambages avoir fondé sa proposition épistémologique et didactique de renouvellement narratologique sur des œuvres issues du canon littéraire, plutôt que sur un corpus davantage contemporain et notamment lié au phénomène avéré de Transmedia Storytelling (Jenkins, 2007; Jenkins, Ford et Greene, 2013), cela à son corps défendant
Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction
LIMINAIRE
Dans l’introduction de son ouvrage Les rouages de l’intrigue, Raphaël Baroni (2017) reconnait sans ambages avoir fondé sa proposition épistémologique et didactique de renouvellement narratologique sur des œuvres issues du canon littéraire, plutôt que sur un corpus davantage contemporain et notamment lié au phénomène avéré de Transmedia Storytelling (Jenkins 2007; Jenkins, Ford et Greene 2013), cela à son corps défendant:
J’ai donc exclu à la fois les productions romanesques des siècles précédents, les œuvres qui appartiennent à la littérature dite «populaire», et d’autres médias dans lesquels l’intrigue occupe une place centrale: le théâtre, le cinéma, les séries télévisées, la bande dessinée, les pratiques ludiques ou vidéoludiques, voire l’interaction entre ces différents médias, qui correspond à ce phénomène qu’Henry Jenkins a récemment baptisé le «transmedia storytelling». Il ne faudrait pas conclure de cette exclusion à un défaut d’intérêt de ma part ou à un mépris pour ces objets. Bien au contraire, je suis convaincu qu’il est nécessaire d’ouvrir l’étude du récit à l’ensemble des formes narratives, qu’elles soient élitistes ou populaires, expérimentales ou conventionnelles, littéraires ou extralittéraires, verbales ou visuelles, analogiques ou numériques (Baroni 2017: 19).
C’est en reprenant à mon compte la toute dernière proposition de l’extrait qui précède que je souhaite contribuer, dans ce bref essai, à une défense étayée, didactique et surtout actualisée de la problématique contemporaine du recours aux moyens et outils1 narratologiques en classe de français/littérature, cela à partir du cas précis du contexte pédagogique qui prévaut actuellement au Québec. La très persistante (r)évolution médiatique n’est pas sans générer certaines frictions socioculturelles entre groupes et sous-groupes sociaux de plus en plus réseautés, c’est-à-dire préoccupés par leurs intérêts mutuels propres (Jenkins, Ford et Greene 2013; Grumbach 2022; Lacelle, Acerra et Boutin 2023). Cette transformation progressive de l’espace de médiatisation de l’imaginaire et de la pensée (Gervais, 2023) ne cesse de générer, dans sa foulée, de nouvelles formes, souvent hybrides, du récit littéraire (Bootz 2011; Bouchardon 2014; Brunel, Quet et Massol 2018; Brehm et Lafleur 2019). De telles métamorphoses, qui vont de l’emprunt plutôt cavalier à certains fleurons de la tradition littéraire jusqu’à de radicales délinéarisations2 augmentées du temps et de l’espace narratifs, imposent, il me semble, une réelle ouverture des corpus narratifs mobilisés en enseignement du français. En cette époque de tous les possibles, ou presque, en matière de fiction (ré)inventée, un recours, même des plus modestes, à la narratologie contemporaine et à certains de ses outils, par exemple la mise en abîme de l’intrigue, semble nécessaire, voire incontournable, afin d’aider les lecteur·rice·s - en formation ou non - à mieux participer à toutes ces nouvelles expériences du récit (Jenkins, Ito et Boyd 2013; Serafini 2022) et, surtout, à en faire véritablement sens.
Le développement fulgurant des chaînes médiatiques spécialisées telles Netflix, Amazon Prime Video, HBO ou Disney+ ou, tout aussi frappant, celui de la transfiction (St-Gelais 2011), qui s’incarne dans une multitude de formes allant de l’adaptation classique (album illustré, bande dessinée, théâtre, cinéma, etc.) à la fanfiction la plus marginale, en passant par le jeu vidéo ou le comic-con, implique nécessairement une démocratisation des expériences de la fiction narrative. Comment la classe de français/littérature, traditionnellement dédiée à l’analyse du récit3 pourrait-elle logiquement faire l’impasse sur un tel développement? Cela lui permettrait, par la même occasion, de s'inscrire logiquement dans le mouvement actuel de révision de la narratologie classique.
1- Les programmes québécois sous la loupe narratologique
Souhaiter le renouvellement de l’enseignement/apprentissage du récit contemporain de fiction (Baroni 2017; Brunel et Bouchardon 2020; Dufays 2023; Dufays et Brunel 2023) en classe de français, à partir notamment d’un corpus davantage en correspondance avec ses formes actuelles et à venir, présuppose que les pratiques didactiques qui incarnent les contenus des instructions officielles en matière de narratologie soient minimalement l’objet d’une certaine cure de jouvence. C’est du moins le cas spécifique du Québec, où lesdits programmes de français n’ont plus été mis à jour depuis 1994 au collégial, 2001 au primaire et 2006 au secondaire… On constate alors, dans leur appareillage narratologique respectif, la présence d’éléments assurément familiers, car susceptibles d’incarner une certaine rigidité formaliste.
La figure 1 qui suit synthétise assez efficacement les éléments de contenu narratologique (compétences, savoirs, outils, approches préconisées etc.) promulgués en contexte québécois au primaire et au secondaire. Sans surprise, on y retrouve les usuels «éléments constitutifs d’une histoire», «suite d’évènements», «quête d’équilibre», «schéma narratif», «cohérence et organisation» et autre «justification», autant d’items conceptuels qui imposent une approche surplombante, voire carrément structuraliste, du système narratif, et ce, tout au long du parcours scolaire québécois.
Figure 1. Un extrait de la Progression des apprentissages au secondaire (MÉLSQ, 2011)
|
Dans la foulée, un examen encore plus minutieux des programmes québécois, ainsi que des progressions des apprentissages qu’on leur a associées, du moins au primaire et au secondaire, permet très rapidement d’en arriver au constat manifeste, car univoque, que les savoirs et approches didactiques liés à la narratologie y demeurent foncièrement formalistes. Cette approche traditionnelle des formes, structures et caractéristiques du récit de fiction repose effectivement sur les conventions d’un formalisme littéraire fortement arrimé aux propositions conceptuelles des Propp, Greimas, Stanzel, Todorov, Genette, Bremond et consorts. Dans ce sens, cette focalisation persistante sur le formalisme narratif4, aussi bien en réception littéraire qu’en production de fiction narrative, semble correspondre, grosso modo, à la situation qui prévaut encore dans les milieux éducatifs formels, comme le rappelle Baroni:
L’un des succès imputables à la narratologie formaliste tenait à sa capacité de forger des outils aisément mobilisables, permettant de décrire, plus ou moins objectivement et avec un vocabulaire standardisé, la manière dont les textes narratifs se structurent. Ce rendement heuristique a permis à ces outils [de] se pérenniser dans les pratiques d’enseignement: schéma actantiel, schéma quinaire, prolepses, analepses, temps, voix et modes du discours font désormais partie de la vulgate enseignée aux apprentis lecteurs (2017: 17)
On pourrait donc arguer que la destinée de la didactique du récit de fiction, sous l’influence des contingences naturelles de la pratique enseignante québécoise, s’est très rapidement métamorphosée en véritable enseignement/apprentissage d’une grammaire narrative, à l’instar de la très forte ascendance, en didactique de l’écriture, du poids constant des normes et usages grammaticaux. Conséquemment, on a vu se démultiplier en classe de français/littérature, aussi bien au primaire qu’au secondaire, les situations d’évaluation – très majoritairement sommatives – où l’élève québécois devait (re)produire, à l’aide des outils narratologiques formalistes, des discours très fortement attendus. En somme, au cours des cent dernières années, on serait passé au Québec, en matière de narratologie scolaire, d’un premier discours didactique fondé sur l’imitation du canon littéraire (Melançon, Moisan et Roy 1988) à un second, officiellement en rupture avec le premier, mais finalement – et paradoxalement – toujours «reproductif»: «…il [ l’élève ] est invité à s’inspirer des textes lus ou entendus pour, à son tour, construire un univers dans lequel il campera une mise en intrigue» (MÉLSQ 2011).
Je nuancerai quelque peu, toutefois, un constat qui peut paraitre sans appel. En effet, on retrouve certes, dans les instructions officielles du ministère de l’Éducation du Québec, quelques éléments qui peuvent être associés à une approche postclassique5 (Herman 1997; Prince 2008; Sternberg 2011, Baroni 2017) – post formaliste et post structuraliste –, de la narration de fiction. Il y est bel et bien question, par exemple, de la notion de «mise en intrigue». On souhaite visiblement que l’élève adopte une sorte de méthodologie narrative qui repose d’abord et avant tout, j’insiste, sur la reproduction formelle et sans doute monolithique du récit, évaluation oblige, plutôt que sur son analyse approfondie, ses potentialités, son éventuelle déconstruction, etc.
On demeure donc toujours loin du projet de Gerald Prince (2006): «au moyen de nouveaux instruments, de corpus élargis et d’inflexions originales, la narratologie post-classique nous encourage à identifier ou à (ré)examiner différents aspects du récit et à les (re)définir et les (re)configurer». Aucune proposition des textes officiels du Québec évoque, par exemple, la «curiosité», la «tension», les «voix» ou les «modes» narratifs (Baroni 2017 et 2020), pas plus que la «fonction» et la «signification» de la narration, le «récit comme processus» ou son «incorporation de la voix du lecteur/récepteur» (Prince 2006 et 2008).
Il semble toutefois inévitable que, sous l’influence de l’évolution massive du paysage techno médiatique, des enseignant·e·s québécois·e·s aient intégré, implicitement, certaines notions profanes, du moins aux yeux de notre ministère, ou même académiques, qui peuvent être associées à la narratologie post formaliste. Je pense, par exemple, à la relative montée en force, dans plusieurs classes de fin du secondaire, de l’autofiction et du récit autobiographique. Ces derniers aspects renversent, ou du moins questionnent, nombre de principes, codes et procédés narratifs classiques, comme le souhaite explicitement Prince, et interpellent de plus en plus la multimodalité sémiotique, notamment en contexte numérique (Brunel 2012; Lacelle, Boutin et Lebrun 2017), comme véhicule du récit (Florey, Jeanneret et Mitrovic 2019).
Espérons surtout que le tout récent rappel – juin 2023 – des programmes de français du primaire et du secondaire par l’actuel ministre de l’Éducation constituera, pour la didactique de la littérature en contexte québécois, l’occasion tant attendue de convaincre les autorités concernées de procéder enfin à un ajustement sensible des contenus des instructions officielles en matière de narratologie contemporaine. Entre rapport intuitif et rapport formaliste au récit (Baroni 2017; David 2014), ladite refonte sera l’occasion, cela s’impose, d’inscrire par exemple le recours à des outils narratifs contemporains au sein du cursus québécois. Il en va, au bout du compte, des dispositions de l’élève à (re)penser son imaginaire intrinsèque afin que celui-ci corresponde toujours mieux aux valeurs, attentes et appréhensions de son devenir (Gervais 2018).
2- Le labyrinthe comme métaphore narratologique: Vic, phénomène d'interaction narrative
Au-delà donc des écrits épistémologiques, conceptuels et ministériels, il me semble fondamental de réfléchir – notamment de façon phénoménologique (Boccaccini 2023; Dufourcq 2014) – aux ancrages pragmatiques d’une tension narrative (Baroni 2020) qui doit nécessairement justifier une certaine mobilisation – qu’elle soit formelle ou implicite – des outils proposés par l’actuel mouvement de rénovation de la narratologie. Il en va de sa contribution, notamment didactique, à la dynamique évolutive des imaginaires contemporains. Pour ce faire, j’aimerais brièvement convoquer, en deux courts tableaux (figures 2 et 3), la description synthétique d’un cas de lecteur empirique (Ahr 2010; Guillemette et Cossette 2006; Louichon 2009), bref, un phénomène individuel (Dufourcq, 2014) d’interaction narrative.
Figure 2. Un phénomène d’interaction narrative (Vic, partie I) Vic, 53 ans et parfois qualifié d’adulescent attardé, gagne très bien sa vie grâce notamment à sa maitrise relevée de la réception (lecture). En début d’adolescence, on lui impose, en classe de français, la lecture de La communauté de l’anneau, tome premier du Seigneur des anneaux de l’écrivain J.R.R. Tolkien. D’abord rebuté, il se laisse lentement prendre au piège des rouages de l’intrigue (Baroni, 2017). Narrativement séduit, Vic se tourne alors vers Les deux tours et Le retour du roi, deuxième et troisième tomes du roman, puis vers son adaptation théâtrale avec marionnettes géantes, puis encore une autre en dessins animés, puis une relecture complète de l'œuvre, puis Bilbo le Hobbit. Sans surprise et deux décennies plus tard, il profite pleinement des adaptations au grand écran de ces romans canoniques, du moins dans le registre fantastique. Toutefois, et durant tout ce temps, un texte narratif beaucoup plus colossal, réputé labyrinthique, mythique, voire inextricable, attire Vic sans qu’il ne se sente capable d’y entrer… |
«Plus qu’un simple lieu imaginé, le labyrinthe est un imaginaire» écrit B. Gervais (2008: 23). Si cela se confirme, tel que nous le pensons, la conjugaison de la mécanique et de l’essence de l’intrigue narrative propre aux œuvres de fiction est une sorte de labyrinthe de l’imaginaire, un monde possible parmi des mondes possibles – Possible Worlds – (Pavel 1988; Ryan 1991; Schaeffer 1999; Bell et Ryan 2019; Lavocat 2019; Bell 2019; Martin 2019). Tolkien, en l'occurrence, ne viendra jamais à bout de son imaginaire labyrinthique, finalement rejoint par le minotaure temporel. En effet, il faudra plusieurs décennies à son fils Christopher pour achever son Possible World. Or une véritable fin est-elle narrativement souhaitable ? «Le labyrinthe et la fin se rejoignent dans leur capacité à faire entendre nos appréhensions les plus graves sur le monde et son destin» (Gervais 2008: 197). Au-delà de ce questionnement en spirale, il n’en demeure pas moins que les récepteur·rice·s de la fiction narrative en arrivent invariablement, quelle que soit l’intrigue à dénouer, au même dilemme narratif: sortir du récit ou le prolonger aussi longtemps que possible, briser le cycle ou le faire durer.
Figure 3. Un phénomène d’interaction narrative (Vic, partie II) Novembre 2022. Vic s’est enfin décidé: il ouvre son édition anglaise de The Silmarillion. Heureux hasard, il tombe sur la carte – en insertion – du royaume mythique de Beleriand. Il entre dans l’archi labyrinthe de Tolkien: son legendarium. Plus d’une année passe et Vic y est toujours. Il dispose toutefois d’un support techno numérique qui lui permet d’évoluer, plus ou moins subjectivement, à travers un faisceau très complexe de nœuds, tensions et rouages trans narratifs. En effet, Vic se tourne vers The Nerd of the Ring, un booktubeur qui, comme son nom le laisse entendre, se révèle exégète du legendarium. Dans la foulée, Vic découvre The Tolkien Gateway, un wiki dédié aux mondes possibles de l’univers tolkienien. Il décèle aussi une présentation vidéo de L’atlas de la Terre du Milieu, cartographie de la géographie imaginée par Tolkien, puis se procure l’ouvrage en question. Insatiable, ou presque, Vic amplifie alors son intense déambulation narrative: lectures du Silmarillion en traduction française6, de la carte du Beleriand7, de La chute de Gondolin8, de Beren et Luthien9, de The Making of Middle-Earth. The Worlds of Tolkien and The Lord of the Rings10 et même d’un très universitaire Tolkien et les sciences11. Vic s’enfonce de plus en plus loin dans un espace-temps transfictionnel où des points de repère narratologiques se révèlent indispensables. |
La description de ce cas, tout à fait réel, de récepteur reconnu comme expert, mais volontairement captif du legendarium tolkienien, cherche à exemplifier le plus clairement possible, malgré sa singularité apparente, la prévalence confirmée de l’imaginaire – et donc du récit – comme besoin intrinsèque de l’existence (Gervais 2008; 2018; 2023). Un état de fait qui présuppose nécessairement un recours, même infime, à la narratologie, à ses outils et/ou à ses accointances épistémologiques lorsqu’on se retrouve plongé dans tout labyrinthe narratif, quelle qu’en soit l’envergure.
De là à amorcer l’actualisation du socle narratologique en classe de français/littérature, il n’y a, il me semble, qu'une distance millimétrique à franchir. Un tel devoir didactique semble d’autant plus évident et fondamental dans un contexte social que l’on devrait qualifier, désormais, de posthumaniste (Braidotti et Hlavajova 2018; Boutin 2019), et ce, dans le sens précis d’un «au-delà de l’humanisme» qui ne rejette en rien ce dernier et qui, surtout, relativise davantage le rôle de l’humain au sein de l’écosystème global (Besnier 2009; Braidotti 2013; Baquiast 2014). Y cohabitent maintenant, en guise d’illustration, des pratiques analogiques et/ou numériques du récit où la démultiplication, l'hybridation, la mise en communauté par réseau, le moissonnage par algorithme et la virtualisation entrent dans le jeu omniscient de la fiction narrative (Bouchardon 2014; Brunel 2021; Grumbach 2022; Lacelle, Acerra et Boutin 2023).
Or à quoi pourrait donc ressembler cette actualisation posthumaniste que je souhaite vivement à la classe de français/littérature québécoise, notamment en matière de narratologie? Les lignes qui suivent esquisseront, encore trop sommairement car la réflexion disciplinaire reste en ébullition, les grandes lignes d’un projet à consolider collectivement.
3- Quelles épistémologies, quels outils, quelles dispositions?
Spéculative il y a encore quelques années, force est de constater, à partir de l’exemple du récepteur Vic, que la théorie des mondes possibles en fiction correspond désormais à des pratiques réelles et signifiantes de la fiction narrative. Ces dernières sont d’ailleurs exacerbées par l’omniprésence du numérique qui les propulse dans des directions toujours plus inédites et novatrices (Bouchardon 2014; Brunel et Bouchardon 2020). Pour ces raisons éminemment pragmatiques, elle devrait être convoquée en enseignement formel du récit. De tels mondes possibles, en tant qu'univers fictionnels autonomes, possèdent chacun une valeur plausible et potentielle de vérité – une ontologie – qui transcende le monde fictif sous-tendu par l’articulation concrète de la narration (Pavel 1988).
D’ailleurs, Alice Bell (2019) fait remarquer que les fictions numériques se nourrissent assez systématiquement de cette ambiguïté ontologique, utilisant le virtuel numérique pour se jouer constamment de la frontière entre fiction et réalité. En fait, il m’apparait manifeste que les univers narratifs ontologiquement crédibles, par exemple le fameux legendarium de Tolkien, font mouche précisément parce qu’ils rendent plausible toute la densité de leur réseau propre d’intrigues par la création interne d’un ensemble de lois intelligibles qui respectent en tout temps l’intelligence (Martin 2019) tout comme l’imaginaire (Gervais 2023) et la subjectivité des lecteur·rice·s.
Toujours dans cette veine de l’ontologie narrative, Lavocat (2019) démontre comment, dans les multivers à vocation ludique, les environnements «multijoueurs» et les jeux à joueur unique, la trame narrative est constamment refaçonnée, remodelée, remixée par l’interaction de l’acteur – le récepteur/producteur – avec l’intelligence artificielle qui régit l’ensemble du récit-jeu. Ces «néo» formes de la narration, et toutes celles à venir, nécessitent donc qu’on ait recours à des clés narratives de compréhension et d’intégration – en élaboration – qui s’éloignent, sans toutefois les rejeter, des seuls outils formalistes et structuralistes – lire… humanistes – et qui, surtout, permettent aux lecteur·rice·s de mieux discerner et disséquer le sens qui y est mis en jeu (Prince 2006).
D’autre part, une didactique revampée de la littérature devrait nécessairement convoquer davantage des propositions conceptuelles résistantes, objectivantes et oh combien actuelles, mais fortement marginales en classe, du moins au Québec. Il est avéré, par exemple, que l’identification et surtout la prise en considération, par les lecteur·rice·s et/ou producteur·rice·s de récits, des stéréotypes narratifs facilitent, densifient et relancent leurs pratiques de la fiction (Brehm et Lafleur 2019; Dufays et Kervin 2010 et 2020; Dufays, Gemenne et Ledur 2015).
Je retiens d’abord, sans aucune surprise, la transfiction / transfictionnalité (Besson, 2007; Ryan, 2007; St-Gelais, 2011), appelée Transmedia Storytelling (Jenkins, 2007; Jenkins, Ford and Green, 2013) dans le monde anglo-saxon. Autant pour sa pertinence en tant que telle que pour son apport à une approche postclassique de la narratologie, la transfiction permet notamment de 1- cartographier la trajectoire (multi)médiatique d’un récit premier qui génère toute une arborescence de récits seconds, tiers, etc., 2- identifier et analyser les métamorphoses que les récits de ce nouveau réseau – et leurs différentes composantes narratives (tension, voix, modes, processus, etc.) proposent au récepteur, 3- relancer éventuellement cette chaîne d’histoires filiales par la production, grâce à différents outils narratifs, de nouvelles intrigues, de nouveaux cadrages et séquences, de nouvelles narrations, tensions, et dualités, etc. D’ailleurs, une seconde proposition qu’il me semble importante d’appeler en classe permet d’explorer avec encore plus de finesse et de profondeur l’évolution narrative des différentes œuvres de (trans)fiction: la mimèsis aristotélicienne (Ricoeur 1983; Baroni 2010), associée à la stéréotypie littéraire (Dufays 2010; Dufays et Kervyn 2010 et 2020; Daignault 2010; Connan-Pintado 2019). On pourra évidemment réserver pour le second cycle du secondaire un tel regard analytique sur la (re)production par leur appropriation, par exemple, de la diégèse, de l’intrigue et autres tensions.
En fin de parcours primaire, il serait même souhaitable de densifier cette longue et lente exploration de l’imaginaire, amorcée avant même le début de la scolarisation, voire dès le berceau, par une approche de lecture dialogique, qui tente précisément, et progressivement, d’aider les élèves à mieux discriminer, notamment à partir du matériel narratif et de ses différents outils, la vraisemblable objectivé de ce qui relève plutôt du fictif12. Dans ce cas précis, on suggère de discuter, à partir des récits de (semi)fiction historique, des différents rapports qui s'inscrivent entre discours savants et discours profanes dans l’élaboration de la mémoire et de la conscience collectives (Éthier et Lefrançois 2021). Bref, ces quelques approches ont chacune le mérite de proposer aux élèves une riche grille réflexive qui, adéquatement transposée en didactique de la fiction narrative, peut réellement contribuer à consolider leur rapport individuel et partagé aux récits qu’ils croisent tout au long de leur parcours scolaire, certes, mais aussi de leur vie adulte.
Une toute dernière piste d’émulation mérite, à mon avis, son paragraphe: la multimodalité13 narrative (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017; Serafini 2022). Rappelons d’abord les propos visionnaires de David Herman lorsqu’il précisait que «la narratologie peut maintenant s’employer pour désigner toute approche raisonnée de l’étude du discours narrativement organisé, qu’il soit littéraire, historiographique, conversationnel, filmique ou autre» (Herman 1997: 27).
Évoquant implicitement les travaux fondateurs du New London Group (1996), Herman ouvre ainsi la porte à la rencontre de l’épistémologie narratologique avec la sémiotique sociale. Comme le démontre Kress (1997; 2010) et tou·te·s les autres chercheur·euse·s qui le suivront, les unités de sens sont intrinsèquement polymorphes et les registres de signes qui les constituent interagissent pour mieux concrétiser et véhiculer le sens, et ce, aussi bien du côté sensoriel-perceptif que de manière cognitivo-affective. La transaction du sens entre les individus repose alors sur les différentes ressources sémiotiques, qui servent de véhicule aux modes porteurs du sens. Tous les récits du désormais vaste spectre narratif, qu’ils soient «traditionnels», davantage contemporains ou de l’extrême avant-garde, n’échappent plus à cette dynamique formelle intrinsèquement sémiotique et, dans ce sens, le travail de décryptage, de compréhension et d’intégration des signes, codes, modes et langages (Lacelle, Acerra et Boutin 2023; Serafini 2022) ne peut vraiment être accompli qu’avec la convocation de l’appareil conceptuel et des outils d’une narratologie actualisée.
Conclusion
Le lecteur en formation – formelle ou informelle – a plus que jamais besoin, en cette époque où pullulent tous les imaginaires (Gervais 2018) et encore tant d’autres à venir en autant de métavers (Lacelle, Acerra et Boutin 2023), de repères narratologiques. L’enseignement/apprentissage de la fiction narrative doit alors léguer à ce récepteur (inter/hyper)actif d’indispensables moyens de compréhension, certes, mais aussi de réaction et surtout d’engagement réel avec le fait fictionnel, car il en va de son rapport au monde qui a été, qui est, et qui, bien sûr, vient. Bref, son rapport au temps comme triple expérience du récit narratif (Picard 1989; Florey et Cordonier 2020): déchiffrement, fictionnalisation et mise hors-temps (mythification) du temps. Voilà, à mon humble avis, l’un des devoirs disciplinaires parmi les plus pressants pour le champ disciplinaire concerné.
Or il ne faudrait surtout pas se contenter de reproduire – assez bêtement – les pratiques cristallisées du passé à l’occasion d’une telle reconfiguration de la didactique du récit, c’est-à-dire remplacer, sans considération à l’égard de l’histoire scolaire des dernières décennies, une «grammaire» par une autre. Le préfixe post, dans «posthumanisme» comme dans «narratologie post classique», implique, j’ose le rappeler, de façon intrinsèque, et à partir des acquis d’hier et de jadis, de faire plus et surtout de faire mieux. Je ne voudrai jamais, personnellement, d’une classe de littérature où les élèves seront évalués, encore et toujours, en fonction de leur seule capacité à accumuler et à recracher sans raisonnement ancré, ni signifiance réelle pour leur propre imaginaire, des savoirs narratologiques manifestement déconnectés, tout aussi postclassiques qu’ils soient. Mieux vaudra alors, pour l’imaginaire individuel, de se perdre sans fin dans le labyrinthe de son choix.
Bibliographie
Acerra, Eleonora (2019), Les applications littéraires pour la jeunesse. Œuvres et lecteurs, thèse de doctorat, Montpellier, Université Paul Valéry.
Alber, Jan et Monika Fludernik (dir.) (2010), Postclassical Narratology: Approaches and Analyses, Columbus, Ohio State University Press.
Ahr, Sylviane (2009), D’une lecture empirique à une lecture subjective argumentée: quels processus cognitifs et langagiers mobiliser ?, Genève, Unige: https://www.unige.ch/litteratures2010/contributions_files/Ahr%202010.pdf
Baquiast, Jean-Paul (2014), Ce monde qui vient: sciences, matérialisme et posthumanisme au XXIe siècle, Paris, L'Harmattan.
Baroni, Raphaël (2020), «Tension narrative», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir), Paris, Honoré Champion, p. 266-269.
Baroni, Raphaël (2017), Les rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2010), «Ce que l’intrigue ajoute au temps. Une relecture critique de Temps et récit de Paul Ricœur», Poétique, n° 163, p. 361-382.
Besnier, Jean-Michel (2009), Demain les posthumains: le futur a-t-il encore besoin de nous ? Paris, Fayard.
Bell, Alice (2019), «Digital Fictionality: Possible Worlds Theory, Ontology, and Hyperlinks», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 249-271.
Boccaccini, Frederico (dir.) (2023), Phénoménologie de l’action. Perspectives contemporaines sur l’agentivité et le sujet, Leiden, Brill.
Bootz, Philippe (2011), «La littérature numérique en quelques repères», in Lire dans un monde numérique, C. Bélisle (dir.), Presses de l’enssib. https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.1095
Bouchardon, Serge (2014), La valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann.
Boutin, Jean-François (2019), «Posthumanisme, éducation et littératie multimodale et médiatique: une injonction», R2LMM, vol. 10, https://doi.org/10.7202/1065533ar
Boutin, Jean-François et Virginie Martel (2021), «Le roman graphique - bande dessinée - historique: entre discours profane et discours savant… une lecture dialectique» , in Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire (deuxième édition revue et augmentée), M.-A. Éthier et D. Lefrançois, p. 281-295.
Braidotti, Rosi (2013), The Posthuman, Cambridge, Polity Press.
Braidotti, Rosi et Maria Hlavajova (dir.) (2018), Posthuman Glossary, Londres, Bloomsbury.
Besson, Anne (2007), La fantasy, Paris, Klinksieck.
Brehm, Sylvain et Maude Lafleur (dir.) (2019), Formes et enjeux de la transmission dans les fictions contemporaines pour adolescents et adolescentes, Montréal, Nota bene.
Brunel, Magali (2021), L'enseignement de la littérature à l'ère du numérique. Études empiriques au collège et au lycée, Rennes, PUR.
Brunel, Magali et Serge Bouchardon (2020), «Enseignement de la littérature numérique dans le secondaire français: une étude exploratoire», R2LLM, vol 11, https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2020-v11-rechercheslmm05499/1071476ar/
Brunel, Magali, François Quet et Jean-François Massol (dir.) (2018), L'enseignement de la littérature avec le numérique, Bruxelles, Peter Lang.
Connan-Pintado, Christiane (2019), «Stéréotypes et littérature de jeunesse», Hermès, n° 83, p. 105 à 110.
Daignault, Marie-Christine, (2010), La stéréotypie ou l'art de persuader, mémoire de maitrise, Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi.
David, Jérôme (2014), «Chloroforme et signification: pourquoi la littérature est-elle si soporifique à l’école ?», in Les passions en littérature. De la théorie à l’enseignement, R. Baroni et A. Rodriguez (dir.), Études de Lettres, n° 295, p. 19-32.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Dufays, Jean-Louis (2023), «Innover en didactique de la littérature: pourquoi ? Comment ? À quelles conditions ? Avec quels effets ? Retour sur trente années d’expériences», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8070
Dufays, Jean-Louis (2010 [1994]), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang.
Dufays, Jean-Louis et Magali Brunel (2023), «Innovations en lecture et en écriture littéraires. Questions et perspectives pour la recherche en didactique du français», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8085
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne et Dominique Ledur, (2015 [1996]), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Bruxelles, De Boeck.
Dufays, Jean-Louis et Béatrice Kervyn (2020), «Stéréotype», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 197-200.
Dufays, Jean-Louis et Béatrice Kervyn (2010), «Le stéréotype, un objet modélisé pour quels usages didactiques ?», Éducation et didactique, vol. 4, n° 1, p. 53-80.
Dufourcq, Annabelle (dir.) (2016), Est-ce réel? Phénoménologies de l’imaginaire, Leiden, Brill.
Éthier, Marc-André et David Lefrançois (dir.) (2021), Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire (deuxième édition revue et augmentée), Québec, PUL.
Florey, Sonya et Judith Émery-Bruneau (2023), «Innover en didactique de la poésie: quelle pérennité ?», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8289
Florey, Sonya et Noël Cordonier (2020), «Temporalités de la lecture», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir), Paris, Honoré Champion, p. 321-322.
Gervais, Bertrand (2008), La ligne brisée. Logiques de l’imaginaire, tome II, Montréal, Le Quartanier.
Gervais, Bertrand (2018), «L’imaginaire contemporain: plongées et contreplongées», in Soif de réalité: plongées dans l’imaginaire contemporain, B. Gervais et al. (dir.), Québec, Nota Bene, p. 7-15.
Gervais, Bertrand (2023), Un imaginaire de la fin du livre. Littérature et écrans, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Guillemette Lucie et Josiane Cossette (2006), «La coopération textuelle», in Signo [en ligne], L. Hébert (dir.), http://www.signosemio.com/eco/cooperation-textuelle.asp
Grumbach, Stéphane (2022), L'empire des algorithmes. Une géopolitique du contrôle à l'ère de l'anthropocène, Paris, Armand Colin.
Herman, David (1999), Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis, Columbus, Ohio State University Press.
Herman, David (1997), «Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a Postclassical Narratology», PMLA, n° 112 (5), p. 1046-1059.
Jenkins, Henry (2007), «Transmedia Storytelling 101», Pop Junctions, http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html#sthash.gSETwxQX.dpuf
Jenkins, Henry, Sam Ford et Joshua Green (2013). Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New-York, NYU Press.
Jenkins, Henry, Mizumo Ito et Danah Boyd (2015). Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics, Cambridge, Polity Press.
Kress, Gunther (2010), Multimodality, Londres, Routledge.
Kress, Gunther (1997), Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy, Londres, Routledge
Lacelle, Nathalie et Jean-François Boutin (2020), «Multimodal, Multimodalité», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 158-162.
Lacelle, Nathalie, Eleonora Acerra et Jean-François Boutin (2023), «Compétence numérique, réception et production de contenu. Conceptualisation, manifestations et projections», in La compétence numérique en examen (titre provisoire), F. Michelot et S, Collin, Québec, PUQ (sous presse).
Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin et Monique Lebrun (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique: outils conceptuels et didactiques, Québec, Presses de l’Université du Québec
Langlade, Gérard (2004), «Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels», Le français d’aujourd’hui, n° 145, p. 85-96.
Lavocat, Françoise (2019), «Possible Worlds, Virtual Worlds», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 272-295.
Louichon, Brigitte (2009), La littérature après coup: contribution à une théorisation du sujet lecteur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Martin, Thomas L. (2019). «As Many Worlds as Many Artists: Possible Worlds Theory and the Literature of Fantasy», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 201-224.
Melançon, Joseph, Clément Moisan et Max Roy (1988), Le discours d'une didactique. La formation littéraire dans l'enseignement classique au Québec (1852-1967), Québec, Nuit blanche éditeur.
MÉQ (2006), Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉQ (2001), Programme de formation de l’école québécoise.Enseignement primaire, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉSLQ (2011), Progression des apprentissages au primaire. Français, langue d’enseignement, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉSLQ (2011), Progression des apprentissages au secondaire. Français, langue d’enseignement, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉLSQ (2007), Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, deuxième cycle, Québec, Gouvernement du Québec.
New London Group (1996), «A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures», Harvard Educational Review, vol. 66, n° 1, p. 60-92.
Pavel, Thomas (1988), Univers de la fiction, Paris, Seuil.
Picard, Michel (1989), Lire le temps, Paris, Minuit.
Prince, Gerald (2008), «Classical and/or Postclassical Narratology», Esprit Créateur, n° 48 (2), p. 115-123.
Prince, Gerald (2006), «Narratologie classique et narratologie post-classique», Vox Poetica, http://www.vox-poetica.org/t/articles/prince.html
Rabatel, Alain (2004), Argumenter en racontant. (Re)lire et (ré)écrire les textes littéraires, Bruxelles, de Boeck.
Ricœur, Paul (1983), Temps et récit 1, Paris, Seuil.
Ryan, Marie-Laure (2007), «La transfictionnalité dans les médias», in La fiction ? suites et variations, R. Audet et R. Saint-Gelais (dir.), Québec, Nota Bene, p. 131-153.
Ryan, Marie-Laure (1991), Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington, Indiana University Press.
Ryan, Marie-Laure et Alice Bell (2019), «Introduction», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 1-46.
St-Gelais, Richard (2011), Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Seuil.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction ? Paris, Seuil.
Serafini, Frank (2022). Beyond the Visual: An Introduction to Researching Multimodal Phenomena, New-York, Teachers College Press.
Serafini, Frank (2013), Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy, New-York, Teachers College Press.
Sternberg, Meir (2011), «Reconceptualizing Narratology. Arguments for a Functionalist and Constructivist Approach to Narrative», Enthymema, n° 4, p. 35-50.
Pour citer l'article
Jean-François Boutin, "Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/fragments-hermeneutiques-et-phenomenologiques-pour-une-actualisation-narratologique-en-didactique-de-la-trans-fiction
Voir également :
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Que pourraient nous apprendre les images dans les manuels de lecture et les anthologies sur l’enseignement de la littérature au primaire et au secondaire? Le cas de la Suisse romande, entre les années 1870 et les années 1970.
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Introduction
Poser la focale sur l’image dans les manuels scolaires de langue maternelle1dans le cadre d’une enquête historico-didactique peut sembler au premier abord inattendu. Que pourrait nous apprendre l’analyse des images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires, supports privilégiés pour l’enseignement de la littérature? Celles-ci ne participent-elles pas avant tout d’une stratégie éditoriale visant à garantir l’attractivité du manuel? Sans nier l’importance de cette dimension, nous postulons, à l’instar de Perret (2018) pour la France, que les images dans les manuels constituent des indicateurs clés de l’histoire des disciplines scolaires. Louichon (2018) a montré notamment comment l’analyse des images associées aux textes littéraires permet de mettre en lumière des représentations de la littérature scolarisée contrastées selon les niveaux d’enseignement et qui évoluent en fonction des périodes. Qu’en est-il donc en Suisse romande?
Cette étude se donne pour but d’historiciser les relations entre l’image et le texte, en particulier littéraire, dans les manuels de lecture du primaire et les anthologies du secondaire inférieur de Suisse romande, et ce entre les années 1870, marquées par une première tentative d’harmonisation intercantonale, et les années 1970, qui voient l’adoption de manuels communs à tous les cantons romands dans le cadre d’un nouveau paradigme disciplinaire (Schneuwly et al. 2016). Comme le relèvent Ferran et al. (2017), la notion d’image est complexe. En posant la focale sur «l’image» dans les manuels scolaires, nous définissons provisoirement l’image comme toute représentation visuelle qui n’est pas du texte.
Nos questions de recherche sont donc les suivantes:
- Quels manuels de lecture comprennent des images? Quelle est, dans ces manuels, la proportion d’images par rapport aux textes? Quelle est la nature de ces images, sont-elles conçues ou non pour les manuels et qui en sont les auteurs?
- Quel est le statut de ces images par rapport aux textes? Y a-t-il des propositions didactiques et des activités proposées dans les manuels sur ces images, seules ou en lien avec certains textes?
- Enfin, quelles sont les fonctions assignées à ces images? Viennent-elles simplement illustrer le manuel pour le rendre plus attrayant? Sont-elles au service de la compréhension, voire de l’interprétation du texte? Ou encore tiennent-elles lieu de texte destiné à être lu et interprété?
Précisions méthodologiques
Pour traiter cette problématique, cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé «Histoire de l’enseignement de la littérature en “Français” et en “Italien” (Suisse romande et Tessin, mi-XIXe-XXe siècles)» (requête FNS n°100019_197600/1), adopte une approche comparative de type historico-didactique qui s’inspire de la démarche développée par Bishop (2017).
Ainsi, les manuels2 constituent le terrain de recherche principal (Denizot 2016) de cette étude (cf. tableaux 1 et 2 en annexe). Ils constituent des objets aux multiples facettes qui conjuguent des enjeux éditoriaux, économiques, culturels et scolaires (Choppin 2008). Notre corpus est constitué de 46 ouvrages pour les degrés intermédiaire (élèves de 9 à 11 ans) et supérieur (élèves de 12 à 15 ans) du primaire et le degré inférieur du secondaire3 (élèves de 12 à 15 ans) prescrits officiellement par les autorités scolaires des cantons romands. Celui-ci est mis en regard, d’une part, des plans d’études et des programmes édités par les cantons4, d'autre part des articles tirés des revues professionnelles5 qui portent sur la question de la place et de la fonction des images dans les pratiques pédagogiques et dans l'enseignement de la langue maternelle.
Cette étude recourt ensuite, par le croisement de sources, à un jeu d’échelles qui permet les comparaisons. En Suisse, comme nous l’avons dit plus haut, le système scolaire relève au niveau politique principalement de la compétence des cantons. Ainsi, pour notre période, les plans d’études et programmes sont cantonaux. Les manuels scolaires se situent dans un espace intermédiaire: certains sont adoptés par un seul canton, d’autres par plusieurs cantons. Enfin, les revues pédagogiques dépassent largement les frontières cantonales, se faisant l’écho de débats et controverses qui se situent au niveau d’une région linguistique, voire au niveau suisse.
Par ailleurs, cette étude pose la focale plus particulièrement sur quatre cantons contrastés du point de vue de la question de la laïcité à l’école et de la religion6: Genève (protestant et laïque), Vaud (protestant et non laïque mais confessionnellement neutre), les parties francophones de Berne (catholique et protestant, non laïque) et de Fribourg (catholique et non laïque). Ces quelques constats nous permettent d'ores et déjà de supposer que les textes et les images dans les manuels diffèrent d'un canton à l'autre selon la place de la religion et de l'Église dans la gestion de l'Instruction publique et dans les enseignements. Alors que Fribourg se constitue en République chrétienne avec un pouvoir conservateur renforcé qui va au-delà de l’entre-deux-guerres (Praz 2005: 52), il est à supposer que le rôle conféré à l’image dans la tradition catholique – entre autres instruire, émouvoir et marquer l’esprit – (Saint-Martin 2010: 303) puisse se retrouver dans les livres de lecture. À l’inverse, le processus de sécularisation qui touche par exemple la société vaudoise a pu amener les auteurs et éditeurs à faire d'autres choix iconographiques pour leurs manuels.
Enfin, l’analyse de ces données prend appui sur des concepts qui se situent à l’articulation entre les champs de l’histoire de l’éducation et de la didactique de la littérature. Il s’agit notamment de celui de littérature scolarisée. Utilisé au départ par les historiens de l’éducation (Hébrard 1988), le concept de scolarisation désigne, comme le rappelle Denizot (2021), les processus complexes qui sous-tendent la fabrication des objets scolaires en tant que partie de la culture scolaire. Cette dernière est ici envisagée comme une culture qui prend ses racines et s’élabore dans le milieu scolaire, présentant ainsi une spécificité propre par rapport à la culture de la société globale (Chervel, 1992). Il a été montré qu’en Suisse romande - comme en France - la constitution des corpus littéraires s’opère dans la discipline Français entre la fin du XIXe siècle et les années 1970, essentiellement au sein des manuels scolaires par le biais d’extraits (Monnier 2021). Les manuels participent donc pour la période qui nous occupe à la fabrication de la littérature scolarisée, c’est-à-dire de la littérature comme objet scolaire.
Le texte s'organise enfin sur la base d’une périodisation en trois temps, inspirée de travaux antérieurs (Schneuwly et al. 2016). Nous nous centrons d'abord sur la période qui va des années 1870 aux années 1910. Celle-ci se caractérise par la constitution du Français en discipline scolaire et par le développement de l'enseignement intuitif et de la leçon de choses. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1910 aux années 1940, au cours de laquelle, sous l’influence de l’Éducation nouvelle7, les images se diffusent largement au sein des manuels scolaires. Nous terminons avec une focale sur les années 1940-1970 qui se caractérisent par une absence d’évolution et une prégnance moins forte de l’Éducation nouvelle, non sans impact sur la nature, la place et la fonction des images.
Première période (1870-1910). Les images au service du développement des connaissances
Même si dès le début du XIXe siècle des ouvrages scolaires dédiés à l’apprentissage de la lecture courante sont édités au sein des cantons romands, force est de constater que ce n’est qu’à partir des années 1870 que certains moyens d’enseignement sont officialisés, voire généralisés. Cette période est ainsi marquée par une première tentative d’harmonisation des moyens d’enseignement et par l’adoption d’ouvrages de lecture communs qui se concrétisent par la constitution d’une commission romande et par la parution en 1871 de deux livres de lecture adoptés par les cantons de Berne, Vaud et Genève et dédiés aux écoles primaires (Tinembart 2015): le premier, comportant 166 pages, est destiné au degré intermédiaire (Renz 1871) alors que le second, produit à l’échelle romande, comportant 420 pages, est édité pour le degré supérieur (Dussaud & Gavard 1871). Ces deux ouvrages de lecture comprennent près de deux tiers de textes à caractère encyclopédique. Les autres écrits se répartissent entre des récits et des anecdotes diverses, des lettres, ainsi que des poésies narratives ou lyriques. En revanche, les images sont peu présentes. Seules 24 gravures en taille-douce représentant toutes des animaux ont été relevées dans les parties non littéraires du Renz (1871). Il est également intéressant de constater que ces images sont parfois orientées dans un autre sens que le texte par gain de place et qu’elles sont dissociées de l'extrait auquel elles pourraient se rapporter. Nous pouvons en déduire que la fonction de l’image, tout comme celle du texte, est alors de transmettre des connaissances sans pour autant que les deux soient en relation directe. A titre d’exemple, une image d’éléphant est insérée à côté d’une image de dromadaire dans un extrait de texte de Lenz (sans prénom), adapté par Renz, dédié aux animaux domestiques de nos contrées, et qui ne contient de fait qu’une seule phrase sur les charges que peut porter le pachyderme.
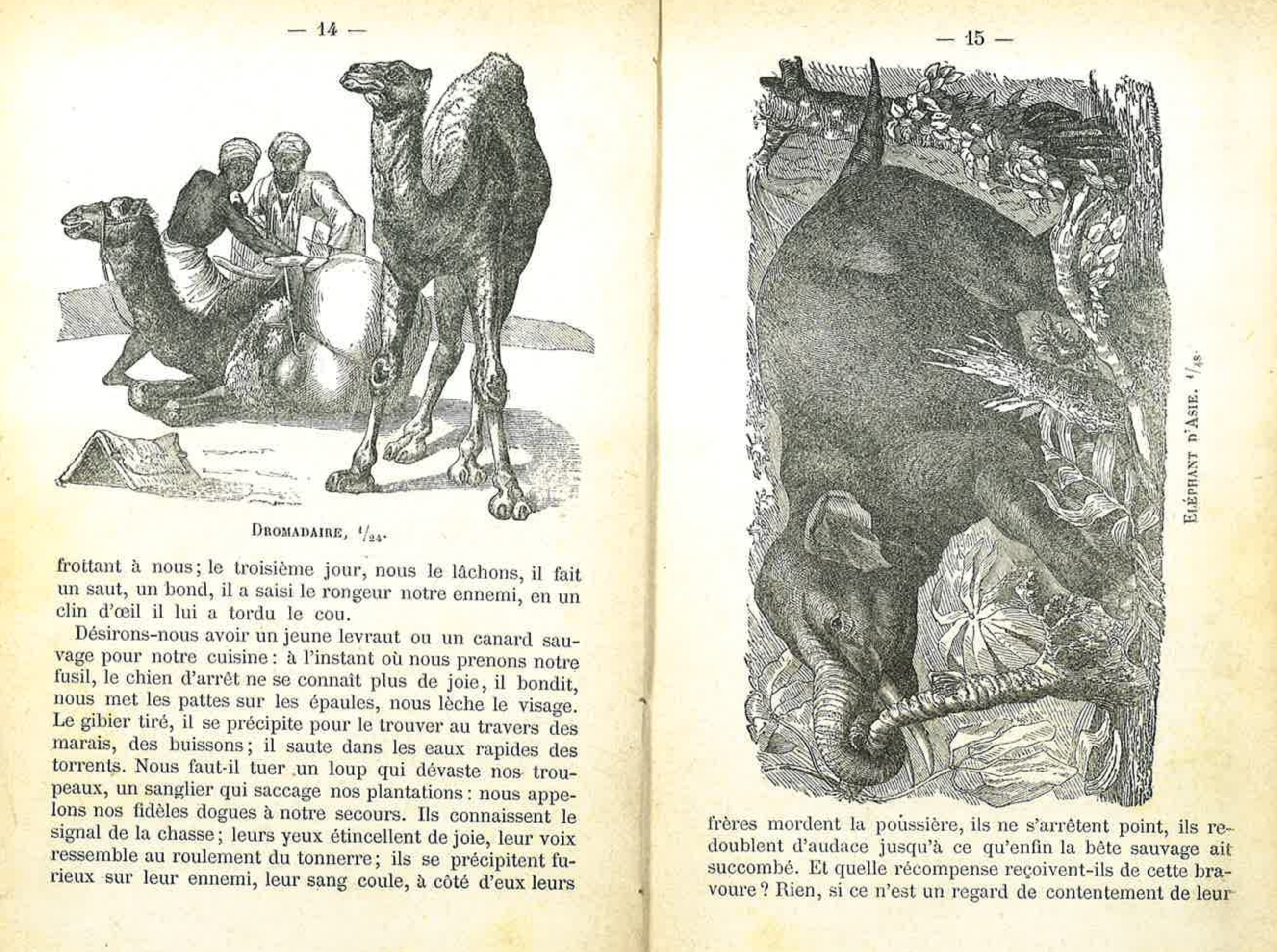
Figure 1: Éléphant d’Asie, 1/48 (Renz 1871: 15)
En revanche, dans le Dussaud et Gavard (1871), le texte dédié à l’éléphant, écrit par le zoologiste Henri Milne Edwards (1800-1885), n’est pas illustré et revêt un caractère plus scientifique, parce qu'il s'adresse aux élèves des degrés supérieurs du primaire et est utilisé dans les premiers degrés des écoles secondaires. Il est intéressant de constater que, dans l’adaptation fribourgeoise de ce même ouvrage en 1881 (Dussaud & Gavard 1881), le texte de Lenz figurant dans le Renz (1871) est alors repris et qu’une autre image d’éléphant y est insérée8.
Entre 1880 et 1900, la génération suivante d’ouvrages officiels de lecture dans les cantons romands conservent leur caractère encyclopédique, mais associent plus étroitement illustrations et textes encyclopédiques. Les images jouent alors un rôle propédeutique quant à la découverte et à la formation au savoir. Cela s’explique notamment par le fait que les plans d’études (à l’instar du Plan d’études pour les écoles primaires du Canton de Vaud du 29 février 1868: 16, qui prescrit «une collection de tableaux pour servir aux leçons d’intuition, une collection de tableaux de lecture et un manuel de lecture») préconisent l’usage de la méthode intuitive dès la fin des années 1860.
Les principes de l’enseignement intuitif9 s’articulent avec la leçon de choses qui apparait dans les programmes romands à partir des années 1870. Selon Kahn, la leçon de choses «se fonde sur la préconisation du recours à l’intuition et n’est pas spécialement associée à un enseignement disciplinaire déterminé, l’enseignement scientifique» (2002: 2).
Aussi, les ouvrages de lecture, en particulier ceux du degré moyen ou intermédiaire, encore majoritairement à caractère encyclopédique en Romandie entre 1880 et 1900, intensifient la présence d’images en lien avec les textes pour permettre aux enseignants d’appliquer la méthode intuitive ou de concevoir des leçons de choses. Certains auteurs renforcent le nombre d’images de sciences naturelles comme dans le Trésor de l’écolier (1885) du canton de Berne. D’autres, comme Le livre de lecture pour les écoles primaires de Fribourg, Degré supérieur (1899), n’illustrent que la partie historique.
Dans les cantons catholiques, à l’instar du canton de Fribourg, certains manuels comme le Livre de lecture pour les écoles primaires du canton de Fribourg, Degré moyen (1889) sont en revanche illustrés dans toutes les parties. Cependant, les deux ouvrages de lecture fribourgeois de 1889 et de 1899 comportent une première partie consacrée aux textes moraux et religieux qui n’existent plus dans les livres des cantons protestants. Au degré moyen (1889), nous trouvons des textes tels que «Dieu notre créateur»; ce premier extrait est illustré par un Dieu ténébreux montrant sa colère depuis les cieux. En revanche, l’ouvrage destiné au degré supérieur (1899) ne contient pas d’image religieuse. La différence majeure entre les ouvrages des cantons protestants et catholiques réside donc dans le fait que les premiers n’incluent pas de textes relatifs à la religion et pas d’images chrétiennes, puisque des ouvrages d’histoire biblique sont édités en parallèle. Les cantons catholiques conservent des textes dits à caractère religieux dans les ouvrages de lecture courante.
Au début du XXe siècle, nous observons une mue dans les ouvrages de lecture. Des auteurs comme Dupraz et Bonjour (1899) expurgent de leurs nouvelles publications les textes à caractère encyclopédique parce qu’ils déclarent «tenir compte aussi de la prochaine publication de manuels spéciaux (histoire, sciences naturelles)» (Dupraz & Bonjour 1903: préface). Dès lors et pour répondre également aux prescriptions cantonales, leurs manuels ne comportent que des textes d’auteurs reconnus non illustrés. Si la littérature a d’ores et déjà fait son apparition dans une moindre mesure dans les ouvrages de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871), il n’en demeure pas moins que les Dupraz et Bonjour (1899/1903) marquent un véritable tournant. Les deux Vaudois affirment que «les livres de lecture s'étaient peu à peu transformés en petites encyclopédies ou abrégés scientifiques d’un attrait et d’une utilité problématique pour l’élève» (Dupraz & Bonjour 1899: III). Ils puisent alors «largement dans la littérature contemporaine» (1899: IV) en proposant des extraits variés organisés en thématiques et non imagés.
Dans les filières secondaires des cantons protestants, les ouvrages à caractère encyclopédique et imagés de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871) sont également utilisés avec les plus jeunes élèves de la filière secondaire. En revanche, pour les élèves plus âgés, ce sont les trois tomes de la Chrestomathie française de Vinet (revue et augmentée par Eugène Rambert) qui sont utilisés. Ces volumes, qui comprennent exclusivement des textes littéraires, n’ont aucune image. Ces Chrestomaties, dès leur parution, obtiennent un large écho qui les pérennise dans leur forme pendant près d’un siècle et marquent durablement l’enseignement du français. Cela met en lumière le phénomène suivant: la lecture et l’étude des textes n’a pas la même fonction dans les deux filières. Au primaire, les livres de lecture sont un vecteur d’acquisition de connaissances; au secondaire, les chrestomathies et les anthologies visent à développer la culture littéraire et langagière de l’élève dans un enseignement encore marqué par les principes rhétoriques.
Au cours de cette première période, l’image est donc présente dans les parties encyclopédiques des livres de lecture du primaire, mais déconnectée du texte.
Deuxième période (1910-1940). Les images comme portes d’accès à la lecture des textes littéraires
Cette deuxième période se caractérise par un contraste fort entre les anthologies et chrestomathies prescrites pour les filières du secondaire qui, à l’instar de la première période, ne comportent généralement aucune image, et les manuels de lecture du primaire où les images vont se multiplier, aussi bien dans le degré moyen que dans le degré supérieur10.
Or, contrairement à la période précédente, où les images étaient présentes dans les parties scientifiques des manuels, on assiste à partir des années 1910 à une augmentation du nombre d’images désormais étroitement associées aux textes littéraires, centraux dans les manuels de lecture du primaire (Muller 2007).
Ce phénomène se retrouve dans les manuels de tous les cantons. Sous l’influence de l’Éducation nouvelle, comme le montre Renonciat à propos des albums du Père Castor publiés en France dans l’entre-deux guerres, l’image va en effet être envisagée comme une porte d’accès privilégiée «aux acquisitions – sensorielles, motrices, psychologiques et intellectuelles – nécessaires à l’exercice d’une «lecture "intelligente", qui ne se réduit pas à un simple mécanisme de déchiffrement» (2009: 68).
L’inspecteur scolaire Louis Henchoz publie un article dans l’Éducateur en 1930 sur la question de l’illustration dans les manuels scolaires. Il rappelle que c’est chez Hachette que les premiers manuels avec gravures paraissent dans les années 1850, non sans remous: on parle alors à Paris de «profanation de la littérature» et «d’atteinte à la gravité de l’enseignement» (1930: 279). Il défend alors l'idée suivante:
Il faudra trouver de bons artistes pour les originaux. [...] bannissons résolument toute excentricité, toute présentation grotesque ou banale. Allons à ceux qui cherchent de fixer avec sincérité ce qui [...] ‘caractérise avec la plus absolue vérité les personnalités et les faits’. Tous nos manuels doivent avoir un cachet artistique qui emporte l’approbation générale immédiate. (1930: 280)
Si les images se généralisent dans l’ensemble des disciplines scolaires, Henchoz précise la place et le rôle que celles-ci devraient occuper dans les manuels pour l’enseignement de la langue maternelle:
Dans les manuels de lecture qui viendront successivement, les gravures seront toujours en rapport avec le texte. On veillera à ne rien admettre qui soit pure fantaisie. Pour les dernières années, les reproductions d’œuvres d’art, peinture, sculpture, architecture, d’une portée éducative incontestable, pourront être intercalées comme hors-texte, en nombre restreint toutefois. (1930: 281)
Les images, avec les textes avec lesquels elles forment un tout, constituent pour l’inspecteur des moyens par excellence pour le développement intellectuel et artistique des élèves; et ce dernier de conclure: «elles auront préparé le terrain pour l’observation visuelle, pour l’analyse». (Henchoz 1930: 281)
Dès 1910, les manuels sont en effet illustrés par des dessins d’un artiste suisse reconnu, le plus souvent nommé explicitement.
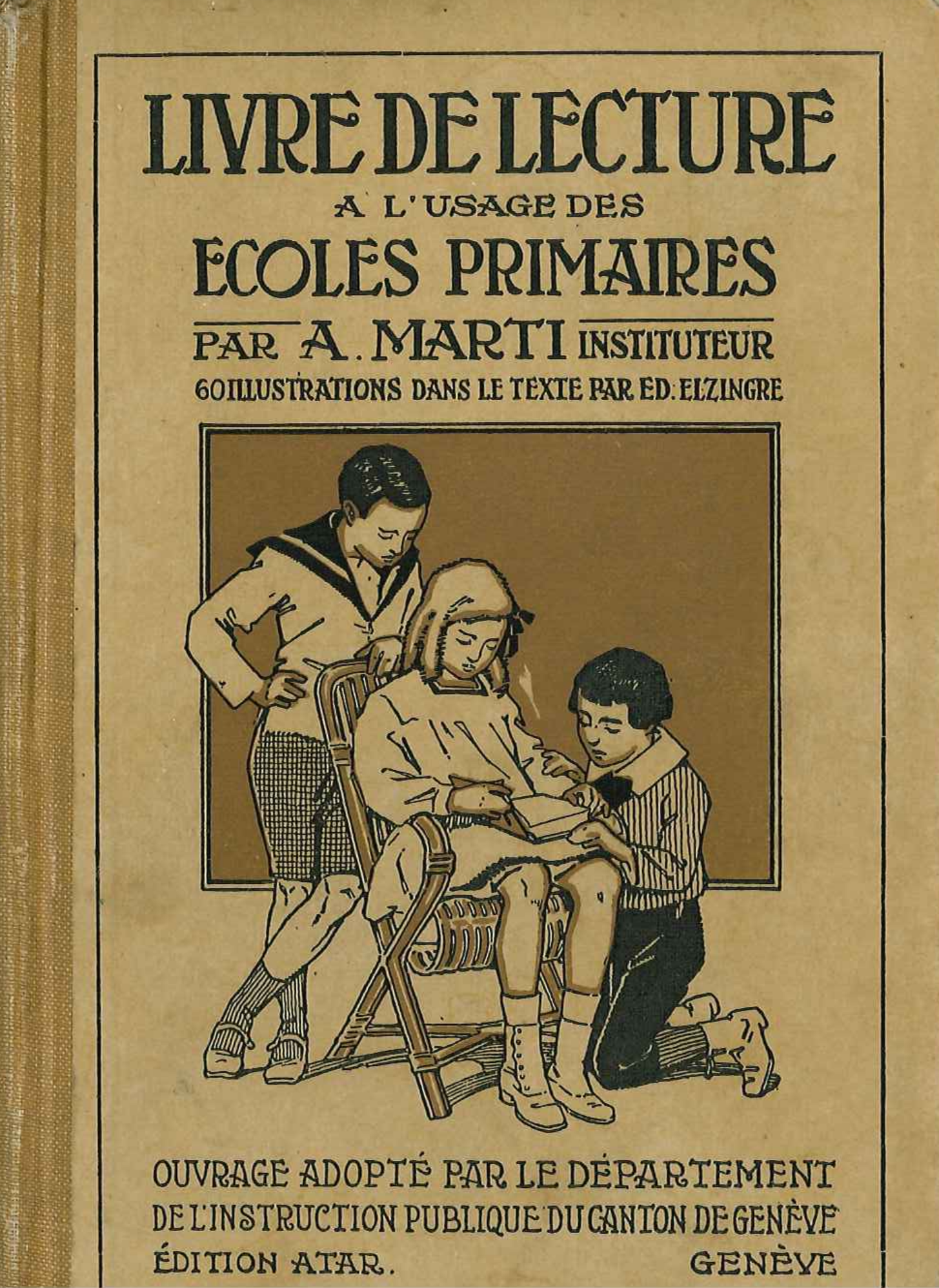
Figure 2: Première de couverture du Livre de lecture à l’usage des écoles primaires (Marti 1916)
Dans la première version du manuel genevois de Marti (réédité en 1936 sous le titre Heures claires), on compte ainsi 60 dessins d’Edouard Elzingre11pour 231 extraits «puisés chez les grands écrivains […] et dans ceux de leurs livres qui traitent de psychologie enfantine, ou qu’ils ont spécialement écrits pour la jeunesse» (Marti 1916: 4). Ces illustrations visent à faciliter l’accès des élèves à la «lecture expliquée»12 des morceaux; elles «ajoute[nt] un attrait de documentation pittoresque et peu[ven]t donner matière à d’intéressants exercices d’élocution» (1916: 4).
A partir des années 1930, la photographie fait son apparition dans les manuels scolaires. C'est le cas dans Lectures (Bonjour & Jeanrenaud 1931), destiné aux degrés supérieurs du primaire. C'est le cas également dans J’aime lire (1929), élaboré par une commission présidée d’abord par Albert Malche, puis par Albert Atzenwiler très largement influencé par l’Éducation nouvelle. Se voulant résolument moderne et novatrice, cette commission s‘inscrit contre ceux qui reprochent à la photographie une mauvaise définition de l’image rendant sa lisibilité insuffisante auprès des enfants (Renonciat 2009). 60 dessins, photographies, schémas cartographiques ou encore des reproductions de tableaux viennent ainsi illustrer les 140 morceaux d'écrivains reconnus – Charles Ferdinand Ramuz, Blaise Cendrars, Jules Renard ou Jean de La Fontaine – «qui leur [aux élèves] plaisent, et par la beauté de la forme et par l’attrait du récit» (Préface, p. 8). Cette diversification de l’image et le nouveau statut qu’elle prend par rapport au texte est en lien avec les avancées graphiques et techniques de l’époque.
Corollairement, si l'image, à l‘instar des définitions de certains mots de vocabulaire placés en note de bas de page, vise avant tout à faciliter la compréhension du texte et à enrichir la culture de l’élève, dans certains extraits, elle tend à perdre son statut de subordonnée. Par exemple, le tableau intitulé Pasteur dans son laboratoire d’Albert Edelfelt est explicitement cité dans l’extrait de Louis Pasteur par E. de Villeroy qui en propose une brève description: «un tableau connu le représente dans son laboratoire, regardant le contenu d’une éprouvette à la lumière du jour: toute la vie du savant est là» (J’aime lire 1929: 138).
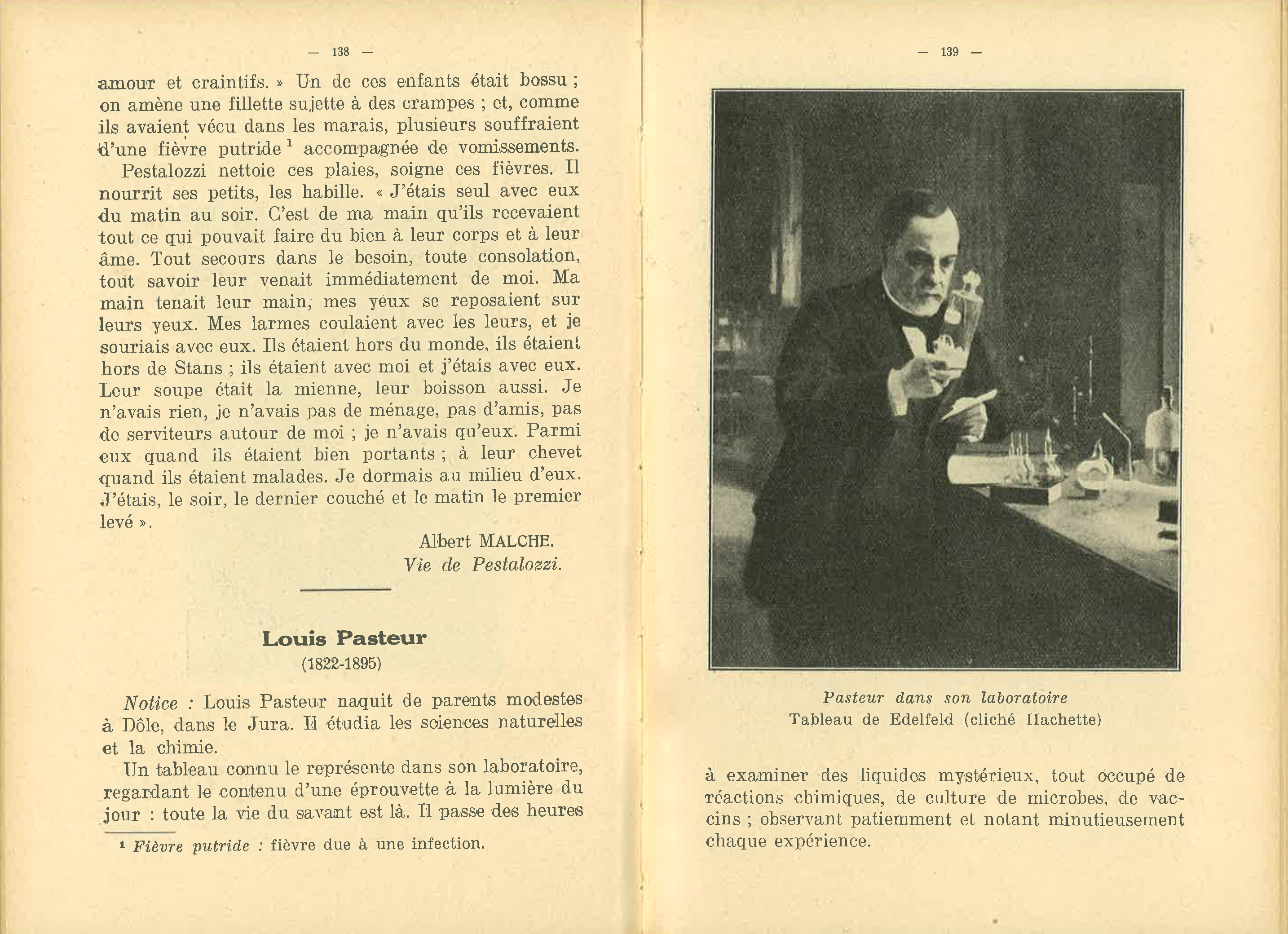
Figure 3: «Pasteur dans son laboratoire», Tableau de Edelfelt (cliché Hachette) (J’aime lire 1929: 139)13
A contrario, dans les manuels en vigueur dans les cantons non laïques, l’image, par la dimension émotionnelle qu’elle véhicule, a avant tout pour fonction de renforcer le sentiment patriotique et religieux des élèves. Cela est le cas aussi bien dans les manuels bernois que dans les manuels fribourgeois. Ainsi, dans Mes Lectures (1934), destiné aux élèves fribourgeois du primaire supérieur, les textes d’auteurs et d’autrices avant tout contemporains, ainsi que les dessins du peintre moderne fribourgeois Gaston Thévoz et du dessinateur bernois M. R. Sager, ont été sélectionnés sur les critères suivants:
a) qu’ils ne blessent en rien la foi et la morale chrétienne; b) qu’ils ne soient ni trop difficiles ni trop imagés; c) qu’ils soient irréprochables en ce qui concerne la correction de la langue, sa pureté, et même la ponctuation; d) enfin, que l’illustration ne soit pas un mystère à éclaircir. (Protocoles de la Commission permanente des études, Archives de l’État de Fribourg, DIP III 14)
Ainsi, les images sélectionnées par la Commission ne doivent pas être un obstacle à la compréhension du texte qui constitue un modèle pour l’apprentissage de la langue.
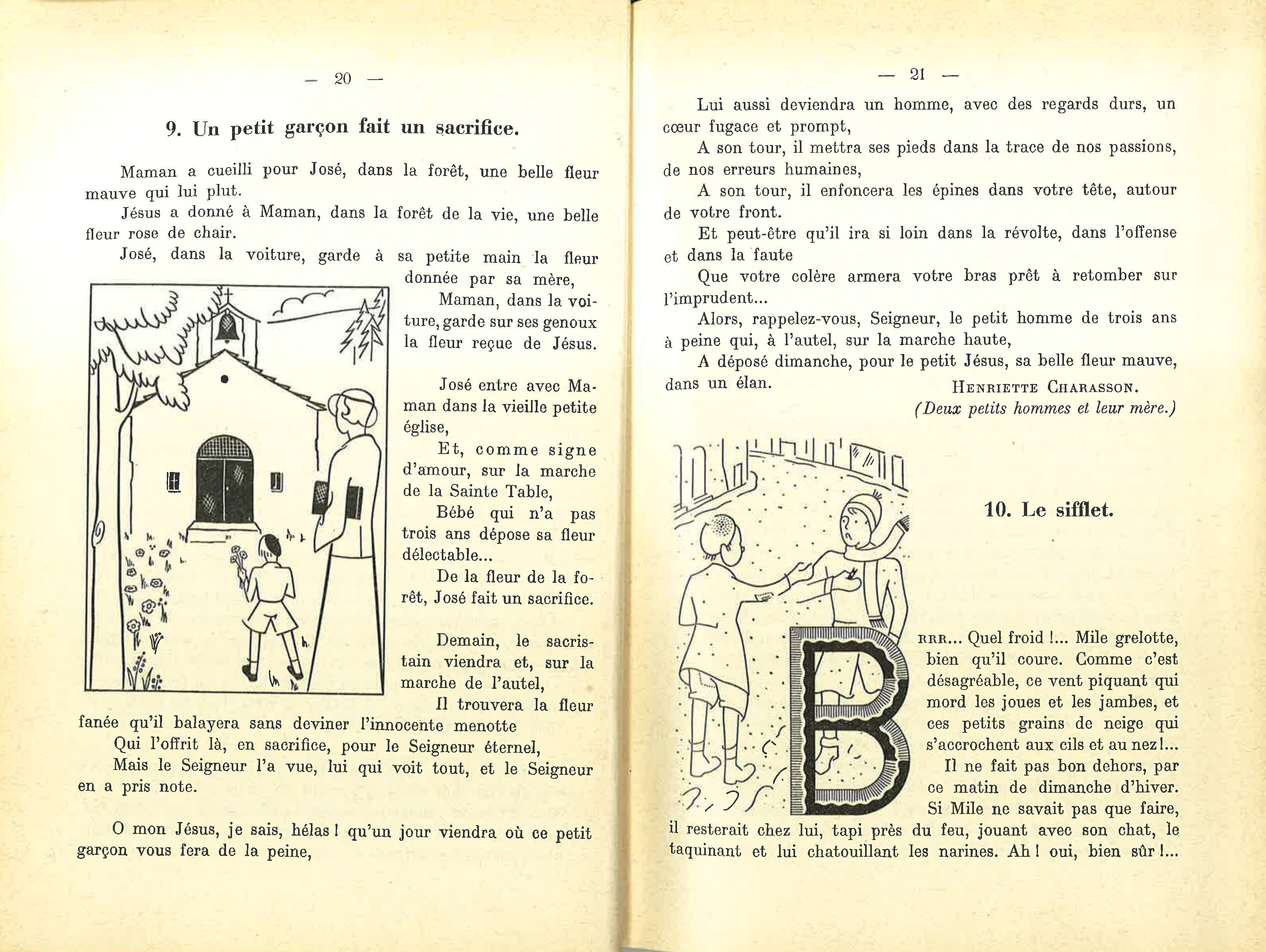
Figure 4: Extrait de «Deux petits hommes et leur mère» d’Henriette Charasson (Mes Lectures 1934: 20)
Enfin, alors que l’image est désormais, contrairement à la période précédente, largement présente dans les manuels de lecture destinés au primaire supérieur, elle continue à être absente dans les anthologies et les chrestomathies destinées aux élèves des filières secondaires. Une seule exception est celle de l'anthologie belge de Procès (1927), Modèles français, extraits des meilleurs écrivains, utilisée au collège à Fribourg. Les textes y sont regroupés par auteurs classés de façon chronologique, et chaque rubrique s’ouvre sur un portrait de l’écrivain, comme ici.
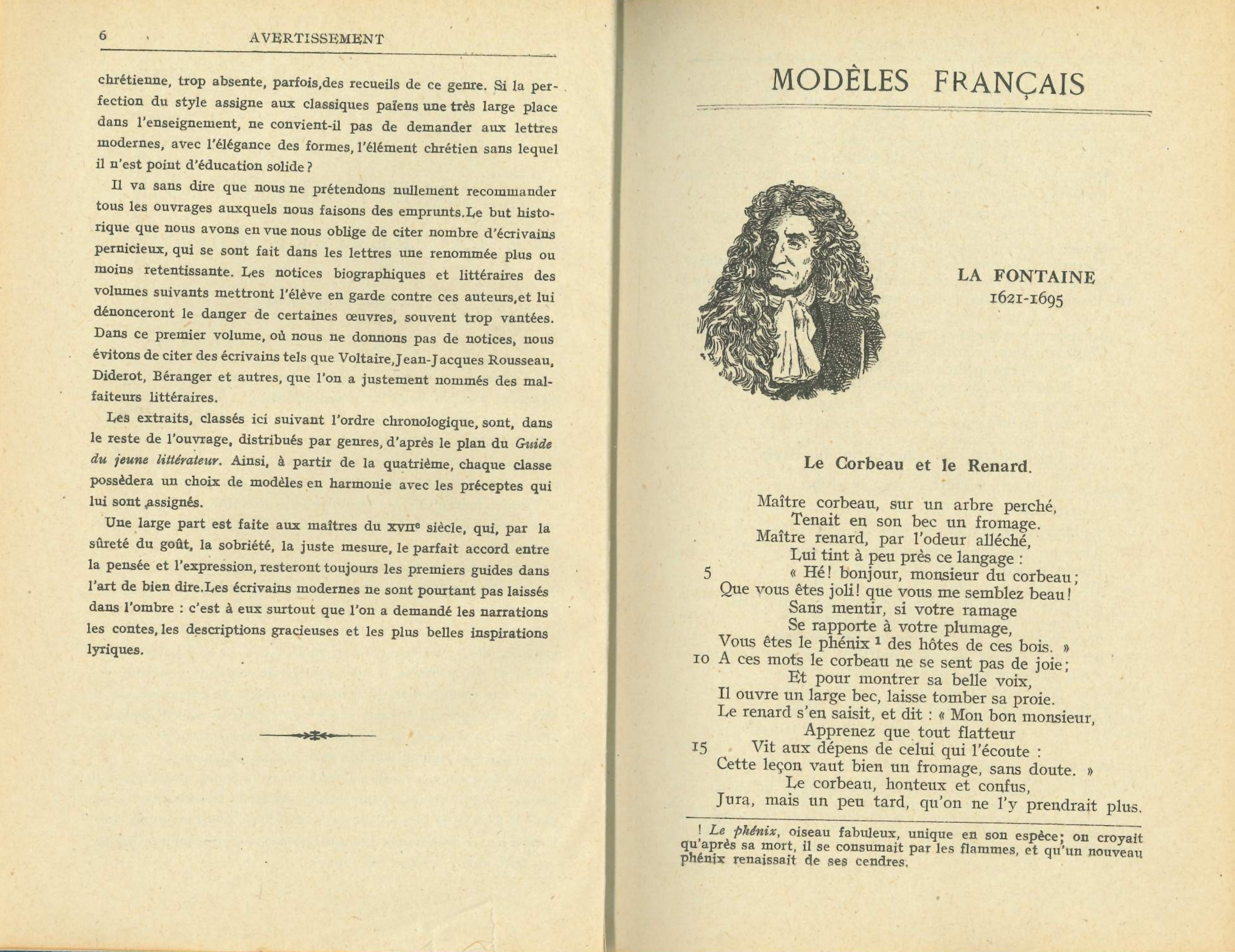
Figure 5: Portrait de La Fontaine (Procès 1927: 7)
Ces images figuratives (Perret 2019: 101) viennent ainsi renforcer la finalité du manuel qui constitue une initiation à l'histoire de la littérature centrée sur l’admiration de l’auteur, dans la continuité de l’enseignement rhétorique qui perdure dans les pratiques sous forme de couches sédimentées. On est donc ici dans une conception de la littérature scolarisée très différente de celle en vigueur au primaire à cette période.
Troisième période (1940-1970). L’image dans les manuels: lieu de résistance au monde audio-visuel qui concurrence la lecture de textes littéraires?
Les années d’après-guerre voient une généralisation de certaines techniques d’impression, rendant possible un recours plus systématique à la couleur, à des mises en page qui ne se contentent pas de juxtaposer le texte et l’image à la reproduction de photographies, le tout à bas coûts (Perret 2019: 98). Ce développement technique s’inscrit dans une expansion économique et industrielle plus large en Suisse, et s’accompagne de l’entrée dans les foyers et dans les classes de nouveaux moyens audiovisuels, avec la radio et la presse magazine qui s’affirment d’abord, avant que la télévision ne s’impose à la fin des années 1960 (Clavien 2017). Les milieux de l’édition connaissent néanmoins un léger décalage. Marqués dans un premier temps par la Défense spirituelle14 qui a prévalu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont amenés à publier des textes conformes aux valeurs du mouvement, ils trouvent une nouvelle dynamique à la fin des années 1950 avec la littérature de jeunesse et la publication de nouveaux écrivains issus de la scène romande (Corsini & Vallotton 2011). Dès lors, nous pouvons nous demander si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines prémices à cette place donnée à l’image par rapport au texte peuvent être observées dans les manuels scolaires en langue maternelle, alors que les composantes de la discipline tendent à rester stables durant cette période (Vollenweider en cours).
La présence exponentielle de l’imagerie visuelle n’est pas ignorée par les pédagogues. Dans l’Annuaire, Samuel Roller, co-directeur des études pédagogiques à Genève, observe que «le monde se voit envahi par l’image» (1957: 84) et relève la nécessité de former aux images à l’école:
Dès lors, on voit pour [l’école] apparaître une tâche nouvelle: aider l’enfant à faire son chemin dans ce monde d’images qui le sollicitent; autrement dit le mettre en état, après avoir éprouvé toutes choses, de «retenir ce qui est bon». Il résulte de cela que les instituteurs ne peuvent pas écarter l’image de leur enseignement. (1957: 84)
Mais cette apparente ouverture aux images s’accompagne d’une inquiétude: va-t-elle détrôner le «texte imprimé», s'interroge Roller? Pour ce dernier, l’image est un instrument de culture qu’il s’agit d’accueillir et de rendre intelligible.
La relative ouverture de Roller n’est toutefois pas partagée dans tous les milieux pédagogiques, comme en témoignent les directives officielles dans le canton de Fribourg. L’image est strictement encadrée dans le programme général de Fribourg en 1967. Les recommandations de ce programme n’accordent pas le même statut à l’image qu’au texte et à la lecture. L’image y est sujette à une certaine méfiance et sert à réaffirmer la valeur du texte écrit:
[…] l’image visuelle est naturellement plus attirante qu’une page de lettres à déchiffrer. L’apprentissage de la lecture se heurte de ce fait à une sérieuse concurrence. Les illustrations des manuels y remédient quelque peu. […] Il n’y a pas de vraie culture par l’image seule. L’école se doit donc, même aujourd’hui, 1° de défendre la «civilisation du livre»; 2° de ne pas bouder les moyens audio-visuels, mais de se servir de leur stimulant pour orienter l’élève vers un approfondissement de leur rapport par la lecture et la réflexion personnelle. (1967: 1.2)
Cette instrumentalisation de l’image contre elle-même souligne que les images sélectionnées pour accompagner les morceaux dans les manuels de lecture fribourgeois ont pour principale fonction d’amener au texte et de savoir ensuite s’effacer pour laisser la place seulement à la lecture de textes. Elles ne doivent pas les concurrencer.
Ce statut donné à l’image s’observe notamment dans les manuels de lecture fribourgeois du primaire moyen (1955) et supérieur (1954) qui sont prescrits jusqu’à la fin des années 1960. Les améliorations techniques récentes n’ont pas amené de grands bouleversements dans la mise en page. Si la couleur y fait son entrée, elle est utilisée avec parcimonie. Textes et dessins – il n’y a presque jamais de reproductions de gravures ou de photographies15 – s’enchaînent généralement, et la mise en page ne les juxtapose ou les superpose16 rarement. La présence des images se renforce toutefois.
Elle se renforce également dans les manuels genevois et vaudois; son utilisation ne semblant pas faire l’objet d’autant de réserve qu’à Fribourg. Les manuels vaudois et bernois présentent quelques particularités au regard du reste du corpus. L’ouvrage vaudois pour le degré moyen (Foretay 1944) adopte une mise en page particulièrement variée, du point de vue de la disposition de l’image sur la page comme de l’habillage du texte (cf. figure 6).
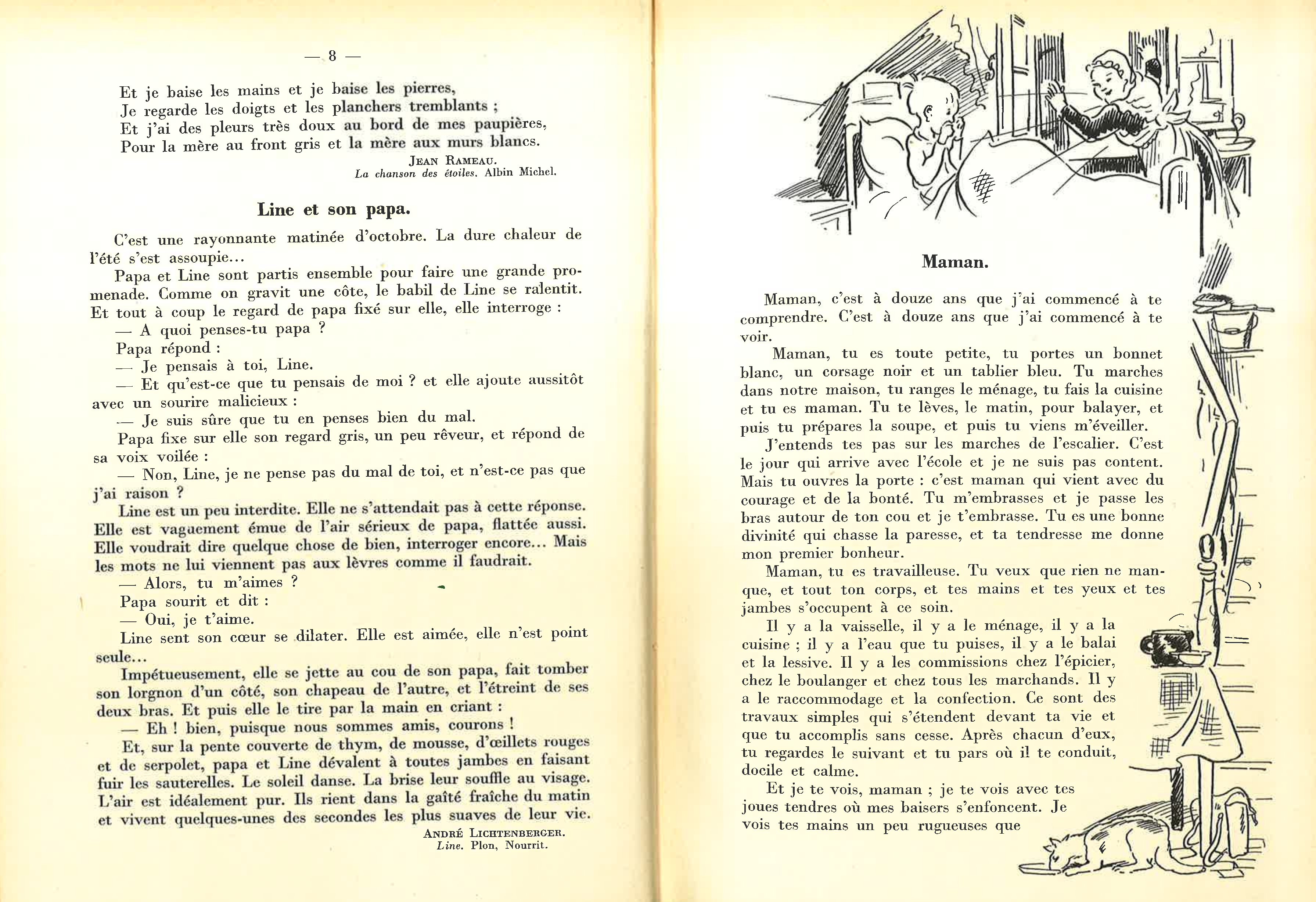
Figure 6: Illustration du texte «Maman» (Foretay 1944: 9)
Quant à l’ouvrage vaudois pour le degré supérieur (Foretay & Jeanrenaud 1946) et le manuel bernois pour le degré moyen (Jeanprêtre et al. 1961), ils contiennent presque exclusivement des photographies. Enfin, seuls des tableaux des XIXe et XXe siècles sont reproduits dans le manuel bernois pour le degré supérieur (Devain et al. 1964), non à des fins d’illustration des textes, mais pour amener une culture artistique et parce que «ces œuvres correspondent certainement à la sensibilité de l’enfant aujourd’hui.» (p. 5)
A l’instar des périodes précédentes, la majorité des images sont réalistes et renvoient au quotidien. Par exemple, dans le manuel fribourgeois Lecture et poésie (1955), les images n’illustrent pas des situations ou des objets décrits dans les textes qui pourraient être inconnus des élèves, mais au contraire les accompagnent vers une réalité qu’ils connaissent: des animaux, le foyer, le travail aux champs, des vues de la ville de Fribourg. Cette fonction de représentation est plus prégnante au degré moyen où les manuels contiennent plus d’images qu’au degré supérieur, et ce dans tous les cantons.
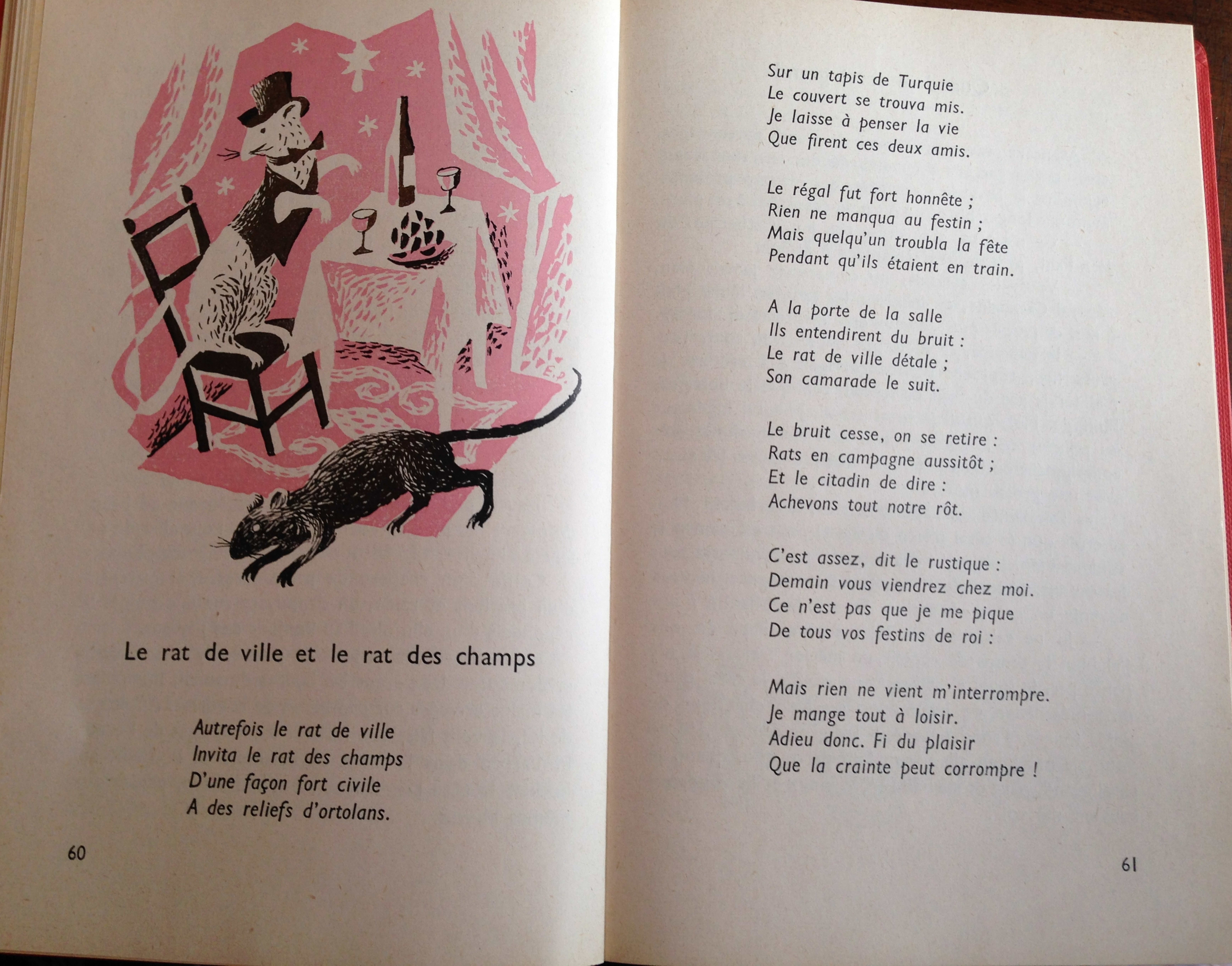
Figure 7: Illustration de la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (Lecture et poésie 1955: 60)
Quelques exceptions peuvent être relevées lorsque les images qui illustrent des textes de fiction ouvrent sur l’imaginaire. Comme on le voit dans la figure 7 extraite du manuel fribourgeois pour le degré moyen, la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (1955: 60-61) est illustrée par deux rats, dont l’un est assis à une table et habillé d’un haut-de-forme et d’un gilet, alors que l’autre, à quatre pattes et de couleur noire, n’a aucun attribut civilisé. Le contraste entre les deux animaux sert à saisir la comparaison qui fait l’objet de la fable. Ce contraste demande aussi une capacité d’interprétation qui n’est soutenue par aucune consigne ou légende.
Nonobstant ces dessins particuliers et les tableaux reproduits dans le manuel bernois de 1964, la majorité des images réalistes ont une fonction référentielle qui participe à canaliser l’imagination (Perret 2019: 104) vers la réalité connue des élèves. Roller souligne effectivement qu’elle tient le rôle de medium entre l’élève et la réalité:
L’image met l’enfant en présence du réel et il importe que cette rencontre soit telle que ce même enfant réagisse «comme si» la réalité concrète s’offrait véritablement à son regard. Si dès lors l’image atteint à ce pouvoir évocateur, c’est qu’elle est devenue document, c’est-à-dire qu’elle est au sens étymologique du terme, instrument d’enseignement (documentum, qui sert à instruire). (Roller 1957: 83)
A Fribourg, en continuité avec les périodes précédentes, les images servent également à garantir la présence du religieux, alors que les textes dans certaines sections des manuels ne traitent pas de la foi. Dans les parties «Notre pays», «La vie à la campagne» ou «Jeux et travaux» du manuel du primaire moyen (1955), figure à chaque fois au moins une représentation d’un établissement religieux. Ainsi, le morceau instructif «Qui construit nos demeures?» et le morceau moral «Demain ou jamais!» sont accompagnés par le dessin de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg (p. 165) alors qu’aucun des deux ne l’évoque ou n’a pour thème la chrétienté.
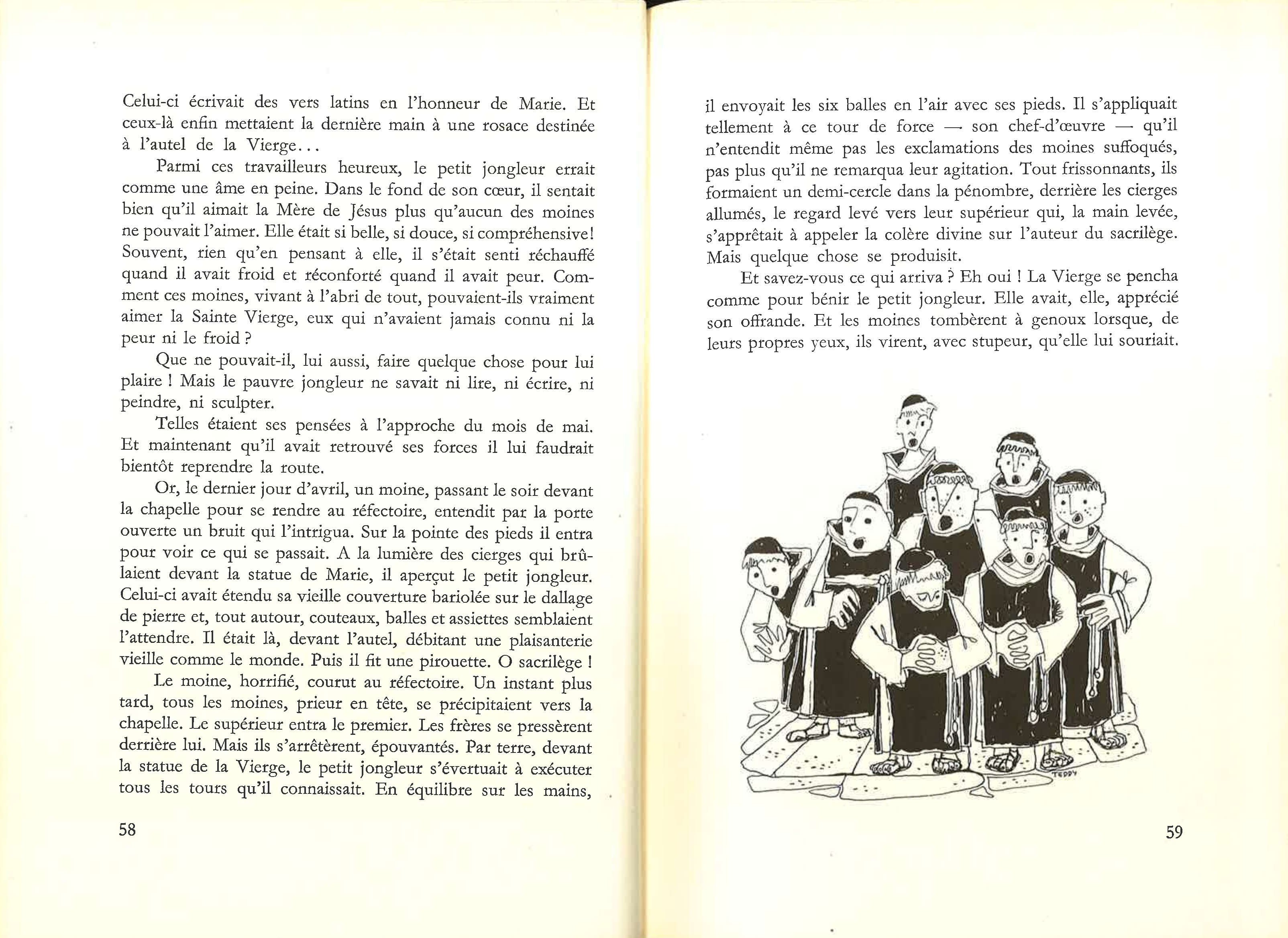
Figure 8: Image accompagnant «Le jongleur de Notre Dame», récit d’un auteur inconnu (Mes lectures 1954: 59)
Sans compter ces représentations réalistes d’établissements religieux, le manuel compte 22 images qui renvoient au catéchisme, à la vie des saints ou à des scènes de la vie chrétienne. Cette fonction religieuse de l’image n’a pas été relevée dans les autres cantons.
Au secondaire, la présence prégnante de l’image dans la société ne paraît pas non plus avoir eu d’impact sur la place donnée à l’image. En effet, les manuels conservent les habitudes éditoriales de la période précédente et cela est assumé explicitement:
Soucieux de fournir avant tout de beaux textes, nous avons renoncé à toute illustration comme à tout commentaire, et réduit les notes à la simple référence aux sources. La plus belle des images ne trahit-elle pas celle que le texte se réserve d’éveiller? Quel commentaire ne pâlit auprès du texte et ne l’encombre? (Pidoux et al. 1945: 5)
La collection de manuels de Kohler fait exception. Elle compte de nombreuses reproductions d’enluminures, de gravures, de miniatures et de portraits d’auteurs. Les images d’origine, contemporaines à l’époque étudiée dans le manuel, contribuent donc à contextualiser les textes littéraires. Leur rôle n’est pas d’illustrer des récits, mais de compléter la culture artistique des élèves relativement aux différentes périodes littéraires. Elles sont par ailleurs légendées, dans le but de permettre aux lecteurs de les situer dans le contexte historique. Ces images s’inscrivent pleinement dans le projet du manuel, qui sert de support pour un enseignement de l’histoire littéraire.
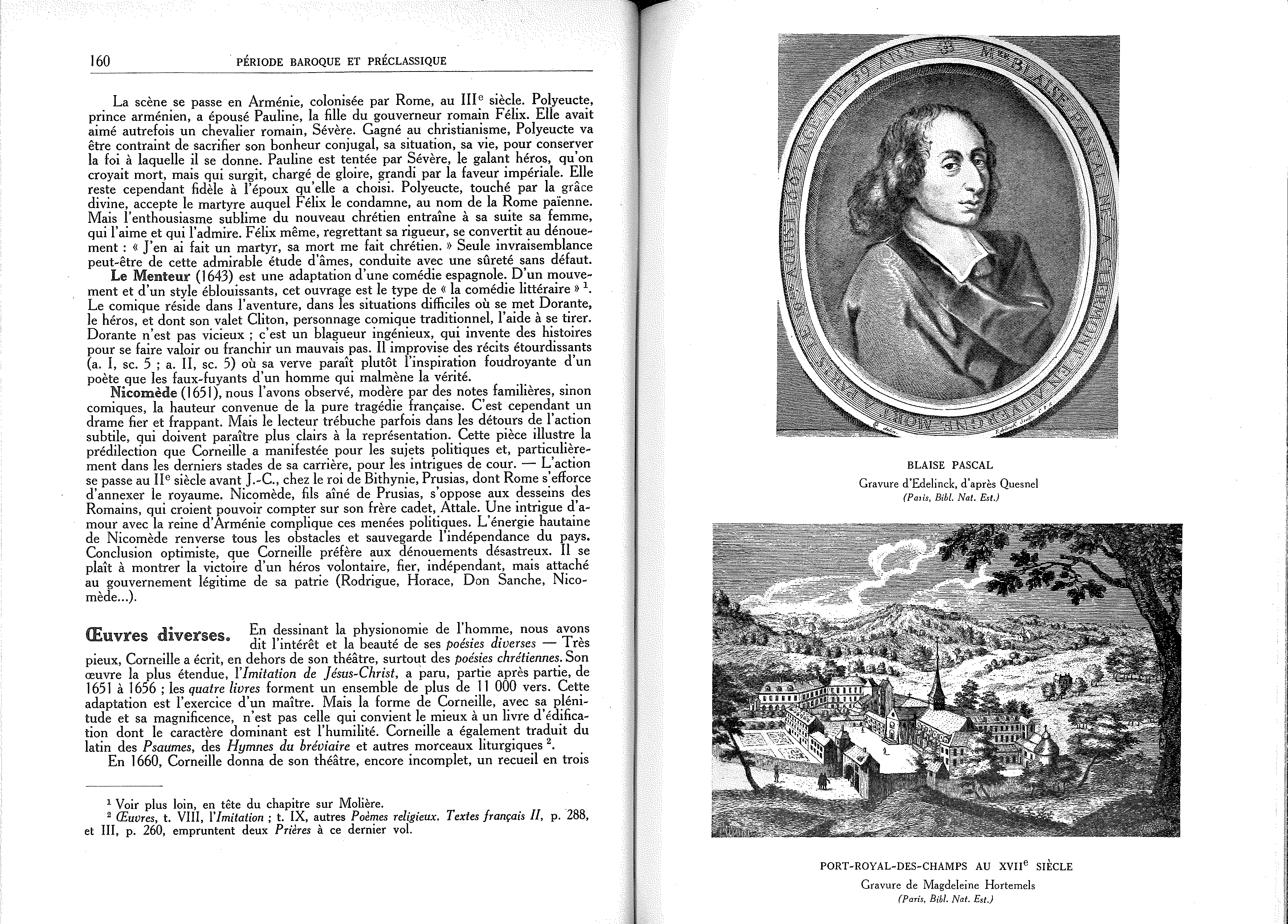
Figure 9: Page extraite du manuel de Kohler (1947: 161)
Ainsi, cette période se situe dans une certaine continuité avec la période précédente, et ce malgré les avancées éditoriales et médiatiques.
Conclusion
Ce parcours historique montre qu’entre les années 1870 et les années 1970, les images se développent largement dans les manuels du primaire, alors qu’elles restent, sauf exception, absentes des anthologies utilisées dans le secondaire, ce dernier restant méfiant à leur égard. Cette méfiance est liée au souci de permettre aux élèves de la filière secondaire d’avoir un accès direct au texte littéraire, sans médiation. On peut s’étonner que l’implosion de l’image dans la société des Trente Glorieuses n’entraîne pas de changements profonds dans l’utilisation des images au secondaire. Pour nous, cette stabilité est à mettre en lien avec un enseignement de la littérature qui, destiné à une élite, reste fondé sur l’histoire littéraire.
Au primaire, une évolution quant à la nature, au statut et à la fonction des images peut être mise en lumière. Entre les années 1870 et les années 1910, les images – essentiellement des gravures qui ne sont pas au départ conçues pour les manuels scolaires – ont une fonction de représentation (en fixant une définition visuelle du référent) et de vecteur de culture, laïque à Genève et Vaud, à connotation religieuse dans les cantons de Berne et de Fribourg. Tout en gardant cette fonction, elles acquièrent à partir du début du XXe siècle une fonction esthétique (en renforçant la dimension artistique et littéraire du manuel, et en participant au développement du goût artistique des élèves), et d'apprentissage (comme adjuvant aux activités de lecture et comme support aux exercices d’élocution). Les dessins conçus par des artistes locaux reconnus - Édouard Elzingre par exemple - viennent en effet illustrer les extraits littéraires, comme dans la littérature de jeunesse. Dès les années 1930-1940, les images – des dessins d’artistes, mais aussi des photographies en noir et blanc, puis progressivement en couleur - gagnent une certaine reconnaissance parmi des pédagogues qui y voient un moyen de documenter la réalité. Cependant, ce rôle qui leur est conféré exclut généralement toute image qui serait de nature abstraite ou qui ouvre à l’interprétation, surtout au degré moyen. Une transformation du statut de l’image intervient donc dans les années 1970, lorsque la littérature scolaire est redéfinie, intégrant la littérature de jeunesse et la bande dessinée, non seulement au primaire, mais aussi au secondaire qui se démocratise.
Bibliographie
Bishop, Marie-France (2017), «Une question de méthode: l’approche historico-didactique en français», in Théories-didactiques de la lecture et de l'écriture: fondements d'un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, A. Dias-Chiaruttini & C. Cohen-Azria (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Septentrion, p. 225-240.
Buisson, Ferdinand (dir.) (1911), Nouveau dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette.
Chervel, André (1992), «L’école, lieu de production d’une culture», in Analyser et gérer les situations d’enseignement-apprentissage, F. Audigier & G. Baillat (dir.), Paris, INRP, p. 195-198.
Choppin, Alain (2008), «Le manuel scolaire, une fausse évidence historique», Histoire de l'éducation, n° 117, p. 7-56.
Clavien, Alain (2017), Histoire de la presse romande, Lausanne, Éditions Antipodes.
Corsini, Silvio & François Vallotton (2011), «Suisse, histoire du livre et de l’édition», in Dictionnaire encyclopédique du Livre, vol. 3, P. Fouché, D. Péchoin & Ph. Schuwer (dir.), Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 775-778.
Darme-Xu, Anouk, Anne Monnier & Sylviane Tinembart (2020), «L'approche historico-didactique pour penser l'avènement du texte littéraire dans l'enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)», Transpositio, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2021), «Transposition, scolarisation et culture scolaire: la question de la construction des savoirs scolaires», Pratiques, n° 189-190, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2016),«Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique? L’exemple des corpus scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 35-44.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthyse (dir.), Paris, Honoré-Champion, p. 9-55.
Gervereau, Laurent (2020), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte (URL: https://doi.org/10.3917/dec.gerv.2020.01).
Hameline, Daniel, Arielle Jornod & Malika Lemdani Belkaïd (1995), L'École active: Textes fondateurs, Paris, Presses universitaires de France.
Hébrard, Jean (1988), «La scolarisation des savoirs élémentaires à l'époque moderne», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 7-58, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Henchoz, Louis (1930), «L’illustration des manuels scolaires», L’Éducateur, n° 66,p. 278-282.
Kahn, Pierre (2002), «Histoire d’une leçon de choses», in La leçon de choses: Naissance de l’enseignement des sciences à l’école primaire, P. Kahn, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels: quelle(s) image(s) de la littérature?», Dyptique, n° 37, p. 159-174.
Monnier, Anne (2021), «L’histoire des relations entre l’extrait et l’œuvre littéraire dans l’enseignement du français en Suisse romande (1830-2020)», in L’extrait et la fabrique de la littérature scolaire, A. Belhadjin & L. Perret (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 161-177.
Muller, Christian (2007), Histoire de la structure, de la forme et de la culture scolaires de l’enseignement obligatoire à Genève au XXe siècle (1872-1969), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Perret, Laetitia (2018), «Places et rôles des images des manuels dans l’évolution des disciplines scolaires», DIRE, n° 10, p. 89-99, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Perret, Laetitia (2019), «Place et rôle de l'image dans les manuels (1870-1960): point de vue méthodologique», in Le manuel scolaire, objet d'étude et de recherche: enjeux et perspectives, S. Wagnon (dir.), Peter Lang, p. 97-110.
Praz, Anne-Françoise (2005), De l’enfant utile à l’enfant précieux. Filles et garçons dans les cantons de Vaud et Fribourg (1860-1930), Lausanne, Antipodes.
Renonciat, Annie (2009), «De l’Orbis sensualium pictus (1658) aux premiers albums du Père Castor (1931): formes et fonctions pédagogiques de l’image dans l’édition française pour la jeunesse», in La pédagogie par l'image en France et au Japon, M. Simon-Oikawa & A. Renonciat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Roller, Samuel (1957), «De l’image au document: réflexions sur le rôle que l’image peut jouer dans l’enseignement», Annuaire de l’instruction publique en Suisse, n° 48, p. 83-94.
Saint-Martin, Isabelle (2010), «Christianisme», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Nouveau Monde.
Schneuwly, Bernard, Thomas Lindauer, Anouk Darme, Julienne Furger, Anne Monnier, Rebekka Nänny & Sylviane Tinembart (2016), «Enseignement de la langue première “Deutsch” – “Français”, Remarques sur l'histoire de la discipline en Suisse (~ 1840 à ~ 1990)” dans une perspective comparative», Forumlecture, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Vollenweider, Emmanuelle (en cours), Histoire de la lecture de textes littéraires enseignée aux élèves. Analyse des représentations (1880-1980), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Annexes
- Sources utilisées pour le primaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte (ou page) par manuel |
Genève | Programme de l’enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires, 1889. Programme de l’enseignement dans les écoles primaires, 1923. Plan d’études de l’école primaire, 1942. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1951. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1966. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Gavard, Alexandre (1893), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires de Suisse romande. Degré intermédiaire, Genève, C.-E. Alioth. Dussaud, Bernard & Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Mercier, Louis & Marti, Adolphe (1911), Livre de lecture à l’usage du degré supérieur des écoles primaires, Genève, Edition Atar. Marti, Adolphe (1916), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Genève, Edition Atar. DIP GE (1929), J’aime lire. Livre de lecture destiné à la 4ème année de l’école primaire du canton de Genève. Genève, DIP. DIP GE (1940, réimpression de 1955), Fleurs coupées,Choix de textes littéraires pour le 6e degré de l’école primaire, Genève, DIP. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Gavard (1893): 92 images / 236 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Mercier & Marti (1911): 106 images / 277 textes Marti (1916): 60 images / 231 textes DIP GE (1929): 60 images / 140 textes DIP GE (1940/1955): 55 images / 251 textes |
Vaud | Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires, 1899. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1926. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1935. Plan d’études et instructions générales pour les classes primaires supérieures, 1937. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1953. Plan d’études et instructions générales pour les Ecoles enfantines et les Ecoles primaires du canton de Vaud, 1960. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dussaud, Bernard, Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Borgeaud. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur. Bonjour, Émile, (1925), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Degré intermédiaire, Lausanne, librairie Payot. Bonjour, Émile & Jeanrenaud, Henri (1931), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Payot. Foretay, Charles (1944), Lectures à l'usage du degré moyen des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. Foretay, Charles & Jeanrenaud, Henri (1946), Lectures à l'usage du degré supérieur des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Dupraz & Bonjour (1899): 0 image / 244 textes Dupraz & Bonjour (1903): 0 image / 266 textes Bonjour (1925): 50 images / 215 textes Bonjour & Jeanrenaud (1931): 67 images / 244 textes Foretay (1944): 89 images / 185 textes Foretay & Jeanreneaud: 31 images / 250 textes |
Fribourg | Programme général des écoles primaires du canton de Fribourg, 1899. Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932. Écoles françaises de Fribourg, programme 1949-1950. Guide et plan d’études, 1967, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg avec approbation de la commission des études, Lausanne, L. Vincent. DIP FR (1889), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1899), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1925), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Fribourg, DIP. DIP FR (1934), Mes lectures. Écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Fribourg, DIP. DIP FR (1955), Lecture et poésie: Livre de lecture, degré moyen des écoles primaire, Fribourg, DIP. DIP FR (1954, nouvelle édition), Mes lectures. Degré supérieur des écoles primaires du canton de Fribourg, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881): 49 images / 259 textes DIP FR (1889): 62 images / 222 textes DIP FR (1899): 78 images / 252 textes DIP FR (1925): 123 images / 189 textes DIP FR (1934): 75 images / 200 textes DIP FR (1955): 126 images / 205 textes DIP FR (1954): 81 images / 193 textes |
Berne | Plan d’enseignement pour les écoles primaires du canton de Berne, 1878, Schuler, Berne. Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Berne, 1925, H. Kramer, Tavannes. Plan d’études pour les écoles primaires de langue française du canton de Berne, Edition provisoire, 1968, Berne, Librairie de l’État. | DIP BE (1885), Le Trésor de l’écolier.Livre de lecture à l’usage des écoles primaires françaises du canton de Berne. Degré supérieur, Lausanne, librairie Payot. Gobat, Henri & Allemand, Fritz (1911), Livre de lecture destiné aux écoles primaires du Jura bernois. Cours moyen (8e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel (1927), Notre camarade. Choix de lectures à l’usage des écoles primaires. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Bessire, Paul-Otto (1931), L’écolier jurassien. Choix de lectures à l’usage des écoles supérieures. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Jeanprêtre, Charles, Monnerat, Joseph, Stähli, Roland, Terrier, Pierre & Zbinden, Jean (1961), Horizons nouveaux. Livre de lecture à l’usage des cinquième et sixième années scolaires, Berne, Libraire d’État. Devain, Henri, Henry, Pierre, Pecaut, Armand, Pellaton, Jean-Paul & Stähli, Roland (1964), Les belles années: livre de lecture à l’usage du degré supérieur de l’école primaire, Berne, Librairie d’État. | DIP BE (1885): 13 images / 392 textes Gobat & Allemand (1911): 178 images / 299 textes Marchand (1927): 37 images / 253 textes Bessire (1931): 0 image / 249 textes Jeanprêtre et al. (1961) 17 images / 200 textes Devain et al. (1964): 16 images / 167 textes |
2. Sources utilisées pour le secondaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte par manuel |
Genève | Programme pour l’année 1901-1902, École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1901, Genève, Paul Richter. Programme d’enseignement pour l’année 1900-1904, Collège de Genève, 1900, Genève, DIP. Programme pour l’année 1923-1924. École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1923, Genève, Klein. Programme pour l’année 1925-1926, Collège de Genève, 1925, Genève, Klein. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1962, Genève, DIP. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1977-1978, Genève, DIP. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes |
Vaud | Programme de l’année scolaire 1873-1874 pour le collège cantonal, l’école industrielle et les collèges communaux du canton de Vaud. Collège cantonal, Programmes des cours, année scolaire 1877-1878. Collège cantonal, Programme des cours, année scolaire 1896-1897. Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud, 1910. Collèges et gymnase scientifiques cantonaux, Renseignements, année scolaire 1921-1922. Collège classique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1922-1923. Collège scientifique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1935-1936. Collège classique cantonal. Programme des cours, année scolaire 1936-1937. Programmes des cours des collèges secondaires vaudois, 1960. Programmes des cours des collèges secondaires, 1971. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre (1948), Histoire de la littérature française. Tome 2. Du milieu du XIXe siècle à nos jours avec une histoire de la littérature romande. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre, Guisan, Gilbert & Pidoux, Edmond (1949), Histoire de la littérature française. Tome 3. Le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image/132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages Kohler (1948): 31 images / 564 pages Kohler et al. (1949): 31 images / 806 pages |
Fribourg | Programme des études du Collège St-Michel à Fribourg pour l'année scolaire 1881-1882. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des filles de la ville de Fribourg pour l’année 1882-1883. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1901-1902. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des jeunes filles de la ville de Fribourg pour l’année 1901-1902, Programme pour l’année scolaire 1902-1903. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1912-1913. Compte-rendu de l’Ecole Secondaire des Jeunes Filles de la ville de Fribourg pour l’année 1912-1913, Programme pour l’année scolaire 1913-1914. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1922-1923. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1923-1924. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1938-1939. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1951-1952. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1965-1968. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1970-1973. | Broeckaert, Joseph (1869), Modèles français recueillis d'après le plan du guide du jeune littérateur avec des remarques propres à en faciliter l'étude, vol. 1, Bruxelles, H. Goemaere. Lebaigue, Charles (1887), Morceaux choisis de littérature française. Auteurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (prose et poésie) avec remarques et questions. Deuxième année, Paris, Librairie classique E. Belin. Lebaigue, Charles (1889), Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) avec remarques et questions. Première année (2e éd.), Paris, Librairie classique E. Belin. Des Granges, Charles-Marc (1910), Histoire de la littérature française à l'usage des classes de Lettres et de divers examens (3e éd.), Paris, Hatier. Des Granges, Charles-Marc (1917), Morceaux choisis des auteurs français du Moyen âge à nos jours (842-1900) préparés en vue de la lecture expliquée. Classes de lettre 2e cycle (9e éd.), Paris, Hatier. Procès, Edmond (1927), Modèles français extraits des meilleurs écrivains avec notices. Cours inférieur (12e éd.), Bruxelles: Albert Dewit. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest, & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Broeckaert (1869): 0 image / 223 textes Lebaigue (1887): 0 image / 158 textes Lebaigue (1889): 0 image / 140 textes Des Granges (1910): 0 image / 927 pages Des Granges (1917): 0 image / 504 textes Procès (1927): 23 images / 206 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages |
Berne | Programme de l’école cantonale de Porrentruy, 1897. Programme d’enseignement. Progymnase, gymnase, section commerciale, École cantonale de Porrentruy, 1929, Porrentruy, «Le Jura S.A.». Plan d’études des écoles secondaires et progymnases de langue française, 1961. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Marchand, Marcel (1917), Notre ami, lectures françaises à l’usage des écoles secondaires (2e éd.),Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1937), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1938), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes supérieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1943), Notre ami III. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des écoles progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Marchand (1917): 0 image / 258 textes Marchand et al. (1937): 0 image / 94 textes Marchand et al. (1938): 0 image / 88 textes Marchand et al. (1943): 0 image / 205 textes |
Pour citer l'article
Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider, Anouk Darme-Xu , "Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970) ", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/les-images-dans-les-livres-de-lecture-et-les-anthologies-scolaires-suisse-romande-1870-1970
Sur Facebook